
La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative complexe dont les causes restent encore largement débattues. Depuis une vingtaine d’années, l’hypothèse d’une origine intestinale gagne du terrain, notamment grâce aux travaux du médecin allemand Heiko Braak. Selon cette théorie, un déséquilibre du microbiote intestinal, associé à un agent pathogène inconnu, pourrait être à l’origine de la maladie. Ce pathogène migrerait du système digestif vers le cerveau via le nerf vague, reliant ainsi l’intestin à l’encéphale. Les dernières découvertes scientifiques renforcent cette hypothèse et ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre et prévenir Parkinson.
Des indices cliniques et épidémiologiques convergents

Les liens entre l’intestin et le cerveau dans la maladie de Parkinson sont de plus en plus documentés. En 2017, des chercheurs suédois ont montré que les personnes ayant subi une ablation du nerf vague présentaient un risque réduit de développer la maladie, suggérant un rôle clé de cette connexion. De plus, des troubles digestifs comme la constipation ou l’inflammation apparaissent souvent des années avant les premiers symptômes moteurs de Parkinson. Une étude récente publiée dans Nature Communications a révélé un déséquilibre majeur du microbiote intestinal chez les patients, caractérisé par une surabondance de bactéries pathogènes et une diminution des espèces bénéfiques.
Un microbiote pro-inflammatoire chez les malades
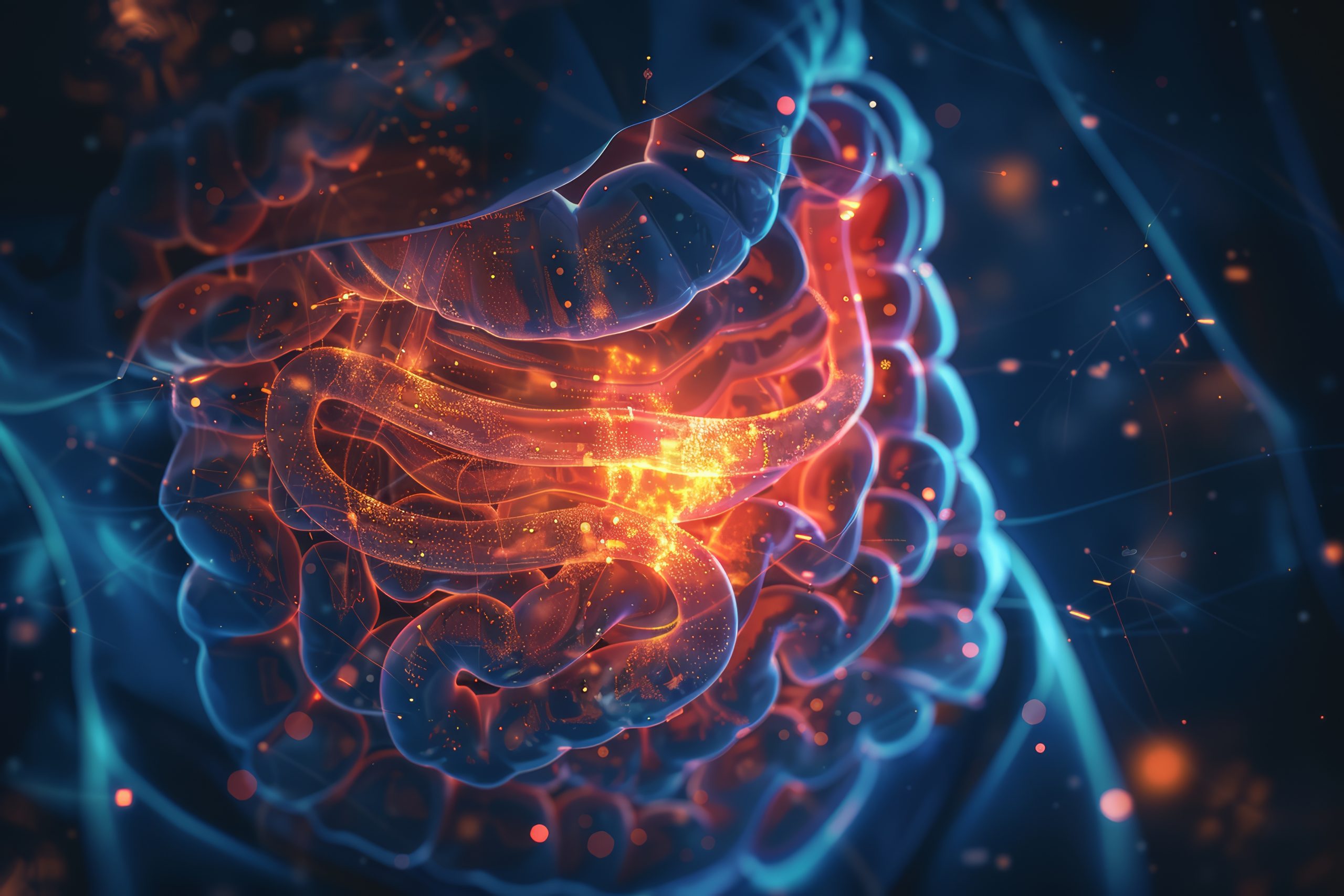
Les chercheurs de l’Université de l’Alabama ont comparé le microbiote de 490 personnes atteintes de Parkinson à celui de 230 témoins sains. Les résultats montrent une forte prévalence de la constipation chez les malades, corrélée à la présence accrue de certaines bactéries pathogènes comme Bifidobacterium dentium, Actinomyces oris ou Streptococcus mutans. Parmi ces espèces, plusieurs produisent des lipopolysaccharides, des molécules pro-inflammatoires qui stimulent le système immunitaire et pourraient favoriser l’inflammation chronique. À l’inverse, des bactéries bénéfiques impliquées dans la dégradation des fibres alimentaires, telles que Roseburia intestinalis et Blautia wexlerae, sont nettement moins présentes, ce qui pourrait expliquer les troubles digestifs observés chez les patients.
Un déséquilibre qui fragilise la barrière intestinale

L’analyse des gènes bactériens révèle que le microbiote des personnes atteintes de Parkinson exprime moins de gènes nécessaires à la digestion des glucides complexes, mais davantage de gènes liés à la dégradation des protéines et des acides aminés. Cette préférence pour la consommation de protéines, dont celles des mucines qui protègent la muqueuse intestinale, pourrait entraîner un affaiblissement de la barrière intestinale. Une telle fragilité favoriserait le passage de molécules ou de pathogènes vers le nerf vague, puis potentiellement vers le cerveau, contribuant à l’apparition ou à l’aggravation de la maladie.
Le microbiote et la production de dopamine
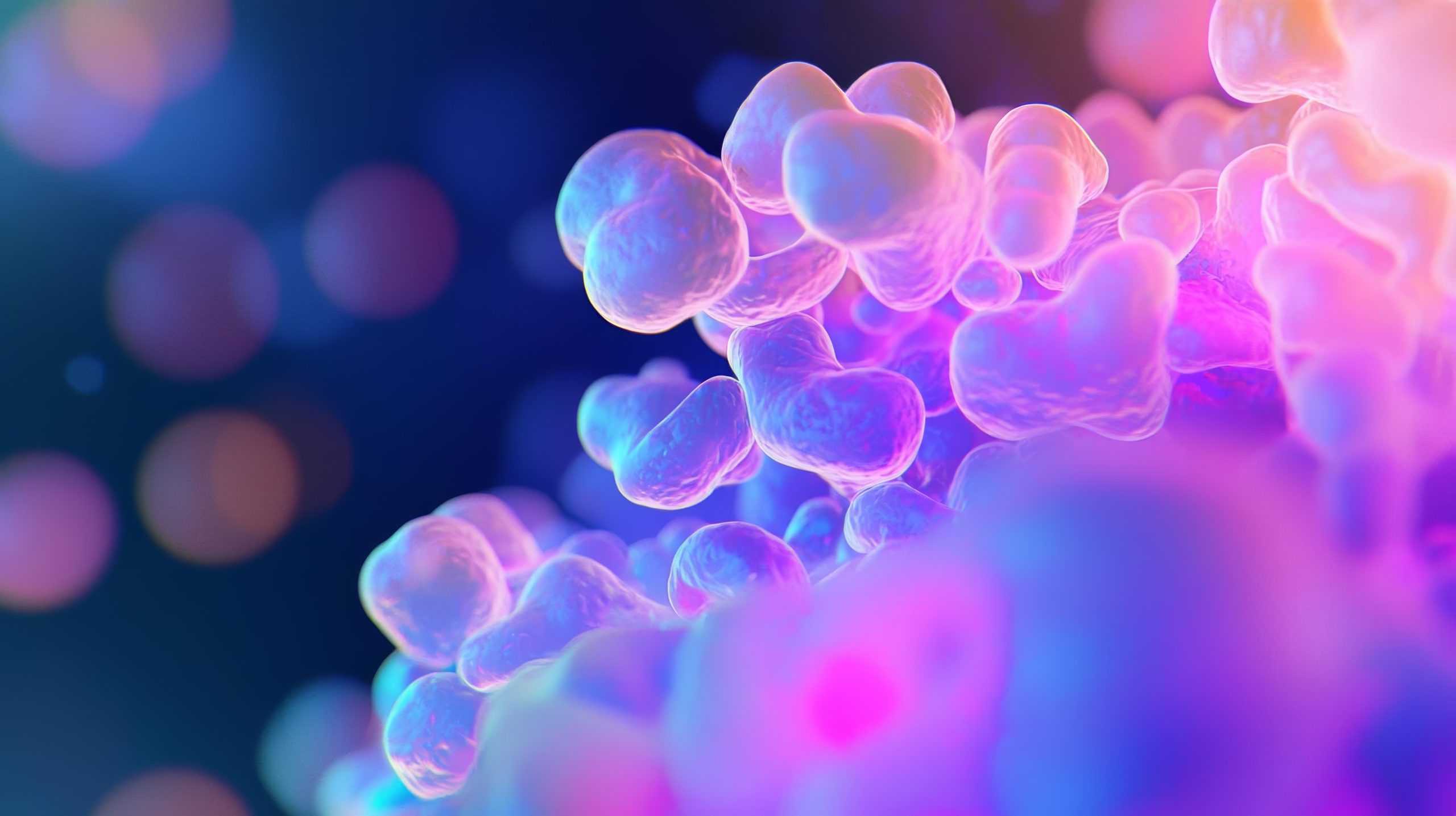
Un autre aspect crucial mis en lumière par l’étude concerne la synthèse des neurotransmetteurs. Les gènes du microbiote des malades favorisent l’utilisation de la tyrosine, un acide aminé essentiel à la production de dopamine, tandis que la synthèse d’autres acides aminés aromatiques est réduite. Or, la dopamine est le neurotransmetteur dont la carence caractérise la maladie de Parkinson. Ce déséquilibre pourrait donc contribuer à la diminution de dopamine, aggravant les symptômes moteurs. Il reste cependant à déterminer si ces anomalies sont une cause ou une conséquence de la maladie.
Des symptômes précoces à surveiller

Les chercheurs soulignent que les troubles digestifs précèdent souvent de plusieurs années le diagnostic de Parkinson. La constipation, l’inflammation intestinale ou la modification du microbiote pourraient donc servir de signaux d’alerte précoces. Si le lien de causalité venait à être confirmé, la prévention et la modulation du microbiote intestinal pourraient devenir des axes majeurs pour retarder ou limiter l’apparition de la maladie. Cela ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques, comme la transplantation de microbiote ou l’utilisation de prébiotiques et probiotiques ciblés.
Conclusion

L’hypothèse intestinale de la maladie de Parkinson se renforce au fil des recherches, mettant en lumière le rôle central du microbiote dans la santé cérébrale. Si la preuve formelle d’une causalité reste à établir, les résultats récents suggèrent que l’équilibre bactérien intestinal pourrait être un facteur clé dans le développement de la maladie. Mieux comprendre ces interactions entre intestin et cerveau pourrait révolutionner la prévention, le diagnostic et le traitement de Parkinson, offrant de nouveaux espoirs aux patients et à leurs familles.