
Si je devais résumer la situation en une image, ce serait celle d’un rocher minuscule bousculé, encerclé, mais jamais submergé par l’océan. Taïwan, c’est cette île, cette sentinelle du Pacifique. Depuis quelques années, chaque été ressemble à un bras de fer, une épreuve de nerfs, avec une tension qui palpite dans l’air. C’est dans ce climat que prennent place les manœuvres Han Kuang, devenues l’un des évènements militaires les plus observés d’Asie. Pour moi, la gravité de ces exercices ne tient pas seulement dans la longueur accrue ou le nombre record de réservistes mobilisés. Non, c’est plutôt le message, à la fois cri du cœur et cri de guerre, qu’ils adressent au monde : la liberté, la démocratie, la souveraineté, ça ne se négocie pas. J’ai l’impression, en les regardant s’entraîner, d’entendre battre le pouls de toute une nation, acculée mais fière, qui hurle à la tempête de ne pas s’approcher.
La montée en puissance des manœuvres Han Kuang
Les manœuvres Han Kuang de 2025 n’ont rien d’une simple répétition militaire. Le gouvernement taïwanais, faisant face à l’intimidation croissante de Pékin, a déployé pour la première fois un nombre record de 22 000 réservistes sur dix jours et neuf nuits. Ces exercices n’ont pas été conçus pour rassurer, mais pour prouver que, face à la montée de la menace chinoise, Taïwan n’est pas prête à se laisser dominer. On pourrait croire à un jeu d’échec géant, mais la réalité, c’est que chaque tactique, chaque mouvement, chaque simulation d’invasion orchestrée, possède un poids existentiel. Cette année, l’île a aussi innové, intégrant de nouveaux équipements de pointe américain, comme les systèmes de lance-roquettes HIMARS et des chars d’assaut M1A2 Abrams flambant neufs. Tout, dans cette chorégraphie guerrière, vise à renforcer une défense asymétrique, rendant toute tentative d’invasion aussi imprévisible que coûteuse pour l’ennemi.
Ce qui frappe, c’est la dimension presque rituelle de ces manœuvres. Depuis 1984, l’exercice s’est transformé en rituel national : chaque tir de missile, chaque simulation de débarquement, chaque scénario catastrophe rappelle aux 23 millions de citoyens de l’île qu’ils restent les gardiens d’un précieux bastion démocratique en Asie. Cet esprit de mobilisation générale, ces réservistes convoqués en masse, tout ceci contribue à tisser un récit de résistance où la peur cède la place à la détermination.
Comment ne pas ressentir une certaine admiration ? Année après année, le dispositif se raffine, se muscle, répond aux menaces de la Chine qui aligne navires, avions et missiles toujours plus près des côtes taïwanaises. Mais ici, loin de céder à la panique, l’armée taïwanaise s’entraîne, anticipe, se prépare à l’inévitable. Oui, Han Kuang est plus qu’un simple exercice, c’est la promesse d’une riposte face à l’adversité.
Un défi stratégique : Pékin resserre l’étau
Face à la puissance chinoise, Taïwan apparaît souvent comme le « petit poucet », mais ce serait une erreur d’analyse. Jamais la stratégie de défense taiwanaise n’a été aussi agile, flexible, hybride. Les manœuvres, cette année, démontrent la volonté farouche de Taipei de ne pas se faire prendre au piège d’une guerre frontale, mais d’affaiblir progressivement les capacités d’agression de l’ennemi. Car Pékin, plus que jamais, multiplie les provocations : 31 avions de combat et 7 navires militaires chinois repérés en vingt-quatre heures près de l’île, cela n’a rien de l’exercice de routine. Il faut voir dans ces mouvements une pression psychologique continue, un harcèlement qui vise à user le moral autant que les effectifs.
Ma conviction, c’est que l’obsession chinoise autour de Taïwan dissimule bien plus qu’une question de territoire. C’est la survie même d’un modèle politique, d’une façon d’être au monde, qui se joue ici sur les plages, les routes, les cieux taïwanais. Il ne s’agit pas simplement de repousser un envahisseur, mais de défendre l’idée même de pluralité et d’autodétermination, ces mots que Pékin regarde avec suspicion. Intransigeante, la Chine ne craint pas de jouer de tout son arsenal, du blocus aux cyberattaques, pour faire plier l’île. Pourtant, chaque manœuvre Han Kuang accentue l’incompréhension et la défiance entre les deux rives, et fait monter d’un cran la tension dans le détroit.
La force du dispositif taïwanais, c’est justement de parvenir à répondre du tac au tac, souvent avec la ruse, là où la puissance brute chinoise échoue à intimider. Chaque mobilisation taïwanaise envoie un signal fort à la communauté internationale. Si ce conflit devait éclater, il embraserait tout le Pacifique et au-delà. Voilà pourquoi Han Kuang cristallise autant d’attention, autant d’espoirs que de peurs.
L’importance symbolique de la riposte
On pourrait penser qu’il ne s’agit que d’une question militaire, de chiffres et de technologies, mais ce serait passer à côté de l’essentiel. Lorsque le ministre de la Défense, Wellington Koo, martèle que son pays possède « la confiance et la capacité de défendre une vie libre et démocratique », il sait que l’enjeu dépasse le cadre national. Il s’agit de maintenir à flot un symbole, celui d’un îlot de démocratie encerclé par une mer d’autoritarisme. La résistance de Taïwan, à travers Han Kuang, est observée avec autant de suspicion par ses voisins qu’avec admiration par ses alliés.
Dans la longue tradition des conflits asymétriques, c’est souvent la capacité d’un plus petit acteur à surprendre, à harceler, à rendre le coût d’une victoire intenable, qui finit par déjouer les plans de la superpuissance. Taïwan, en modernisant ses capacités de guerre électronique, en multipliant les drones et les frappes de précision, joue cette carte de la dissuasion par la résilience. Cette année, les exercices incluent des scénarios de « zone grise », des actions ambiguës où la limite entre paix et guerre s’efface. C’est là aussi que réside la complexité : comment préparer la nation à tous les scénarios sans sombrer dans la psychose ou la provocation inutile ?
L’équilibre menaçant : entre préparatifs intenses et guerre psychologique
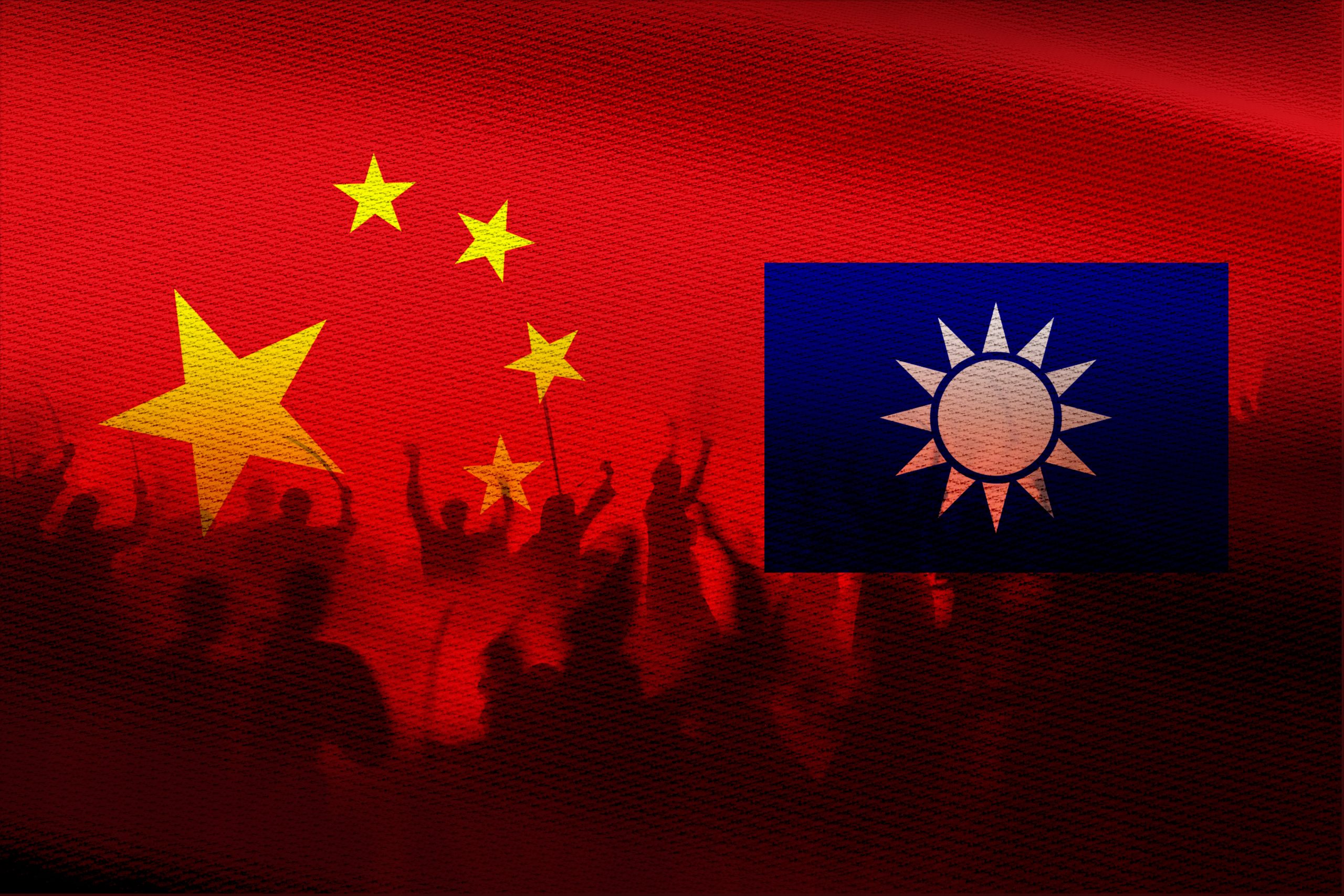
Mobilisation sans précédent : réservistes et nouveaux équipements
En 2025, une synergie inédite a vu le jour : les armées régulières épaulées par des milliers de réservistes, parfois rappelés à la vie civile pour quatorze jours de formation et d’entraînement intensif. Cette mobilisation sans précédent s’inscrit surtout dans la volonté de créer un front uni, où l’implication de toute la société civile devient la clé de voûte de la défense taïwanaise. Parallèlement, les nouveaux matériels américains débarquent sur l’île : chars M1A2 Abrams, systèmes HIMARS, modernisation accélérée des batteries anti-aériennes Patriot et Sky Sword. Ce bond technologique n’est pas un luxe, mais une nécessité face à la supériorité numérique et matérielle de l’adversaire.
Le choix d’une défense agile, décentralisée, s’exprime également dans l’entraînement aux tactiques de guérilla urbaine et de sabotage, anticipant le cas d’un débarquement chinois réussi. On sent poindre une volonté de ne rien laisser au hasard, de transformer chaque rue, chaque colline, chaque port en bastion potentiellement imprenable. Les forces armées, traditionnellement hiérarchiques, apprennent à réinventer leur doctrine en valorisant la créativité et le sens de l’initiative.
Ce qui fait la différence, en définitive, c’est la capacité d’agréger ces technologies et ces hommes dans un système de vigilance permanente. L’armée ne dort jamais complètement à Taïpei… chaque vague, chaque avion suspecté d’un détour, chaque navire au large est intercepté, analysé, archivé. Et dans cette mécanique, pas un grain de sable n’est toléré.
La pression diplomatique et l’équation internationale
Entre deux exercices tirés à blanc, une autre bataille fait rage, bien moins visible, mais tout aussi décisive : celle de la diplomatie. Taïwan, comme un équilibriste sur son fil, multiplie les actes de démonstration de force pour rappeler sa résilience à la face du monde. Car chacun sait que si le vent venait à tourner, le sort de l’île ne dépendrait pas uniquement de sa bravoure, mais de la réactivité de ses alliés. Les États-Unis, allié indéfectible sans être reconnu officiellement, n’ont jamais autant investi dans la formation, l’armement et l’équipement des forces taïwanaises.
L’Europe, quant à elle, observe, émet des signaux, mais reste sur le seuil. La guerre en Ukraine a réveillé des réflexes endormis, redonnant une actualité brûlante à la notion de dissuasion. Le Japon, la Corée du Sud, l’Australie : chacun anticipe l’onde de choc potentielle d’un conflit dans le détroit de Taïwan, qui redistribuerait l’équilibre des puissances dans l’ensemble de la région Indo-Pacifique.
Pourtant, la stratégie de Taïwan reste celle du serpent, toujours sur la défensive, toujours prompt à frapper si l’on tente de l’encercler. La diplomatie, ici, n’est pas simplement affaire de mots, mais un prolongement de la stratégie militaire. Les Han Kuang servent autant à rassurer qu’à impressionner, à mobiliser l’opinion, à rappeler que l’île n’est pas seule, mais cherche toujours à l’être un peu moins.
Zone grise : là où commence l’ambiguïté de la guerre moderne
Mais – et c’est mon obsession du moment – il y a un aspect encore sous-estimé : la « zone grise ». Ces actions furtives, sous le seuil de la guerre déclarée, constituent aujourd’hui la vraie ligne de front de Taïwan. Cyberattaques, stratégie de désinformation, harcèlement maritime et aérien… C’est là que s’exerce l’art de l’ambiguïté et de l’intimidation.
Les manœuvres Han Kuang 2025 ont explicitement intégré ces scénarios, avec des exercices d’interception de navires non identifiés, des simulations de sabotage d’infrastructures stratégiques, et le déploiement de drones espion. La guerre ne se fait plus forcément au prix du sang et de la poudre, mais sur des terminaux informatiques, dans la brume des radars et des satellites espions. Pour moi, cette dimension impose de repenser entièrement la doctrine de défense : il ne suffit plus d’aligner des tanks et des soldats, il faut désormais intégrer programmeurs, analystes et cyber-combattants à la première ligne.
Les enjeux humains, moraux et identitaires : han kuang, miroir d’une nation

La société civile : au cœur de la défense
Dans chaque famille, chaque école, chaque entreprise, le mot défense a pris une substance inédite. Les exercices Han Kuang ont favorisé le maillage de la société taïwanaise, multipliant les entraînements dans les administrations, les hôpitaux, les médias. Les drills d’urgence, les évacuations simulées, les consignes de survie se sont banalisés, jusqu’à devenir des automatismes. La population se prépare à l’inattendu comme on se prépare à la mousson – en espérant qu’elle ne viendra pas, mais sans jamais cesser de s’y préparer.
Cette mobilisation transgénérationnelle redéfinit la notion même de citoyenneté : à Taïwan, être citoyen, c’est aussi être sentinelle. Ce pacte implicite, forgé sous la menace, nourrit un sentiment d’appartenance unique, qui transcende les divisions sociales et politiques. En dépit des doutes, le peuple tient, s’accroche à cette idée que l’Histoire a un sens, qu’elle peut encore être écrite au présent.
Oui, il y a des failles, des débats, des angoisses mal étouffées. Mais à la question « sacrifierais-tu ta tranquillité pour défendre l’île ? », la plupart répondent, à mi-voix, mais sans détour, que le jeu en vaut la chandelle.
Entre lassitude et résilience : le fardeau quotidien
La routine des sirènes, la peur du lendemain, la vision des navires en ligne d’horizon, tout cela pourrait épuiser, ronger jusqu’au cœur. Certains craquent, hésitent, rêvent d’exil ou d’oubli. Mais la majorité, au lieu d’être terrassée par l’angoisse, s’en sert comme d’un bouclier invisible. Il y a là un refus obstiné de céder à la fatalité, une manière de sublimer la menace par la détermination collective. Ce refus, cette forme de « grâce sous pression » – c’est pour moi le vrai miracle taïwanais.
Je me fais parfois l’écho de ces voix qui murmurent : « jusqu’à quand tiendrons-nous ? » Et la réponse, toujours la même, dans le sourire d’un réserviste ou le regard d’un général : « aussi longtemps que nécessaire ». L’épuisement fait partie du jeu, mais ce jeu-là repose sur des principes plus solides que la peur seule.
L’identité taïwanaise se forge dans ce creuset d’incertitude, de menaces, de sursauts d’orgueil. S’il existe une victoire à célébrer ici, c’est celle d’un peuple qui a choisi, jour après jour, de ne pas plier.
La voie de l’adaptation permanente
Aucune société n’aurait pu survivre à tant de tempêtes sans une capacité d’adaptation exceptionnelle. L’innovation, la mutualisation, l’inventivité quotidienne, ces forces, plus que la puissance de feu, font la spécificité de la résistance taïwanaise. Han Kuang est le laboratoire de ces métamorphoses : intégration des nouvelles technologies, enseignements des années précédentes, adaptation aux tactiques chinoises en constante évolution.
Résilience insulaire et mondialisation des menaces : la conclusion inachevée
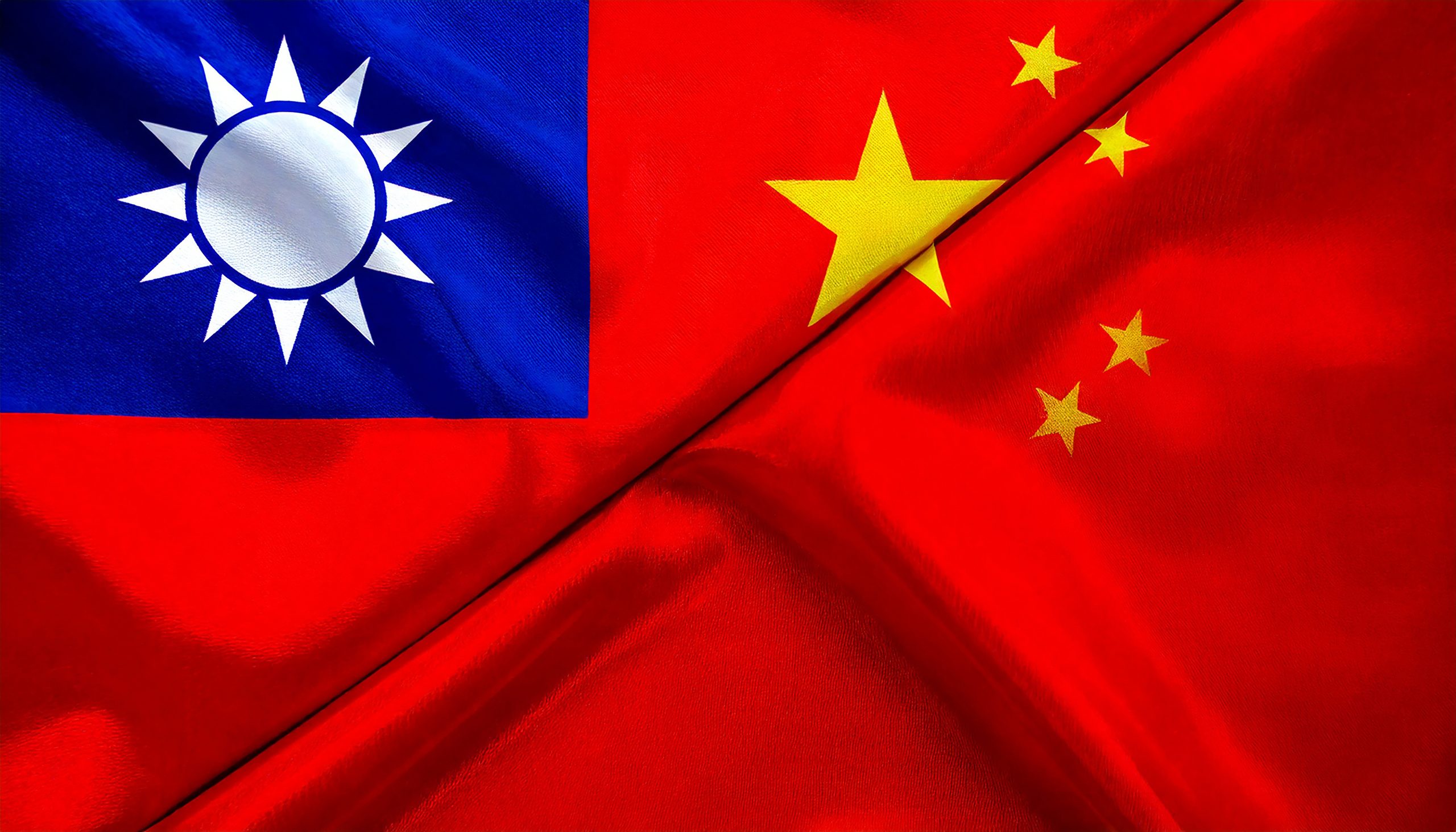
En guise de parole personnelle, je dirais : Taïwan, ce « caillou dans la chaussure » de Pékin, est devenu bien plus que cela. C’est une leçon d’histoire, une mise en garde adressée à toute démocratie menacée d’engloutissement par la puissance brute. Rien n’est jamais joué d’avance, tout est question de volonté, de stratégie, de solidarité et de timing. Les Han Kuang symbolisent la capacité d’une nation à se hisser, encore et toujours, à la hauteur du danger, refusant la résignation.
Mais, je vous avoue, cette tension permanente entre la peur et la fierté me laisse un goût d’amertume. Triste routine que celle d’une nation condamnée à vivre chaque été dans l’attente du pire, à faire de la vigilance un mode de vie, voire un art. Pourtant, ce n’est pas seulement un symbole ou un drame lointain : la question taïwanaise nous ramène à l’essence même du vivre ensemble, à la fragilité de nos libertés chèrement acquises. Ici, une métaphore s’impose : l’île est cette flamme vacillante que le monde, silnyt s’il en reste encore un peu de lucidité, devrait protéger de tous les vents mauvais.