
Mot à mot, une guerre se joue aussi dans les phrases
La guerre d’Ukraine ne tue pas qu’à coup d’obus, elle lacère aussi par les mots : à Moscou, dans les colonnes de TASS, de RT, le mot « invasion » est banni. Là-bas, on parle de libération, d’« opération spéciale », de sauvetage. Tandis qu’à Paris, Londres, Washington, le terme « agression russe » s’impose, massif, inaltérable. Deux mondes côte à côte, deux réalités closes, deux humanités séparées par un gouffre de récits. Combien de morts sont enterrés sous ces contradictions ? Ici, je commence un reportage qui dérange, qui blesse même, tant la lutte est intime entre vérités et mensonges, et que la brûlure du doute réveille bien plus que la lumière aveuglante d’une certitude.
Les agences russes, magiciennes du langage guerrier
Sur TASS ou RIA Novosti, tout est soigneusement calibré : « l’armée russe libère tel village », « opération contre les nationalistes », « population sauvée ». Le vocabulaire, ventriloque d’un pouvoir, se répète à l’infini, accouche d’une réalité étrange, presque hypnotique. Le conflit devient spectacle, chaque offensive un acte héroïque, chaque défaite ukrainienne une vérité révélée. Derrière le rideau, il y a les censeurs : aucun mot de trop, tout glisse doucement vers la version officielle, immuable, sans fissure.
Propagande occidentale ? Non, contre-récit assumé
Mais à l’Ouest, sur France 24, la BBC, CNN, c’est l’inverse. « Invasion » ! « Agression armée » ! Les envoyés spéciaux, casque vissé et micro tendu, racontent la peur, les frappes, la résistance. L’émotion inonde la une, chaque image veut faire tomber le masque, montrer la douleur. On ne parle pas d’« opération spéciale », mais bien de guerre — sale, injuste, brutale. Tout le poids du vocabulaire pèse du côté ukrainien : la solidarité, la résistance, la victime. Même le doute porte un maillot jaune et bleu.
La machine russe : opérer, « libérer », façonner l’histoire

TASS et la grande fable de l’émancipation
Depuis le début du conflit, TASS narre méthodiquement une série de libérations miraculeuses, d’avancées « pacifiques ». Les troupes russes sont peintes en sauveurs de villages opprimés, instaurant partout le calme — « après la fuite des nationalistes », insistent les dépêches. Même la prise de villes ukrainiennes détruites est recadrée : pas d’occupation, mais une « main tendue » aux populations supposément martyrisées. L’appareil de presse, huilé, efface crimes de guerre, destructions, viols, ne retenant qu’une litanie de « victoires humaines ».
Le vocabulaire du Kremlin : « opération spéciale », jamais « guerre »
Dès février 2022, un décret interdit le mot « guerre » dans la presse russe. « Opération spéciale » — on dirait le nom d’une mission secrète, héroïque, irréprochable. Il s’agit de « protéger les populations russophones du Donbass », d’éradiquer un « régime nazi », d’assurer la paix future pour tous. Poutine en personne ressasse le récit : l’Ukraine serait le pion de l’Occident, le bras armé d’une coalition « russo-phobe ». Tout est inversé : c’est l’Ouest l’agresseur, la Russie la victime salvatrice.
Des images construites, la réalité occultée
La télévision russe, ce théâtre d’ombres, diffuse à la chaîne les « libérations » triomphales. Reportages léchés, images d’écoles « rouvertes », enfants « sourire retrouvé » sous le drapeau tricolore. Pendant ce temps, la misère s’enfouit, des villages sont vidés, les veuves pleurent. Chaque image, chaque cut, chaque cadrage efface la fêlure : les morts n’apparaissent jamais. Un soldat russe étreint une babouchka : « merci de nous avoir sauvés », souffle-t-elle. On dirait du théâtre, mais à force la fiction imprime sa marque sur le réel.
Miroir inversé : l’Ouest brandit « invasion », la Russie clame « libération »
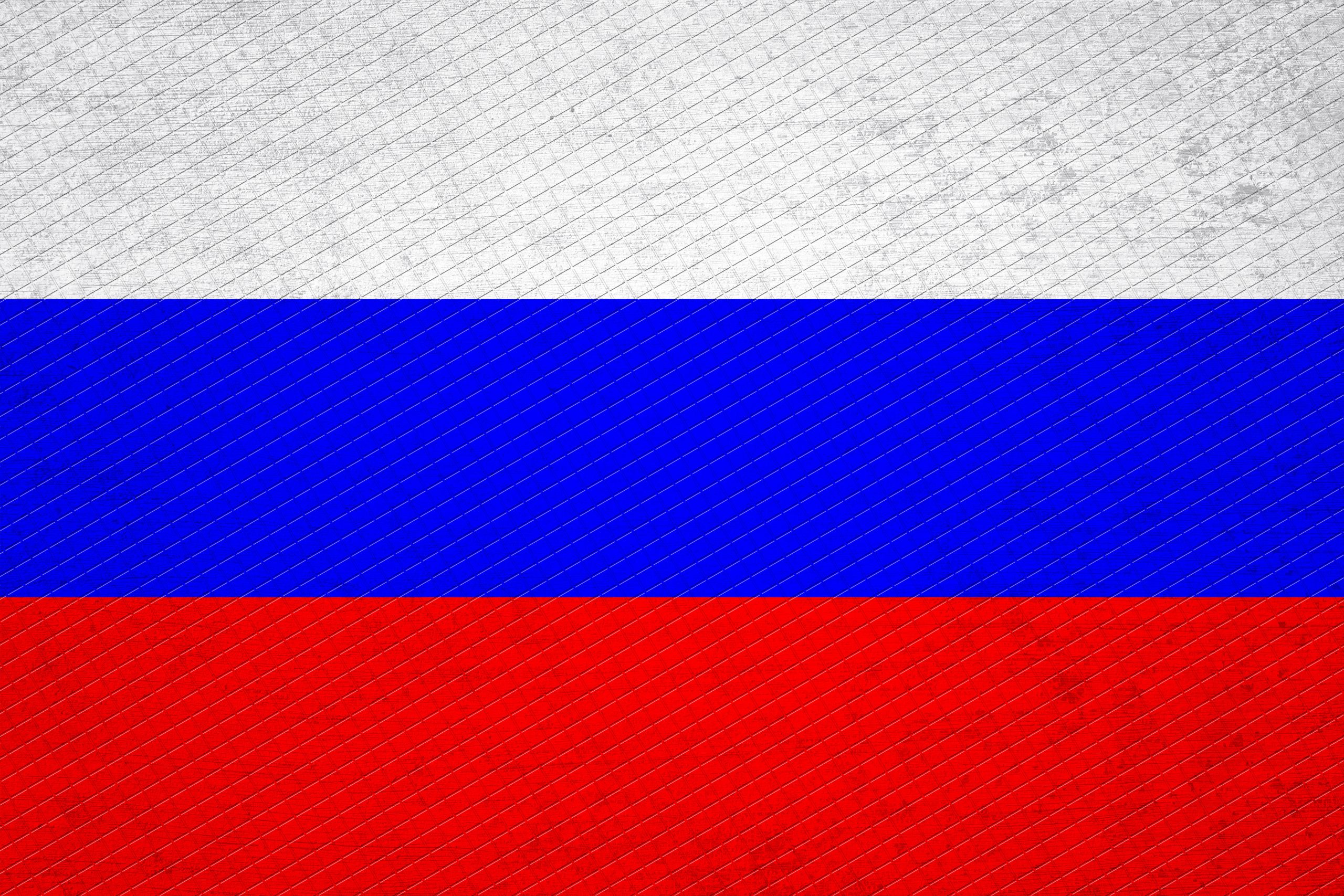
La sémantique de l’offensive chez CNN et BBC
Les agences occidentales traitent le 24 février 2022 comme un point de bascule — une « invasion » pure et simple, préparation méthodique, violation du droit international. Les images affluent rapidement : files de réfugiés, frappes sur Kyiv, cadavres sur les routes de Boutcha. Tout va dans le même sens : l’Ukraine, agressée. On enquête, on expose la violence russe, on enquête sur les crimes — l’« opération » russe n’est dévoilée que comme une offensive sanglante. Les reportages ne cherchent pas à masquer l’horreur ; au contraire, ils en font le cœur du récit.
Des témoignages et des chiffres pour le camp ukrainien
Les unes exposent les douleurs : témoignages d’enfants en fuite, listes de victimes, appels humanitaires. Les sources croissent, se superposent : l’ONU, l’OSCE, Amnesty, croient voir dans le conflit une répétition sinistre des guerres du XXe siècle. Les mots sont tranchants, acérés : « occupation », « bombardements aveugles », « déportations forcées ». Les chiffres dénombrent les victimes, chaque nom devient symbole. Les Occidentaux multiplient les angles, interviewent les survivants — la parole ukrainienne est tirée comme une arme contre l’oubli.
Propagande ou vérité ? Les frontières instables de l’émotion
Mais où finit le fait, où commence le récit ? Les chercheurs avertissent : la surenchère émotionnelle, la focalisation sur la douleur ukrainienne, font aussi partie d’une stratégie. Impliquer le public, rallier à la cause. Ici, la « neutralité » s’effrite ; dans le regard de l’envoyé spécial transparaît la compassion, l’engagement. Les faits sont bien là, mais la scénographie, la dramaturgie de guerre, déforment, parfois. Nul n’est totalement neutre.
Quand la propagande fabrique l’ennemi
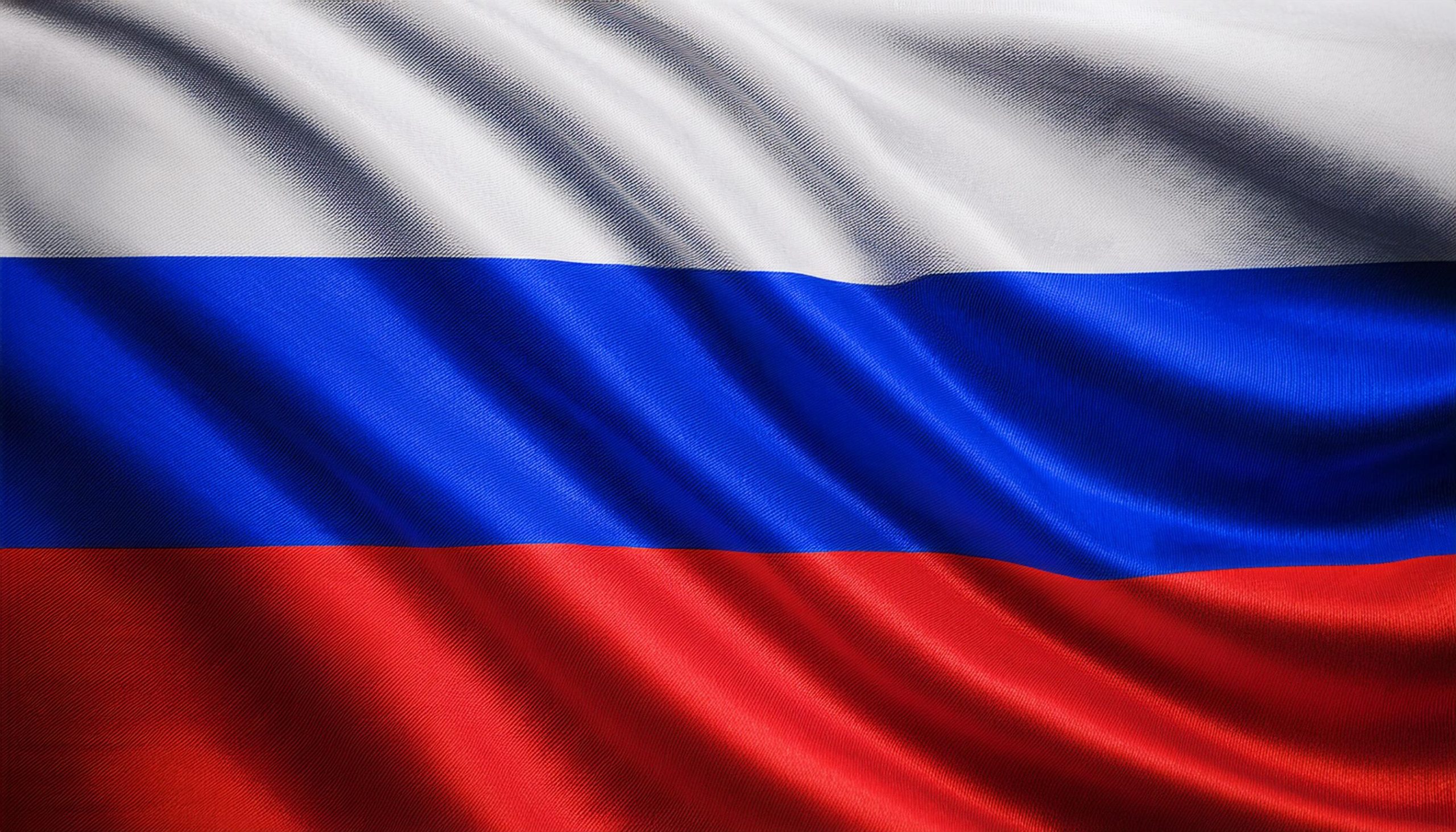
L’inventaire russe : l’« Occident décadent » et l’Ukraine « corrompu ».
Le récit russe, méthodique, qualifie toujours le pouvoir ukrainien de « corrompu ». Cette stratégie, ancienne, rappelle le Grand Patriotic War : aujourd’hui contre Kyiv, la Russie s’érige en rempart du bien. L’ennemi, ce n’est pas le peuple ukrainien, mais une poignée de dirigeants manipulés, odieux, convertis à l’idéologie du mal. Ce trope se décline à l’infini dans les médias contrôlés : chaque massacre perpétré par la Russie n’est qu’un prétexte pour accuser l’autre camp de génocide. Négation, inversion, mimétisme.
L’Ukraine, laboratoire du mensonge pour Moscou
En Russie, nul ne s’offusque : d’après la presse d’État, les civils fuient « l’enfer occidental », accourent vers les armées libératrices. Les exemples foisonnent : vidéos de soi-disant réfugiés heureux, affiches tricolores brandies à la moindre récupération. Parfois, la vérité affleure : quelques rares voix contestent ce manichéisme, mais disparaissent bien vite — un journaliste limogé, un expert réduit au silence, une militante emprisonnée pour « fake news ».
L’Ouest riposte avec ses symboles
Pendant ce temps, la presse occidentale érige ses propres figures : Zelensky, héros moderne, s’oppose à Poutine, tyran classique. Les nouveaux récits saturent TikTok, Telegram, Twitter. Des hashtags pleuvent, des campagnes s’organisent pour soutenir les armes, l’accueil des réfugiés. La machine médiatique, à l’Ouest, s’emballe parfois, oublie de nuancer, précipite la Russie dans le camp du mal absolu. La guerre des images, des cœurs, parfois, remplace la guerre réelle.
Internet, arène mondiale des récits antagonistes
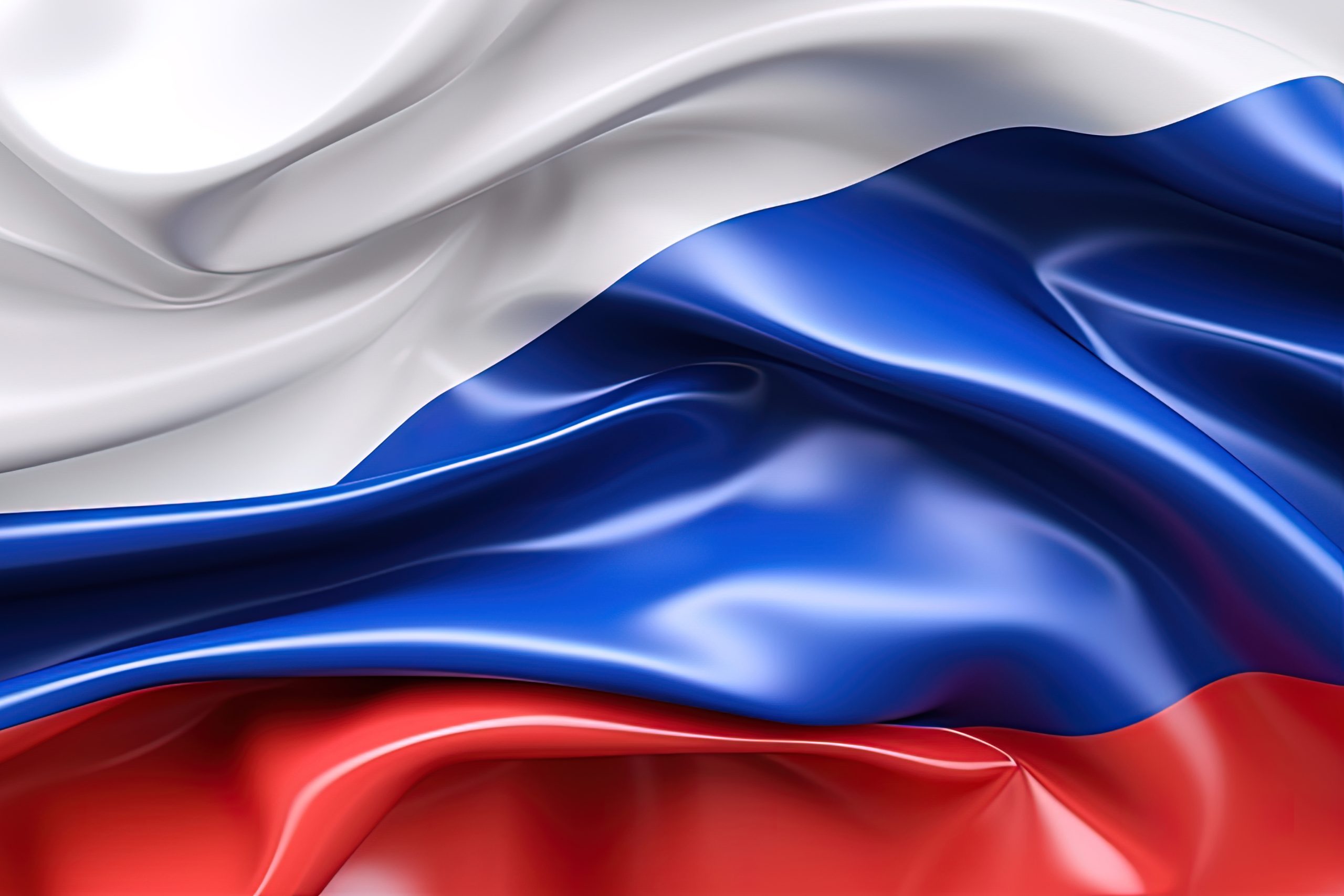
La viralité des fake news selon le Kremlin
Telegram, VKontakte, des groupes entiers diffusent chaque jour l’histoire russe idéale : une mère ukrainienne qui « remercie » ses libérateurs, un soldat qui rend des bonbons aux enfants. L’algorithme amplifie ce qui flatte, conforte, jamais ce qui trouble. TASS et consorts adaptent leur message pour la génération smartphone : le récit long devient mème, le discours officiel se fait gif, snacking. Tout débat est noyé dans le divertissement, chaque réaction amplifie un camp. Plus la guerre dure, plus les versions s’enkystent, inattaquables, devenant vérité numérique.
L’Occident, entre vérification et emballement
Face à la marée russe, l’Ouest riposte par des « debunks » en série : Reuters, AFP, BBC mettent au point des cellules de veille, de vérification. Chaque info russe est décortiquée, chaque photo, géolocalisée puis confrontée à la réalité du terrain. Mais la rapidité du mensonge surpasse toujours la vérification. L’œil se brouille, la fatigue gagne : qui croire après vingt pixels inclinés, une voix off, un soupirage digital ?
L’utopie perdue du fact-check
Malgré les efforts, la rumeur triomphe. Les « vérités alternatives » prolifèrent. Des experts le martèlent : plus personne ne part d’un terrain neutre, tous filtrent la guerre à travers le prisme émotionnel, historique, identitaire. À mesure que la guerre s’enlise, l’objectivité s’effondre ; la vérité semble se dissoudre dans le déluge de versions. Peut-être faut-il l’accepter, cesser de croire à la pureté de l’info.
Les conséquences humaines : le mensonge comme arme du présent

Familles divisées, pays fracturés
La guerre n’est jamais une abstraction. En Ukraine, des familles explosent sous le poids des versions : ici, une grand-mère croit TASS, là, son petit-fils suit la BBC. Les Skype deviennent des champs de bataille, les sms, des ultimatums. La télévision scinde les cœurs, inapte à rassembler. La propagande tue à petit feu, rendant impossible le pardon, parfois même la simple conversation. Les réfugiés portent ce double fardeau : survivre et trier la réalité.
L’exil intérieur, la schizophrénie patriotique
En Russie comme en Ukraine, certains se murent dans le silence, incapables d’adhérer entièrement à un camp. La peur d’être accusé, de passer pour un traître, pousse à l’autocensure. Être victime ou complice — il faut choisir. L’angoisse d’une erreur, de prononcer le mot interdit, griffe les consciences. Les intellectuels, les artistes, fuient ou se taisent : la guerre du récit, c’est aussi la guerre contre la nuance, contre le doute.
Le désespoir comme héritage
Pour les plus jeunes, la guerre ne s’exprime pas seulement par les bombes. C’est un écran qui explose, un feed qui sature de mauvaises nouvelles — toujours contradictoires. Pour eux, la croyance se fait volatil, ironique, blasée. On ne sait plus que penser ; le cynisme prospère. La lassitude remplace la colère, la dépression, l’engagement. Chacun porte sa vérité bricolée, jamais tout à fait crédible.
Épilogue de la guerre des récits : vers une réalité éclatée ?
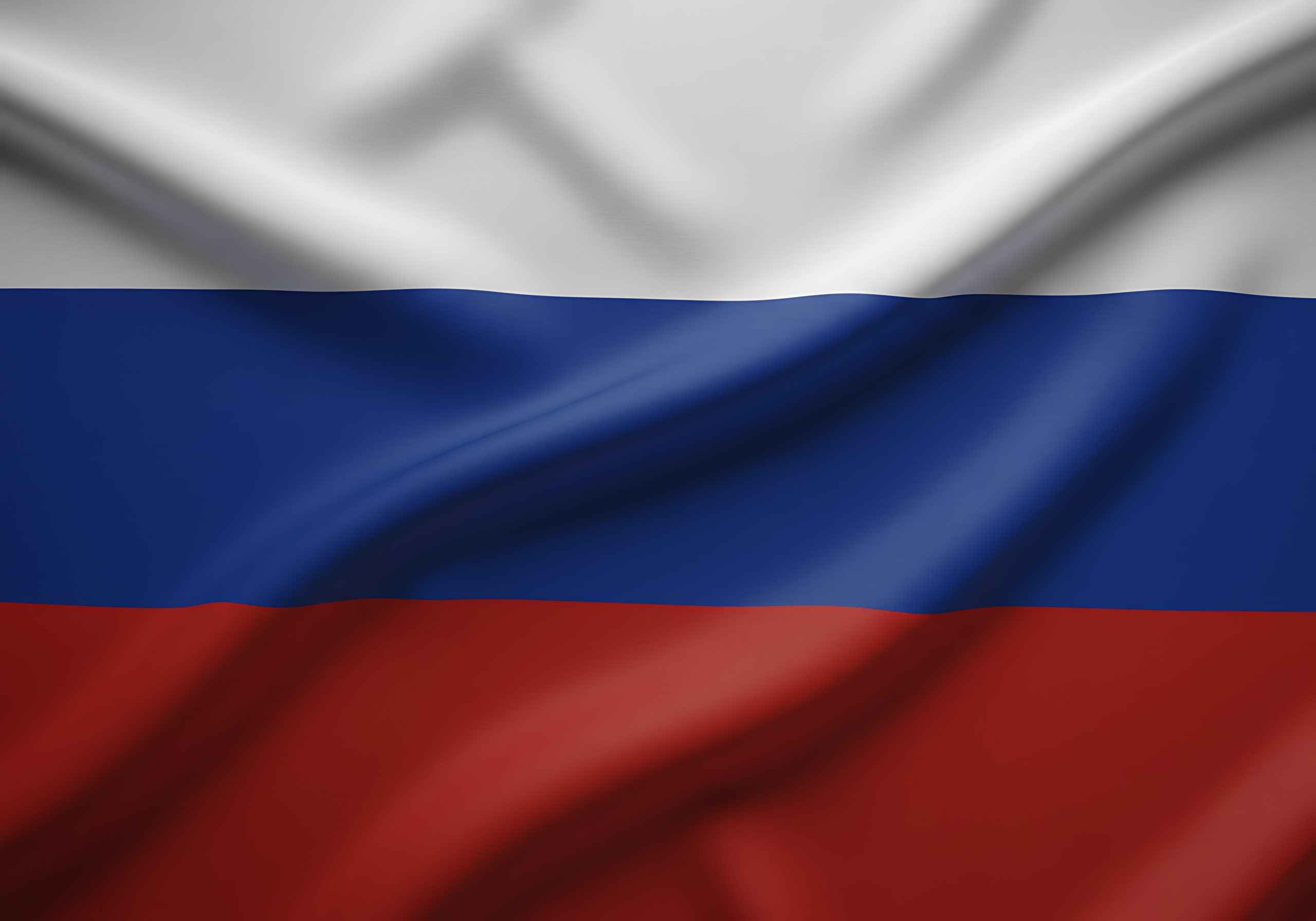
Quand chaque vérité devient suspecte
L’Ukraine et la Russie ont désormais deux récits officiels, deux modes d’existence médiatique, inconciliables. À chaque offensive, le même schéma ; à chaque victoire, deux histoires mémorisées, deux archives futures, deux musées. L’Ouest documente pour l’Histoire, le Kremlin pour la postérité impériale. Les morts, eux, ne raconteront rien. Seuls les survivants, fatigués, véhiculeront encore la mémoire fragmentée, brouillée, éclatée.
Les journalistes, funambules entre deux feux
Personne n’est indemne : même le reporter le mieux intentionné risque la stigmatisation, l’expulsion, voire la mort. Les correspondants à Moscou vivent sous menace, ceux de Kyiv sous la terreur. La vérité coûte cher, parfois la vie. Le courage, c’est de continuer, d’oser encore regarder, confronter, parfois s’humilier devant l’irrationnel.
La résistance du réel — fragile, mais tenace
Au final, la guerre des narrations ne peut masquer indéfiniment le bruit des drones, la crainte de la sirène, la gorge serrée des nuits sans fin. Les images réelles, barbelées de sang, percent parfois l’écran. Cette résistance têtue, c’est l’humain. Malgré le vacarme, la lassitude, l’épuisement, une poignée refusent le mensonge total. Heureusement, peut-être, la mémoire triomphera, non pas dans le fracas, mais dans la persistance du doute.
Conclusion : qui remportera la guerre des mots ?
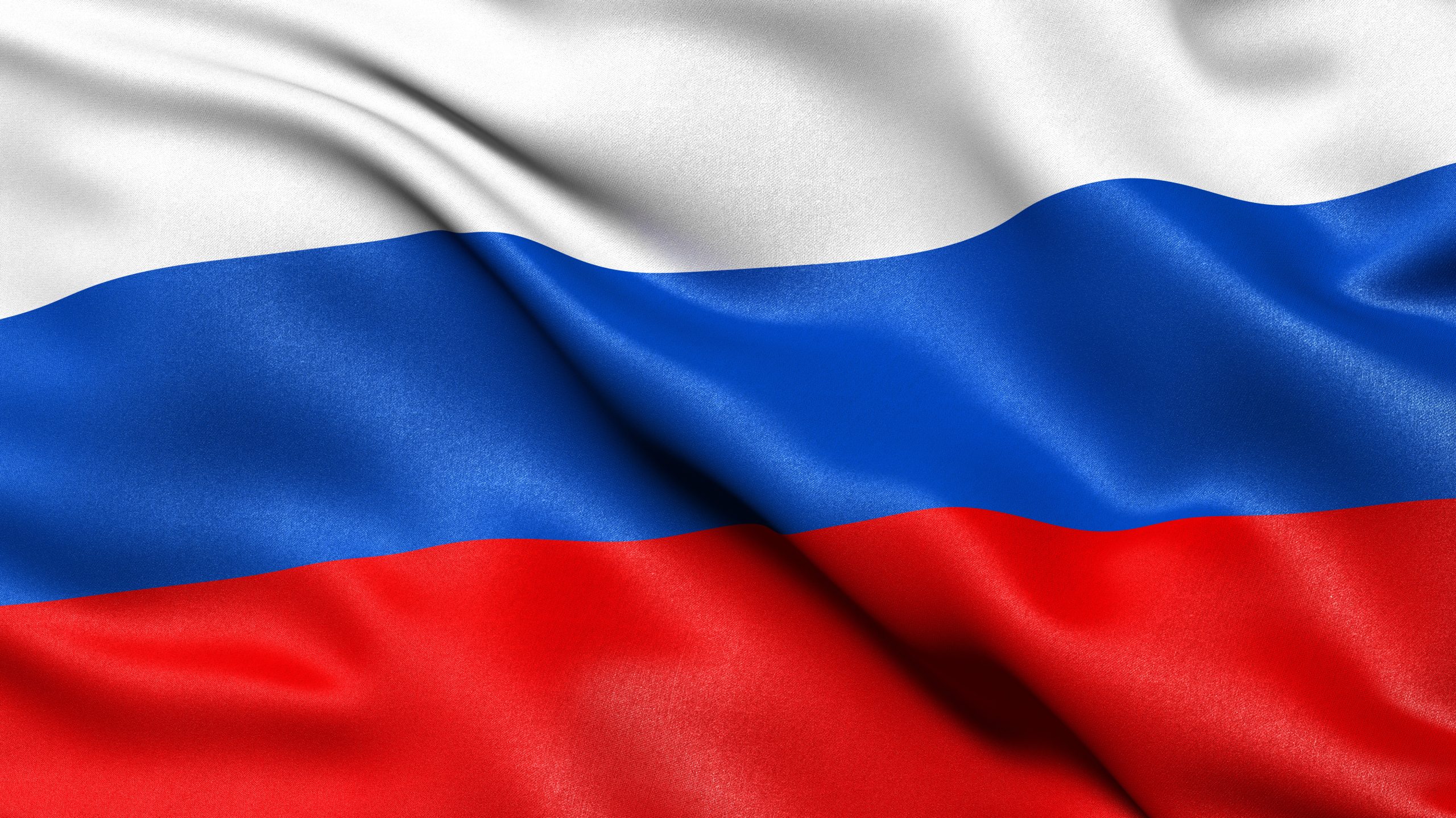
Entre délivrance et conquête, l’ambivalence fatale
Personne ne sort indemne de la guerre des récits. Les Russes continueront à parler de libération, les Occidentaux à dénoncer une invasion. Le journalisme, perdu entre deux foyers, tente, avec maladresse, de rétablir une image plus nette, mais échoue, inévitablement, à ramener l’évidence sur la table. L’histoire, plus que jamais, appartient à ceux qui la racontent — ou la tordent. Et chaque camp retranche un peu plus sa part d’humanité dans l’absolu de sa conviction.
À la recherche d’un terrain commun
Tant qu’il y aura deux mondes, deux versions irréconciliables, la paix demeurera une chimère lointaine, prête à être piégée par le prochain slogan, la prochaine salve de mots. Mais quelque part, j’aime croire qu’une poignée d’individus, modestes, opiniâtres, chercheront toujours la vérité, même morcelée, même cruelle. La mémoire humaine n’est pas un bloc, elle est mosaïque, incertaine, fragile — et c’est sa plus grande force.
Ultime conviction : narrer, encore, malgré les mirages
Si je termine, émietté, parcouru de doutes, c’est que cette guerre m’aura appris une chose : le vrai combat se joue dans chaque syllabe, chaque phrase, chaque hésitation. Continuer à écrire revient à refuser la défaite du sens. Les mots ne sauveront pas la paix, mais, peut-être, empêcheront-ils l’oubli. Alors j’avance, hésitant, sur cette ligne de crête, armé d’une obstination maladroite, et du refus entêté de me réjouir du confort des certitudes.