
Des années de gloire en brume de fioul
L’Amiral Kouznetsov trône depuis les années 90, vaisseau fantôme oscillant entre mythe et ruine. Sur le papier, il devait rivaliser avec les géants américains. Sur l’eau, il n’offrait qu’épaisse fumée noire et remorqueurs de secours inlassables. Un jour, la mer l’avale ; un autre, il s’étouffe dans ses propres tuyaux. Entre ses missions en Syrie, marquées par la perte de deux chasseurs, et ses longues années d’immobilisation dans le port, les promesses fondent, les illusions rouillent. Difficile de ne pas sourire jaune quand le mythe de la résilience militaire russe s’étiole sous le regard du monde, rendant chaque retour espéré plus mirage que miracle.
Foudroyé par les incidents techniques, des incendies à répétition, des chutes de grues lui cisaillant la coque, la bête de 300 mètres semble téléguider sa propre démolition. Les tentatives d’éveil s’épuisent : une génération d’ingénieurs s’acharne, le Kremlin s’entête, mais les coûts s’envolent, les délais s’étirent comme l’ombre du passé soviétique. L’Amiral, trop grand pour sombrer discrètement, entraîne avec lui la crédibilité d’une flotte nucléaire révolue.
Voici encore quelques mois, la propagande battait son plein, exhibant une coque repeinte, une escadrille de MiG fictive prête à décoller. Mais la réalité démolit la fiction : absence d’équipage qualifié, talents dissous loin des chantiers, fuite des cerveaux navals. Les blagues sur la Marine russe mutent en sarcasmes acérés, car pour la première fois depuis la chute de l’URSS, Moscou n’a plus de véritable porte-avions en ligne. Reste le symbole : vaincu, pathétique, immense.
Le gouffre financier de Mourmansk
Chaque chantier du Kouznetsov est un puits sans fond. Budgets explosés, ambitions recalibrées, expertises épuisées, on croirait observer la Russie contemporaine en miniature. Les responsables reconnaissent à demi-mots l’immense gâchis, incapables de trancher entre la casse et une réparation toujours repoussée. Les sommes englouties frôlent l’absurde pendant que la misère technique s’aggrave. Il y a des moments où l’on s’interroge sur la pertinence d’une telle persévérance – ou sur le désespoir de devoir enterrer un pan entier de puissance militaire, faute de relève crédible.
À chaque accident industriel, à chaque réparation mal accomplie, c’est un coup de massue sur le prestige russe. Pourtant, le projet de démantèlement n’est annoncé qu’à demi-voix, entre deux déclarations contradictoires. L’État, pris dans ses propres injonctions stratégiques, s’interdit un aveu public – comme si le Kouznetsov, mauvais élève, devait rester un vestige vivant pour le salut de quelques égos suprêmes.
L’argent manque, mais la posture persiste. C’est cela, l’ironie de Mourmansk : le chantier gronde, les politiciens s’agacent, les ouvriers maugréent, et la coque pourrit au gré du temp. Aucun remplaçant sérieux, aucune relève. Étrange ballet post-soviétique : on maintient en vie la dépouille du colosse, on feint d’envisager le retour, on repousse la vérité à demain.
Équipage évaporé, tradition éteinte
Pendant que l’immobilisme ronge le développeMment de la flotte, l’humain se dissipe : les vieux loups de mer, rompus aux manœuvres du Kouznetsov, sont partis. Les plus jeunes, sacrifiés pour d’autres théâtres ou d’autres navires, n’ont jamais touché le pont traître du vaisseau en perdition. La culture du porte-avions s’évapore, laissant le commandement sans bras ni mémoire.
À l’heure du choix, la Russie hésite encore à jeter son dernier fétiche par-dessus bord. On se souvient des discours exaltés des années Poutine, des rêves de flotte océanique, tous engloutis dans la routine bureaucratique. Les compétences se perdent, la relève n’est plus formée. C’est une extinction douce de l’aéronavale, étouffée dans son propre silence.
On imagine, non sans amertume, ce que doit ressentir un marin russe : rêver d’horizons lointains et se retrouver prisonnier d’un quai, rouillant dans l’attente d’une décision qui ne vient pas. L’Amiral, naguère école de prestige, flotte désormais comme un musée des désillusions, vestige d’une épopée sans équipage.
Mémoires charbonneuses : l’héritage du naufrage russe
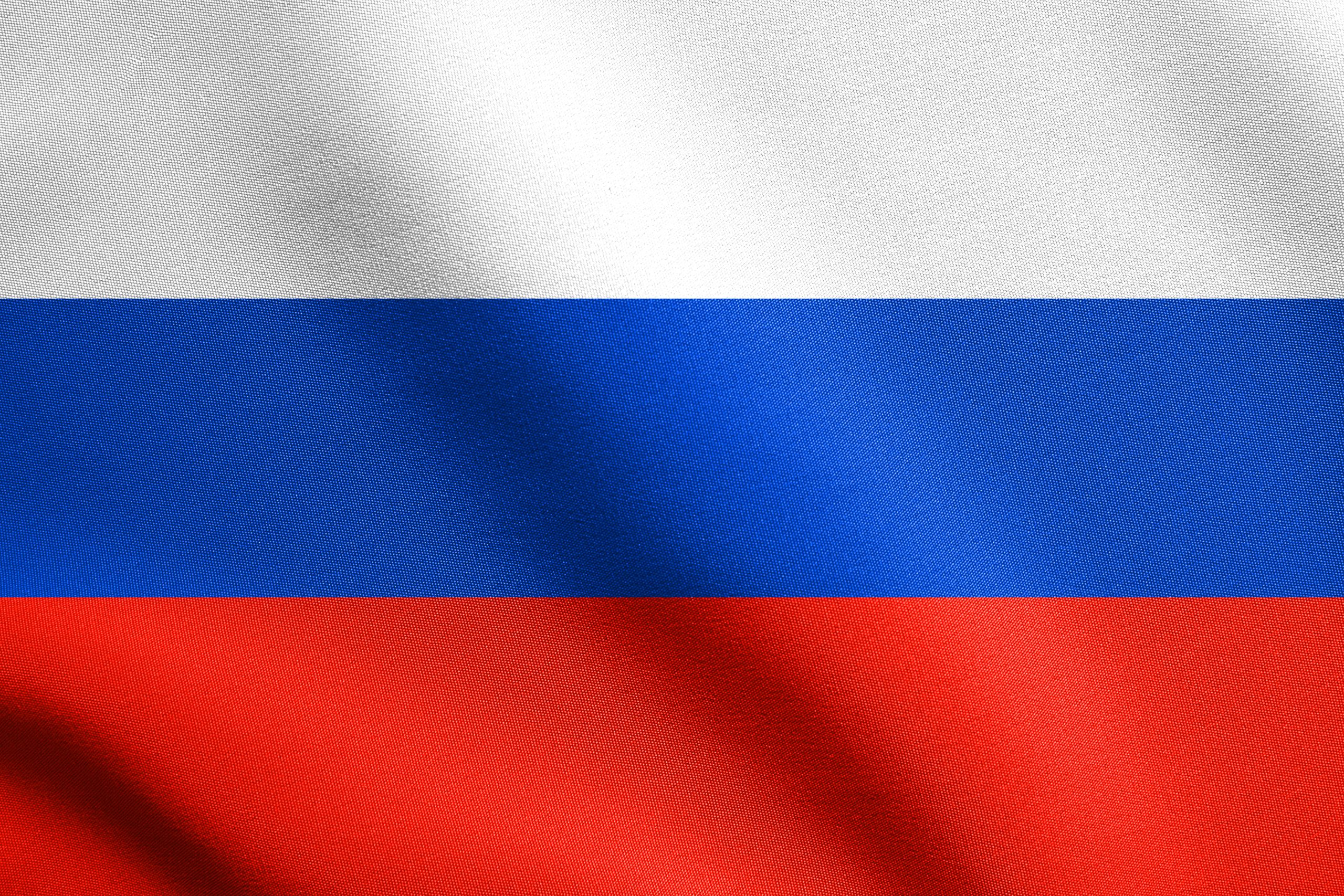
Une histoire de promesses brûlées
Le Kouznetsov, dès sa conception, portait les stigmates de l’indécision. À la charnière des empires, conçu en Ukraine, achevé tant bien que mal par la marine russe, il symbolisait à lui seul la transition impossible vers la modernité. Naviguer sous pavillon russe alors que la Russie vacillait entre grandeur et dégringolade constituait, pour chaque marin, une réalité huis clos où l’on croyait sans rêver, où l’on naviguait sans avancer.
Sa première sortie, spectacle de puissance lézardée, n’avait rien d’impressionnant face aux standards occidentaux. Rouille, moteurs défaillants, consommation gargantuesque, manque d’avions fiables… chaque traversée était un défi, chaque réparation un éditorial. Derrière l’apparence martiale, l’épuisement technique transpirait déjà : pièces manquantes, improvisations honteuses, système D érigé en doctrine.
Hors de question, pourtant, d’admettre l’échec. Mythes et légendes, narrations officielles et orgueil national, chaque étape du Kouznetsov fut vendue comme un exploit. Le prestige, fragile, tenait à un fil, celui du mensonge tactique. Mais nulle propagande ne résiste à l’usure. Prolonger la légende, c’est un peu se condamner à nager dans le goudron.
Catastrophes en cascade, héroïsme absent
L’accumulation d’incidents aurait pu faire l’objet d’une série télévisée à succès : explosions, effondrements, feux incontrôlés, crashs d’appareils, chutes de grues sur le pont. À peine remis, déjà de nouveau mutilé. C’est la face la plus grotesque du récit russe : proclamer la supériorité tout en accumulant la débâcle.
L’équipage, loin de dénoncer les conditions catastrophiques, a souvent dû composer avec l’indicible : veiller sur un navire à demi-mort, s’entraîner à la survie plutôt qu’au combat, subir l’incertitude comme stratégie. Les erreurs, l’usure, l’absence de réels protocoles de sécurité sur les chantiers ont achevé de transformer un colosse en risée mondiale.
Victorieuse de la propagande, la fatalité industrielle s’invite sur le pont. Ce n’est plus la puissance du navire qui impressionne, mais la fréquence de ses catastrophes. Là où certains pays investissent dans l’excellence technique, la Russie s’est enfermée dans sa gloire passée, refusant d’admettre la faiblesse.
Entre cassure et fuite en avant
Le commandement militaire oscille désormais entre résignation froide et aveuglement stratégique. Certains hauts gradés appellent à jeter le Kouznetsov à la casse, arguant l’obsolescence criante d’une plateforme inadaptée aux armes modernes. D’autres rêvent encore d’un retour miraculeux, d’une modernisation qui ne viendra sans doute jamais.
Au fond, la vraie cassure est psychologique : le Kremlin, mastodonte englué dans son propre mythe, préfère dépenser sans compter pour sauver l’apparence, quitte à sacrifier la réalité opérationnelle. Loin des grandes manœuvres, les marins, eux, n’y croient plus — ils sont ailleurs, ont déserté ou se murent dans une attente sans espoir.
La Russie semble incapable de renoncer à son rêve de flotte de haute mer. Mais rêve-t-on vraiment quand tous les signaux crient le contraire ? Entre l’illusion d’avenir et l’acceptation du gouffre, le Kouznetsov finit par incarner cette Russie qui refuse la nuit, qui ne sait pas, ou ne veut pas, lâcher prise.
Porte-avions, arme dépassée ?

Les voix se divisent au sommet
L’obsolescence des porte-avions conventionnels fait l’objet d’un débat acharné, en Russie comme ailleurs. Certains amiraux, nostalgiques d’une ère de domination océanique, s’accrochent à l’idée de navires géants accompagnés de leur aviation embarquée. D’autres, plus lucides ou cyniques, estiment que, à l’ère des missiles hypersoniques et des drones kamikazes, la priorité doit aller à d’autres technologies.
Le trajectoire du Kouznetsov résume ce combat générationnel : faut-il sauver une icône, ou changer de paradigme ? En l’absence de budget, la question devient torture : impossible d’avancer, inadmissible de reculer. Pendant ce temps, la flotte russe s’appauvrit, prisonnière d’un héritage devenu boulet.
Les exemples étrangers ne manquent pas : Chine, Inde, Etats-Unis modernisent, mais investissent massivement ou repensent leur doctrine. La Russie, elle, s’enferme dans son débat interne, niant la réalité financière et technologique. Discipline navale ou orgueil national ? La fracture n’a jamais été aussi nette.
Dissensions publiques et privées
Le débat s’exprime à voix basse mais il existe : les chefs d’état-major, les responsables industriels, les politiques et les experts se renvoient la balle. Chacun sait que la survie du Kouznetsov relève désormais de la construction du mythe, non de la réalité opérationnelle.
Certains misent sur le remplacement pur et simple : embarquant le navire vers la casse, économie d’échelle et réallocation des ressources obligent. D’autres prônent au contraire la résistance symbolique, espérant qu’une solution miracle ou une embellie budgétaire permettra de relancer un programme de modernisation moribond.
Il est rare qu’une telle division soit aussi palpable dans les sphères du pouvoir russe. On la sent, on la devine, chaque sortie publique résonnant comme une confession à demi-voix. Abandonner le dernier porte-avions, c’est avouer l’impuissance d’une ambition vieille de plusieurs décennies.
Face aux flottes étrangères, la comparaison blesse
Il suffit d’un regard de côté, d’une lecture froide des chiffres, pour comprendre le fossé qui s’est creusé. Pendant que la France, les États-Unis, la Chine ou l’Inde renouvelaient leurs arsenaux, la Russie puisait dans ses réserves, réparant, rafistolant, espérant faire illusion avec le strict minimum.
Le contraste est cruel : d’un côté, une flotte vieillissante, des équipements à bout de souffle, des équipages dispersés. De l’autre, des puissances rivales, à l’abri de l’usure et du manque de moyens. Loin d’incarner un pôle de stabilité, la flotte russe oscille désormais entre nostalgie et bricolage.
C’est là toute la singularité d’un pays qui se veut géant mais voit sa flotte rétrécir comme une peau de chagrin. La puissance navale n’est plus affaire de prestige mais de technologies et d’équilibres financiers. À ce jeu-là, le Kouznetsov n’est plus qu’une mauvaise blague.
Modernisation suspendue, ferraille ou miracle ?
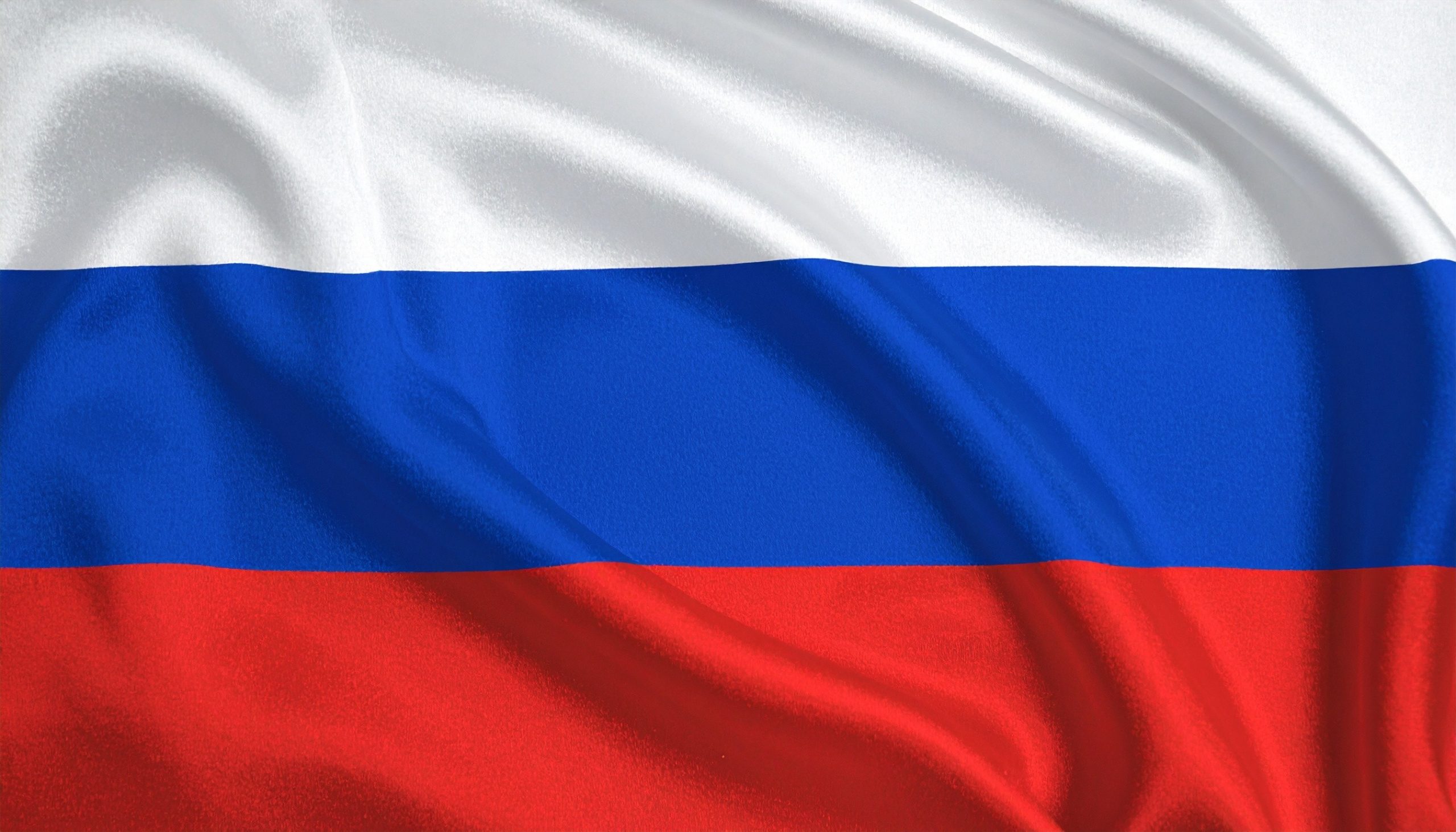
Le chantier mis en pause
La nouvelle a été confirmée : les travaux de modernisation du Kouznetsov sont suspendus. Officiellement, il s’agit d’une « pause administrative ». Pourtant, ceux qui suivent le dossier savent bien que la réalité est plus brutale. Les caisses sont vides, les compétences envolées, et personne ne se bouscule pour reprendre un chantier à la fois risqué et vain.
L’inefficacité du chantier, la corruption, la pénurie d’ingénieurs qualifiés… chaque anomalie est documentée, chaque retard se transforme en monument d’incapacité. Pendant ce temps, les responsables tentent de rassurer, mais ne convainquent personne – pas même les marins, pour qui un retour en service paraît plus improbable chaque mois.
Les promesses de réouverture du chantier n’engagent que ceux qui y croient encore. Quant à savoir si la coque du Kouznetsov sera un jour apte à reprendre la mer, même les plus optimistes se taisent. C’est un naufrage à huis clos, une débâcle soigneusement étouffée.
Scénarios envisagés : vers la casse ?
La question du désarmement du Kouznetsov n’est plus taboue. Plusieurs responsables militaires évoquent ouvertement la possibilité de l’envoyer à la casse, ou de le transformer en cible flottante pour exercices de missiles. D’autres suggèrent de le maintenir en vie, pour des raisons purement symboliques, jusqu’à la construction hypothétique d’un successeur.
Aucun projet concret de remplacement n’a émergé : les études sur un programme de porte-avions de nouvelle génération (Projet Shtorm) n’en sont qu’au stade de la projection, sans financement adéquat ni calendrier précis. On bâtit des châteaux de cartes, quand il faudrait reconstruire des arsenaux entiers.
Les experts russes, partagés entre pessimisme et cynisme, redoutent que la Russie ne bascule dans un vide capacitaire durable, incapable de suivre la cadence des grandes flottes mondiales. Au final, la casse du Kouznetsov serait moins une tragédie qu’un soulagement.
Derniers sursauts stratégiques
Certains généraux et analystes argumentent que la Russie ne peut se permettre de rester sans porte-avions, fût-il obsolète, au regard du positionnement international et de la doctrine navale en vigueur. Pour eux, maintenir le Kouznetsov, c’est préserver une forme d’équilibre régional, voire un levier diplomatique, malgré l’évidence des faiblesses techniques.
La pression monte, entre ceux qui veulent fossiliser la mémoire du navire et ceux qui réclament sa liquidation. Tous s’accordent en revanche sur une réalité : seule une révolution industrielle (ou une embellie budgétaire fantasmée) pourrait relancer un jour l’aventure d’un nouveau porte-avions.
Candide ? Peut-être. Mais la Russie n’a pas d’autre choix que d’inventer une nouvelle voie, faute de quoi elle s’évanouira définitivement de la scène navale mondiale. Entre la peste de l’obsolescence et le choléra du vide, il faut choisir le moindre mal.
En quête d’alternatives : la Russie dos au mur

Successeurs incertains
Face à la possible mise hors service du Kouznetsov, les regards se tournent vers le futur : la Russie développera-t-elle un nouvel appareil à la hauteur de ses ambitions ? Le projet Shtorm, lancé sans être véritablement financé, ressemble aujourd’hui à une forêt de PowerPoint, sans aucun morceau d’acier sur cale.
L’absence de calendrier, l’incertitude du financement, la pénurie d’ingénieurs et de marins d’expérience… Tout s’oppose à la concrétisation rapide d’un programme de remplacement. Certains songent même à acheter des avions de chasse navalisés à la Chine ou à développer des modules embarqués, faute de mieux.
Dans l’immédiat, la flotte russe redevient ce qu’elle était il y a cent ans : côtière, réactive en zone régionale, incapable de menacer les grandes puissances sur les océans du monde. La boucle est bouclée, la page tournée dans l’angoisse.
Questions sur l’avenir aéronaval
Sans porte-avions, la Russie ne pèsera plus sur les équilibres régionaux ni sur la capacité de projection militaire globale. Le risque est double : subir l’encerclement stratégique par l’OTAN, perdre l’influence dans les zones disputées (Arctique, Méditerranée, mer Noire).
Peut-on compenser ce vide par du développement dans les armes robotisées, les missiles hypersoniques, les drones de nouvelle génération ? Les experts en doutent, d’autant plus que la Chine, voisine et concurrente, investit massivement dans tous ces programmes – y compris les porte-avions les plus modernes.
La Marine russe, consciente du défi, tente bien maladroitement de rassurer l’état-major : « Le prestige ne compte plus que si on le mesure à coups de missiles balistiques », ironise un expert. Mais aucun missile n’efface l’absence criante d’une vision claire pour l’avenir.
Options à l’étude : patchs du désespoir
Parmi les solutions envisagées, on parle d’acheter des chasseurs embarqués J-35 ou KJ600 chinois. D’autres rêvent d’une version navalisée du Su-75 « Checkmate » par Sukhoï. Fuite en avant ou véritable stratégie ? Difficile de trancher tant le manque d’argent, de moyens humains et de volonté politique bloquent tout progrès réel.
Le modèle espagnol, qui modernise son aéronavale sans porter la charge des porte-avions classiques, inspire certains responsables. Peut-être la Russie y trouvera-t-elle une forme de salut, à condition de repenser toute la doctrine, tout l’arsenal, tout ce qu’elle croyait inaltérable.
En attendant, les décisions se prennent à la marge. On bricole, on colmate, on attend le miracle – ou le grand effondrement. L’immobilisme prévaut, la lenteur devient culture.
Lourdes pertes pour le statut russe
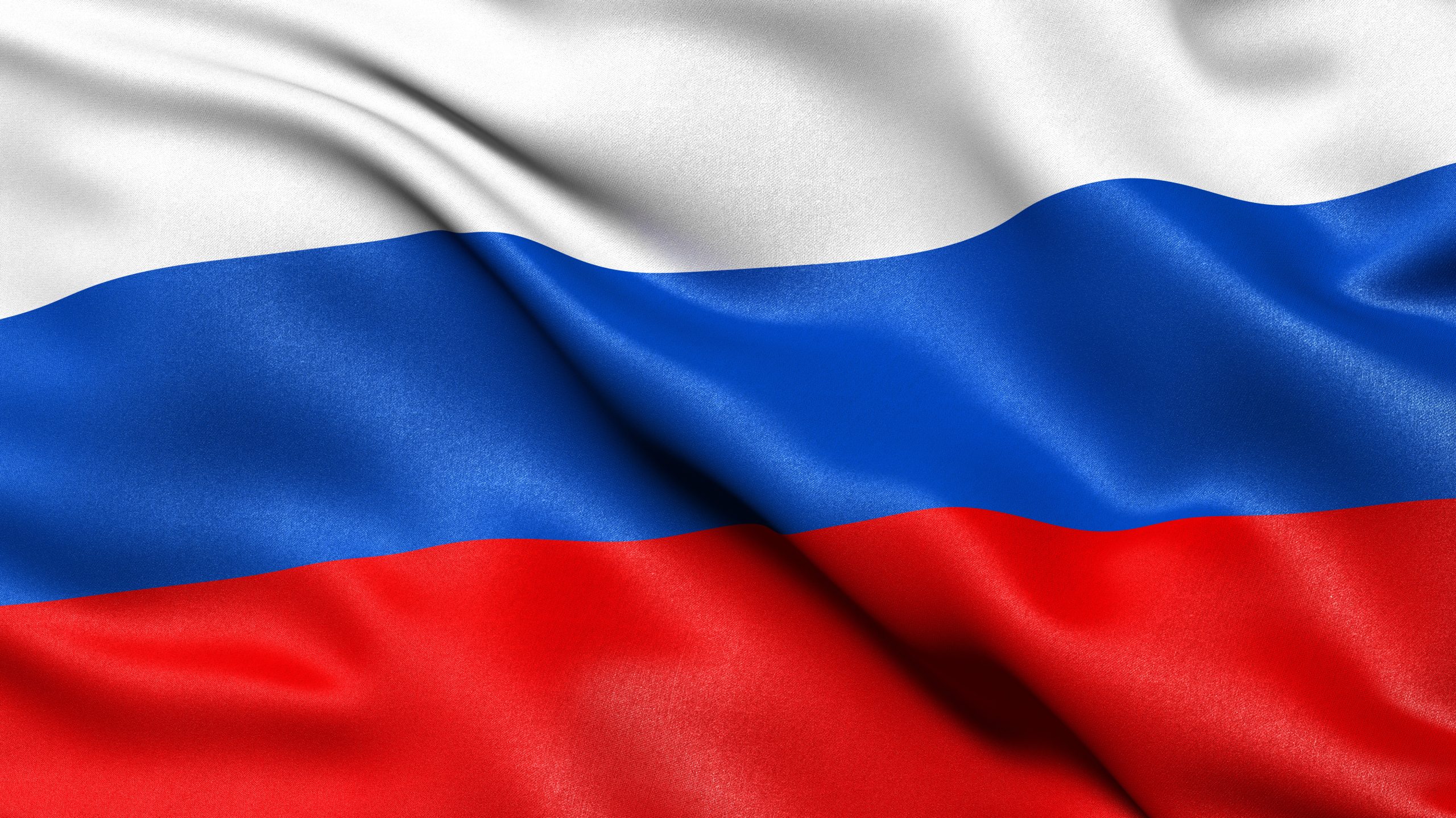
Rayonnement dilué sur la scène internationale
Avec la probable disparition du Kouznetsov, la Russie se retrouve privée de l’un de ses principaux outils de projection de puissance. Sur la scène internationale, ce recul est significatif : plus moyen d’impressionner, plus d’espace pour s’affirmer face aux flottes européennes ou asiatiques.
Ce qui était insupportable pour Moscou hier – une flotte réduite à ses seules fonctions côtières – devient aujourd’hui une triste réalité. Le rêve impérial s’effrite, chaque quai vide devenant le miroir d’une ambition qui s’évapore.
Confrontée à cette perte de statut, la Russie tente de surjouer ses succès ailleurs – en Ukraine, dans l’espace, sous l’eau – mais elle ne peut plus dissimuler le vide stratégique laissé par l’absence d’un porte-avions. La force redevenue fantôme.
Puissance régionale, impuissance mondiale
Ce nouveau statut de puissance moyenne, assigné plus par la défaillance que par le choix, pose un problème existentiel à la doctrine russe. Pendant que d’autres nations grimpent dans le classement, la Fédération rétrograde, contrainte de revoir à la baisse ses exigences, ses rêves de grandeur et son influence sur ses alliés.
La perte d’autonomie stratégique est la conséquence la plus dangereuse de l’affaire Kouznetsov. L’équilibre régional, la crédibilité vis-à-vis des alliés (et des adversaires), tout s’en trouve compromis. Rares sont ceux qui osent le dire, mais dans les bureaux feutrés des états-majors, l’angoisse transparaît.
Redevenir une puissance régionale, c’est abandonner la capacité d’intervenir partout, tout le temps. C’est accepter que la carte du monde se réduit à ses frontières immédiates. Un aveu d’impuissance, pour un pays qui a toujours prétendu façonner le globe, et dont le rêve d’océan se noie dans le gel de l’Arctique.
Remise en cause de la doctrine navale
À Moscou, le débat fait rage sur la doctrine elle-même : faut-il réformer, s’adapter, ou s’obstiner ? Certains fantasment sur un redéploiement massif de sous-marins et de systèmes de défense côtiers, d’autres sur une renaissance à la soviétique, mais sans l’argent ni les hommes.
Le Kouznetsov aura au moins eu cette vertu : mettre tous les paradoxes en lumière. L’impasse est totale – stratégique, financière, industrielle, symbolique. Il n’y a plus de solution miracle, seulement des compromis douloureux.
Dans l’entre-deux, la Russie se cherche, tâtonne, s’effraie parfois d’elle-même quand elle mesure l’ampleur de ce que la mer lui arrache : leadership, influence, rayonnement.
Conclusion – Le mythe amputé : Moscou face à son déni
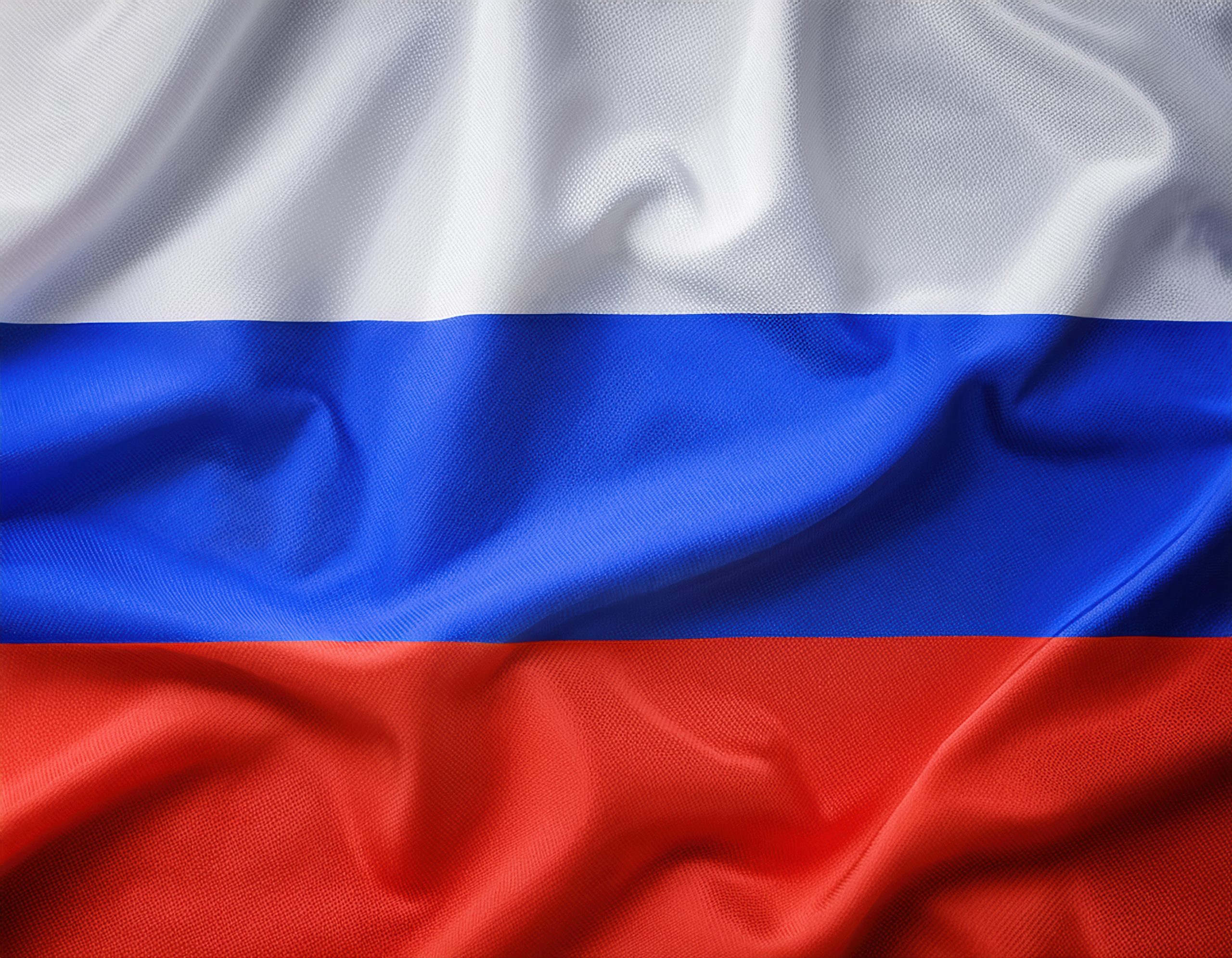
Dépossédé de son fleuron
La fin du Kouznetsov marque un passage brutal : la Russie doit se réinventer ou renoncer au monde des grands, accepter sa vulnérabilité puis recréer, dans la douleur, une vision crédible pour son avenir naval. L’heure n’est plus à l’illusion. Entre promesses d’experts et renoncements masqués, Moscou sent le vent tourner, la grâce s’évaporer.
Ce navire, jadis fierté indiscutée, subit un épilogue humiliant, laissant la Russie nue, exposée à son propre déni. Abandonner le Kouznetsov, c’est plus qu’une défaite militaire : c’est la fin d’un cycle, la translation d’un pays vers un nouvel inconnu, ce point de bascule où il faut choisir entre le souvenir et le progrès.
Derrière chaque rideau de vapeur, chaque linceul d’acier, la réalité s’impose. Ce n’est pas la force qui fait la puissance longue durée, mais la capacité à se renouveler, à admettre ses faiblesses, à bâtir sur du neuf plutôt que maquiller l’ancien. L’Amiral sombre, le futur doit naître ailleurs, sans boucle ni mensonge.