
L’argent coule-t-il dans les veines du conflit ?
Chaque matin, les chiffres me giflent, dans la lumière froide des communiqués. Le coût d’un tank, le salaire d’un fantassin, le rouble qui tangue, l’euro qui boude. Depuis trois ans, la Russie fait tenir l’incroyable machine de la guerre en Ukraine, moteur à essence noire, pétrole, gaz et liquidités. Ils sont là, les experts, obsédés par le détail, par la colonne « recettes », par la colonne « dépenses ». Mais la véritable question, je la sens en moi, profonde, viscérale : jusqu’où ce pays immense, coupé du monde occidental, pourra-t-il injecter du carburant dans une guerre qui n’en finit plus ?
Une fatigue économique sous l’uniforme
Au fil des mois, la Russie militarise tout. Les hôpitaux se vident pour accueillir les blessés, les écoles pour former en urgence, les usines pour mouler l’acier des canons. Les salaires des soldats, les primes, les pensions sont devenus le nerf d’un budget souffreteux. Et la tension monte, palpable, dans chaque foyer, chaque entreprise russe. L’ambiance sent le fer, la sueur, l’incertitude, la peur d’une énième ponction ou d’une gigantesque perte. Et derrière le rideau, l’inflation mange les économies, tandis que Moscou jure que la croissance perdure — alors que les faits, eux, racontent tout le contraire.
Pétrole contre bombes : la grande équation russe
Oui, la Russie vend encore son pétrole, son gaz, à l’Europe, à l’Inde, à la Chine. Ces flux — scandaleux, persistants, malgré les vingt-trois trains de sanctions successifs — irriguent le budget d’une Fédération qui a structurée sa survie sur l’énergie exportée. Trois fois plus de revenus d’hydrocarbures que d’aide à l’Ukraine : c’est la vérité nue. Mais ces milliards suffisent-ils à compenser l’exode massif des cerveaux, la glaciation de l’innovation, les files d’attente devant les distributeurs ? À chaque confirmation chiffrée, une question lancinante : ce modèle, dévoré par la guerre, tient-il sur la distance ?
Explosion du budget militaire : quand la défense mange tout

Les milliards du fond souverain s’étiolent
Les chiffres claquent comme des balles. 40 % du budget fédéral russe est englouti dans la défense. Un record historique — 5 200 milliards de roubles, pulvérisant toute logique budgétaire antérieure hors temps de guerre. Résultat : la Russie a déjà cramé 90 % de son déficit annuel prévu dès le printemps 2025. Les économistes s’affolent. Ces dépenses colossales saignent le fond souverain (le Fonds national de prospérité), désormais presque vidé, et menacent la stabilité de tout le reste : administration, retraites, santé, infrastructures. Un pays qui coupe tout pour payer ses canons, un modèle impossible à soutenir s’il fallait durer encore des années.
L’inflation et le rouble qui soufflent le chaud et le froid
Sur les marchés, le rouble vacille. L’inflation a dépassé les 10 %, mangé, rongé le pouvoir d’achat. Le taux officiel est contesté partout — certains avancent 15 %, voire 18 %. La banque centrale, acculée, relève brutalement ses taux d’intérêt, à plus de 21 %, pour espérer sauver ce qui peut l’être. Mais le crédit fond comme neige au soleil. Les ménages s’appauvrissent, le commerce s’essouffle, les investissements privés cessent. Moscou compense en injectant des subventions, mais l’effet est limité, trompeur. Les frontières fiscales, bien qu’étirées, finissent par casser : le budget s’effondre sous le poids de la guerre, invisible dans les chiffres publics, visible dans toutes les cuisines russes.
Un appareil économique paralysé par la mobilisation
La mobilisation a certes maintenu un faible taux de chômage — proche de 2 %, artificiellement, car une armée mobilisée n’est pas une armée active économiquement. Mais, dans les usines, sur les routes, dans les campagnes, les bras manquent. La Russie détourne une jeunesse précieuse, bourre les casernes, siphonne la main-d’œuvre de l’économie productive. L’industrie, centrée sur la défense, sacrifie le civil, la modernisation, les services, tous en berne. Le pays vit en état de siège économique, une « surchauffe » vite retransformée en panne sèche, qui appauvrit et détériore l’avenir pour gagner quelques semaines supplémentaires au front.
Les recettes énergétiques : la perfusion encore vivante

Pétrole et gaz : les robinets jamais vraiment fermés
Surprise, contradiction des sanctions occidentales : malgré tout, le gaz russe continue d’arriver en Europe, via la Turquie et d’autres pays, parfois en quantités plus importantes qu’avant la guerre. Les recettes du secteur, bien qu’en légère baisse, représentent encore plus de 60 % des exportations russes et près d’un tiers des revenus fédéraux. Les derniers chiffres sont clairs : début 2025, la Russie reste le premier exportateur de gaz naturel liquéfié vers l’Union européenne, et consolide ses parts de marché via la Chine et l’Inde. C’est ce socle énergétique qui empêche, pour l’instant, l’écroulement brutal du système.
Les sanctions, un effet différé et limité
Si les sanctions ont réduit les profits de Gazprom et asséché nombre d’investissements internationaux, elles n’ont pas réussi à couper Moscou de ses principaux clients. Pire, la Russie contourne les embargos, développe un marché offshore, multiplie les ventes « grises » : pétrole raffiné hors d’Europe puis réimporté via des intermédiaires. Les pertes sont réelles — 5 à 10 % sur un an — mais les recettes restent « suffisantes » pour financer le guerrier endetté. L’effet clou de la roue, pas éclatement : la Russie roule, mais la fuite est visible partout.
La dépendance asiatique, bouée et piège
Mais le vrai danger, c’est l’asymétrie grandissante des partenaires commerciaux. À mesure que l’Europe s’efface, l’Asie — surtout la Chine — absorbe le gaz, le pétrole, et impose ses propres conditions. La Russie n’est plus un acteur mondial souverain, mais un fournisseur captif, dépendant des carnets de commandes de Pékin et de New Delhi. Résultat : marges réduites, recettes moindres, et exposition maximale à tout retournement de conjoncture en Asie. Le moindre ralentissement chinois, le moindre excès de production — et le château de cartes russe pourrait s’effondrer en quelques semaines.
Sanctions internationales : le blocus, plein de fuites
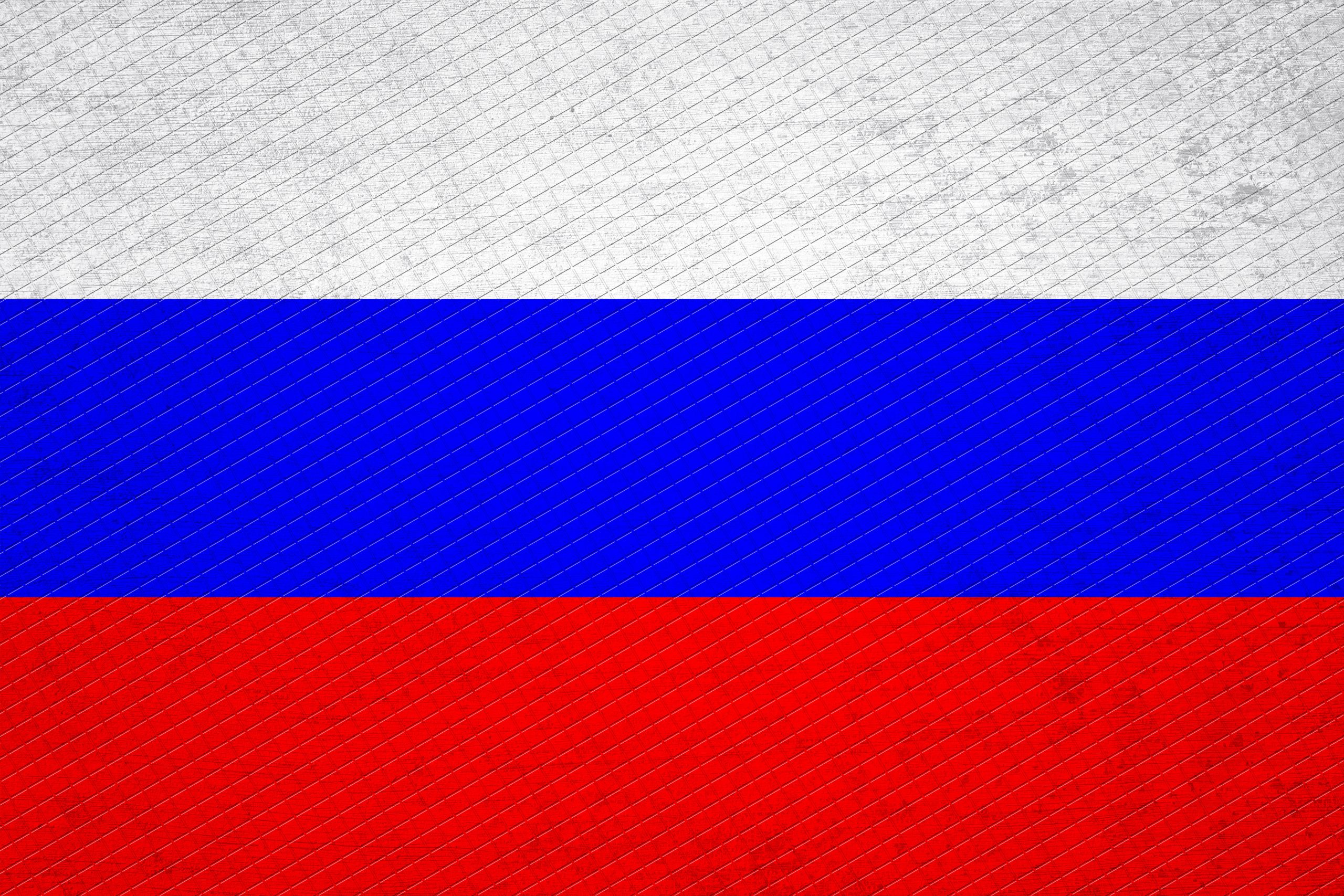
Des sanctions massives, mais pas fatales
L’Europe, les États-Unis, le Canada, tout le camp occidental a empilé plus de 2 000 sanctions — sur le gaz, le secteur bancaire, les exportations de machines, la technologie. Les actifs russes sont gelés, le système SWIFT est partiellement fermé, les oligarques sont traqués. Pourtant, la Russie évite la strangulation par le recyclage des circuits, la substitution interne, et détourne les restrictions grâce à un appareil d’État centralisé, autoritaire, qui n’a qu’un seul ordre : survivre, et poursuivre la guerre coûte que coûte.
Recettes alternatives : l’ingéniosité en mode crise
Privée de nombreuses importations, la Russie réinvente son économie. Fabrique ses propres pièces détachées, réanime des filières abandonnées, copie, pirate, rachète via des pays tiers où le contrôle occidental faiblit. Les pertes s’accumulent — baisse des recettes, hausses de coûts — mais le système tient. Les entreprises, les banques, s’adaptent vite, révèlent leur plasticité. Mais à force de ruses, l’appareil commence à grincer, nu, ralentissant la production civile, excluant des technologies-clés, isolant encore plus la Russie sur la scène mondiale.
L’illusion de l’immunité économique
Le discours officiel russe clame « immunité et grandeur ». Mais le récit s’effrite. Derrière la façade, les enquêtes indépendantes révèlent une économie en apnée, contrainte de dilapider les stocks et d’improviser. Les réserves de change fondent. Les investissements étrangers ont disparu, la croissance effective stagne autour de 1,4%, bien loin des sommets promis en 2022-2023. La prise de risque augmente, les marges s’amenuisent sur l’avenir. L’économie ne s’effondre pas : elle se délite, lentement, sûrement.
Le tableau social : sacrifices et tensions internes
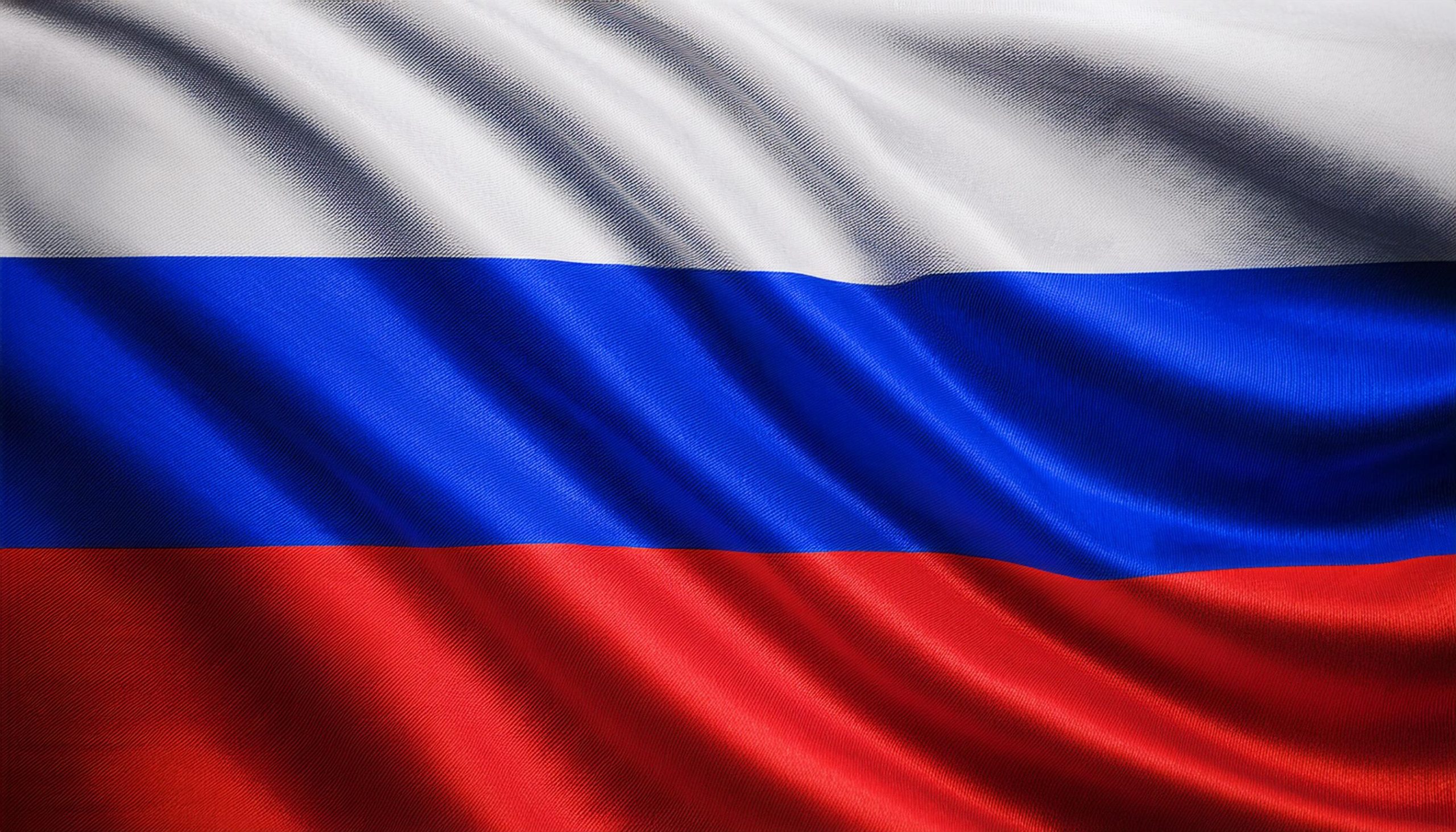
L’appauvrissement, la facture réelle
Un russe sur trois, selon les derniers sondages, estime que sa situation financière s’est « nettement détériorée » en un an. La hausse des prix, la difficulté d’accès à certains produits, la dégradation des infrastructures publiques : tout alourdit le quotidien. Les inégalités se creusent. Les régions rurales souffrent plus que Moscou, les retraités voient leurs pensions grignotées par l’inflation, les jeunes cherchent à partir ou à s’exiler intérieurement.
Contrôle social, répression, fatigue du peuple
Face à cette angoisse, le Kremlin cible la contestation : censure, répression, surveillance généralisée. Pas de droit à la critique, pas de report sur la vraie cause de la crise : tout est la faute des « ennemis extérieurs ». L’insatisfaction gronde, pourtant, camouflée, retenue, parfois explosive. Les protestations, moins visibles, n’en sont pas moins réelles : elles minent la cohésion voulue, fragilisent le socle de la résistance nationale.
Disparition de l’État providence ?
Pour soutenir l’effort de guerre, la Russie coupe dans toutes ses grandes politiques : réduction des aides sociales, diminution des investissements, abandons de projets internationaux. L’école, la santé, les infrastructures : tout subit le contrecoup du « tous à la guerre ». C’est la rançon de la militarisation extrême. Et c’est surtout le signal que cette économie, pivotée vers la guerre, ne pourra pas tenir ce rythme sans graves dommages, possiblement irréversibles, pour les générations futures.
Combien de temps la Russie peut-elle encore tenir ?
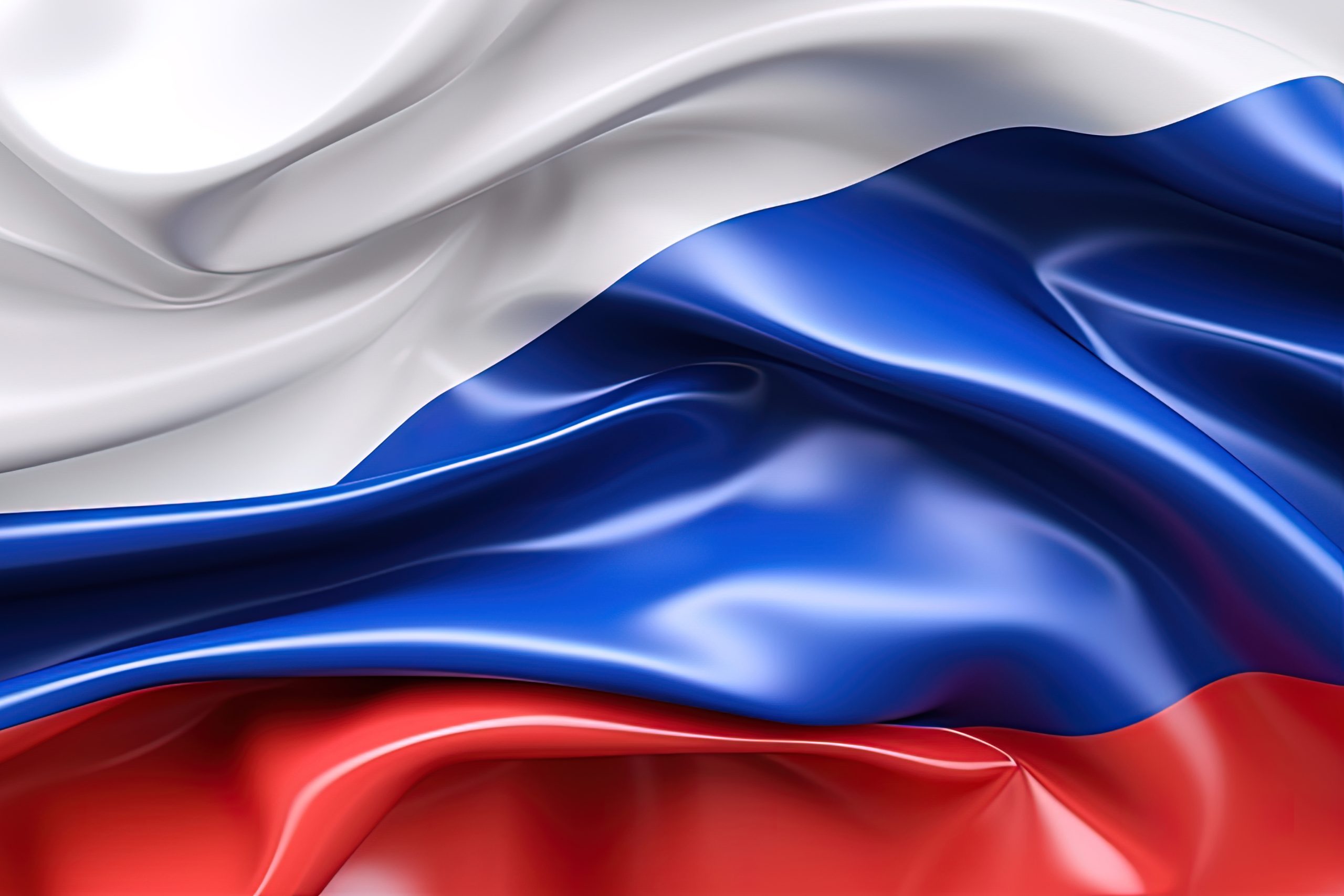
Le pronostic central : le court terme sous contrôle, le moyen terme menaçant
Personne ne sait dire « le jour exact » où l’économie russe grinsera trop fort pour continuer la guerre, mais tout le monde observe les signes : fonds souverain épuisé, croissance en frein, inflation incontrôlée, sacrifices internes. Sur six à neuf mois, la Russie trouvera toujours de quoi entretenir sa machine de guerre. Mais au fil des trimestres, la pression budgétaire, la réduction des recettes, l’escalade des sanctions finira par « percer le pneu » — pour reprendre la métaphore d’un diplomate européen. D’abord lentement, puis brutalement.
Résilience, ruse et autoritarisme retardent la rupture
La Russie de 2025 a montré une résilience inattendue : adaptation rapide, contournement, centralisation extrême de la décision. Mais cette agilité s’oublie vite devant l’usure des ressources, la fatigue du système, la lassitude sociale. L’économie tourne, maladroitement, sur les restes d’un miracle énergétique, la discipline forcée et le déni public — mais cela ne tiendra plus à long terme sans croissance ni innovation.
Un effondrement possible, mais pas programmé
Tout le monde scrute la rupture. Pour l’instant, la Russie ne « s’effondre » pas. Et, dans les régimes autoritaires, le poids de la souffrance populaire ne se traduit pas aussitôt en changement politique ou arrêt des hostilités. L’effritement sera progressif, puis soudain, quand la « fuite d’air » sera devenue trop forte. Le vrai danger : que la Russie tente d’accélérer le conflit pour éviter le pourrissement lent. Le calcul du Kremlin, cynique et dangereux, repose sur la certitude de tenir plus longtemps que l’Occident n’accepte de payer le prix de la solidarité à Kiev.
Conclusion – La roulette russe du budget : jusqu’à la panne sèche ou l’accident meurtrier ?

Entre illusion de maîtrise et peur de la panne : chronomètre enclenché
La Russie a encore du carburant – mais chaque jour, le réservoir se vide un peu plus. Le pays achète du temps, vend son futur, troque la santé de ses citoyens contre la prolongation d’un conflit qui engloutit tout. Sa « splendeur économique », c’est un château de sable, régulièrement ravaudé par les dollars du pétrole, mais miné par l’usure, l’isolement, la fuite de l’innovation. Tout analyste sérieux le dit : l’équilibre n’est que temporaire.
Course contre l’usure, vie contre orgueil : jusqu’au crash ?
L’économie de guerre, c’est une course de fond truquée. Les Russes paient deux fois : sur le front, et à la maison. Les grands discours du Kremlin masquent difficilement les dégâts d’une militarisation qui prive l’avenir. Si la volonté politique force à continuer, c’est le mur budgétaire, social, énergétique qui finira par s’imposer. Le « pire » n’est jamais certain dans une économie fermée… mais la rupture guette, chaque semaine, chaque plan d’austérité de plus.