
Un système de remontées opérationnelles et de tableaux de bord
Derrière ce chiffre de 1 060 militaires russes mis hors de combat, il y a une mécanique bureaucratique et militaire bien réelle. L’état-major ukrainien ne tire pas ces nombres d’un chapeau : ils proviennent d’un réseau de rapports opérationnels remontant des brigades, des commandements régionaux, des unités d’artillerie, des forces aériennes et des services de renseignement. À cela s’ajoutent des images satellites, des interceptions, des analyses de drones de reconnaissance, ainsi que des recoupements avec les traces laissées par les forces russes elles-mêmes – notamment sur les réseaux sociaux ou les canaux officiels. Les autorités militaires ukrainiennes consolident ensuite ces données en un tableau de bord quotidien : personnel, chars, blindés, artillerie, lance-roquettes multiples, systèmes de défense aérienne, avions, hélicoptères, drones, missiles, navires, véhicules logistiques, équipements spéciaux. Chaque ligne est assortie d’un “total depuis le début de l’invasion” et d’un “+” qui indique les pertes des dernières vingt-quatre heures.
Ce processus n’est ni parfait ni neutre. Dans toute guerre, les estimations de pertes ennemies tendent à être surestimées – c’est presque une constante historique. L’Ukraine n’échappe pas à cette tentation, surtout lorsqu’elle a besoin de montrer à ses partenaires que leur aide militaire n’est pas vaine et que la capacité offensive russe est effectivement grignotée jour après jour. Mais le fait que ces chiffres soient publiés de manière régulière, avec une structure cohérente, qu’ils soient recoupés par des plateformes indépendantes qui agrègent les données, et qu’ils restent, d’un jour à l’autre, dans un ordre de grandeur similaire à celui estimé par certains services de renseignement occidentaux, donne à ces bilans une certaine crédibilité, au moins comme indicateur de tendance. Ils ne disent pas tout, mais ils disent quelque chose : la Russie paie un prix humain et matériel très élevé pour chaque kilomètre de terrain disputé.
Une donnée militaire, mais aussi un outil de communication stratégique
Il serait naïf de considérer ces chiffres comme de simples informations techniques. Les bilans quotidiens de l’état-major ukrainien sont aussi des instruments de communication stratégique. Ils s’adressent simultanément à plusieurs publics : à l’opinion ukrainienne, qui doit voir que ses forces ne subissent pas seulement, mais infligent des pertes très lourdes à l’ennemi ; aux alliés occidentaux, qui ont besoin de preuves tangibles que l’armement livré, les systèmes d’artillerie, les drones et les missiles occidentaux font une différence concrète ; et, bien sûr, à la société russe, même si cette dernière n’y a qu’un accès très filtré. Chaque “+1 060” est donc aussi un message : « Nous tenons, nous résistons, et nous rendons cette guerre extrêmement coûteuse pour Moscou ». Dans ce cadre, les chiffres ne sont pas seulement descriptifs, ils sont performatifs : ils cherchent à influencer les perceptions, à renforcer certains récits, à en affaiblir d’autres. C’est là que le lecteur doit garder un réflexe salutaire de prudence, sans pour autant balayer ces données d’un revers de main.
Je ne peux pas faire comme si ces bilans étaient neutres. Ils ne le sont pas, et c’est normal : dans une guerre, l’information est une arme. Mais ce qui me frappe, c’est la tension permanente entre deux exigences : d’un côté, la nécessité de douter, de garder du recul, d’accepter que ces chiffres soient partiels, orientés, peut-être exagérés ; de l’autre, l’intuition presque physique qu’un tel niveau de pertes, répété jour après jour, raconte malgré tout une vérité profonde sur l’absurdité de ce conflit. Je ne crois pas que la solution soit de se réfugier dans le cynisme. Je préfère ce malaise lucide : prendre ces chiffres au sérieux, tout en refusant de les avaler sans les interroger.
Section 3 : 1 060 soldats, 1 char, 6 blindés – l’addition précise d’une seule journée

Ce que signifie vraiment “1 060 militaires mis hors de combat”
Le cœur du bilan, ce sont ces 1 060 militaires russes “éliminés” au sens militaire, c’est-à-dire mis hors de combat, morts ou blessés. Rapporté sur une seule journée, ce chiffre est vertigineux. Sur un mois, à rythme constant, on parle de plus de 30 000 soldats. Sur un an, la projection devient presque insoutenable. Même en tenant compte des aléas des combats et des variations quotidiennes, la tendance générale reste celle d’une consommation massive de personnel. Pour l’armée russe, cela signifie des unités qui doivent être reconstituées à marche forcée, des mobilisations régulières, un recours croissant à des contrats militaires pour des hommes parfois peu formés, parfois engagés plus par nécessité économique que par conviction. Pour l’Ukraine, cela signifie que sa stratégie consiste clairement à user l’adversaire, même au prix d’une usure très lourde pour ses propres troupes. Ce n’est pas une guerre de grandes offensives blindées comme en 1943, c’est une guerre d’écrasement graduel.
Chaque “militaire éliminé” recouvre des situations très différentes : des soldats expérimentés, des conscrits envoyés trop vite sur le front, des détenus recrutés par des structures paramilitaires, des engagés sous contrat attirés par un salaire. Sur le terrain, cette saignée se traduit par un turn-over permanent dans les unités, un affaiblissement de la cohésion, des commandants qui voient leurs bataillons se vider puis se remplir à nouveau avec des recrues moins aguerries. Pour la Russie, maintenir le niveau d’engagement actuel implique une forme de mobilisation silencieuse, parfois partielle, parfois masquée, mais bien réelle. Pour les Ukrainiens, voir chaque jour “+1 060” peut nourrir à la fois un sentiment de résistance acharnée et une lassitude profonde : si l’ennemi perd autant et que la guerre continue, cela signifie que la capacité de régénération du système russe est, elle aussi, redoutable.
Un char et six blindés : peu sur le papier, décisifs sur le terrain
Dans le même bilan, la mention d’“un char” et de “six véhicules blindés de combat” semble, à première vue, presque modeste. Après tout, on a lu des journées avec cinq, six ou sept chars perdus, voire davantage. Mais c’est là qu’il faut se méfier de la tentation de comparer mécaniquement. Un char moderne, même ancien modèle, reste une pièce maîtresse dans de nombreuses offensives locales, que ce soit pour appuyer une progression d’infanterie ou pour consolider une défense. Chaque blindé détruit, c’est un peu de mobilité, de protection et de feu direct en moins pour les unités russes. Quant aux six véhicules blindés, il s’agit souvent de moyens de transport de troupes ou de plateformes d’armes, essentiels pour amener rapidement des soldats au contact ou pour les extraire sous le feu. Sur une ligne de front très étirée, où chaque village devient un point d’appui, ces pertes s’additionnent et finissent par peser sur la capacité de la Russie à manœuvrer efficacement.
Il faut aussi voir ces pertes matérielles dans la durée. Depuis le début de la guerre, les sources ukrainiennes estiment que la Russie aurait perdu plus de 11 000 chars et près de 24 000 véhicules blindés. Même si ces chiffres sont probablement supérieurs à ceux qu’accepteraient des inventaires indépendants, la tendance reste claire : le parc blindé russe est en train d’être renouvelé dans l’urgence, avec des modèles plus anciens sortis des stocks, parfois moins bien protégés, parfois moins fiables. Chaque nouveau char détruit est plus difficile à remplacer que le précédent, parce qu’il faut compenser non seulement la perte matérielle, mais aussi la perte de compétences des équipages. Un blindé ne vaut vraiment que par ceux qui le servent, et ces hommes-là, même dans une logique strictement militaire, ne se remplacent pas d’un simple trait de plume sur un tableau Excel.
Je suis frappé par la manière dont notre regard se focalise naturellement sur les “gros chiffres” – ces 1 060 militaires – en reléguant presque au second plan les “détails” comme “un char” ou “six blindés”. Pourtant, sur un champ de bataille précis, ce sont parfois ces six blindés manquants qui font la différence entre une percée et un échec, entre une position tenue et une position abandonnée à la hâte. Derrière les graphes et les courbes, il y a toujours cette réalité-là : une compagnie qui attend un appui blindé qui ne viendra jamais, une section d’infanterie qui réalise qu’elle devra avancer à découvert. Pour moi, c’est là que ces chiffres cessent d’être abstraits : quand j’imagine ce que signifie, concrètement, la ligne “+6 véhicules blindés détruits”.
Section 4 : Artillerie, drones, véhicules – la guerre d’usure en chiffres

14 systèmes d’artillerie et 239 drones : la bataille du feu à distance
Le même bilan quotidien mentionne la destruction de 14 systèmes d’artillerie et de 239 drones russes. Ce n’est pas un détail technique, c’est le cœur de la guerre moderne. La Russie a construit sa stratégie sur une supériorité en feu indirect : frapper loin, longtemps, massivement, avant même que l’infanterie n’avance. Chaque pièce d’artillerie détruite est une réduction concrète de cette capacité à saturer le champ de bataille. Bien sûr, Moscou dispose encore d’un stock considérable de tubes et de munitions, mais l’élimination de 14 systèmes en un jour signifie que, même dans ce domaine clé, la pression ukrainienne reste forte. Elle repose sur un mélange de drones de repérage, de radars de contre-batterie et de munitions guidées capables de frapper des pièces parfois situées très loin derrière la ligne de front.
Les 239 drones détruits dans la même période illustrent à quel point ce conflit est devenu une guerre de capteurs autant qu’une guerre de canons. Chaque drone abattu, c’est un œil en moins, une bouche à feu potentielle en moins quand il s’agit de munitions rôdeuses, un outil de correction d’artillerie en moins. La Russie en déploie par milliers, souvent produits à bas coût, parfois issus de chaînes industrielles tournant quasiment en continu. L’Ukraine, elle, consacre une partie croissante de ses efforts à la défense anti-drones, parce que perdre le contrôle de l’espace aérien à basse altitude, c’est exposer ses troupes à des frappes constantes. Dans ce contexte, voir apparaître “+239 drones” dans la colonne des pertes russes n’est pas seulement impressionnant, c’est aussi le signe que la bataille technologique est loin d’être jouée, et qu’elle se joue, justement, dans ce champ invisible, quelques dizaines de mètres au-dessus des tranchées.
71 véhicules et camions-citernes : frapper le nerf logistique
Enfin, il y a ces 71 véhicules et camions-citernes détruits en une journée. C’est peut-être la partie la moins spectaculaire du bilan, mais c’est souvent la plus stratégique. Une armée vit de logistique. Sans carburant, sans munitions, sans vivres, sans pièces détachées, les chars et les blindés ne sont que des masses de métal immobiles. En ciblant systématiquement les véhicules logistiques russes, l’Ukraine cherche à attaquer le conflit à un niveau plus profond, celui des flux. Un convoi de camions détruit à l’arrière ne fait pas de bruit médiatique, mais il peut paralyser un segment entier du front pendant plusieurs jours. Dans un conflit où chaque position fortifiée demande des tonnes de munitions, où chaque offensive nécessite un effort massif de ravitaillement, ces 71 véhicules manquants créent des fractures invisibles dans les lignes ennemies.
À long terme, cette stratégie de harcèlement logistique contribue à rendre la guerre économiquement plus coûteuse pour Moscou. Produire ou acheter des camions, les équiper, les convoyer sur des milliers de kilomètres, former des conducteurs – tout cela a un prix. Quand un véhicule est détruit avec son chargement, ce n’est pas seulement une ligne de plus dans un bilan matériel, c’est une perte de capacité opérationnelle qui devra être compensée ailleurs, souvent par des compromis douloureux : moins de munitions sur un secteur, moins de carburant pour une offensive, moins de flexibilité pour réagir à une percée adverse. Dans une guerre d’attrition, frapper les tuyaux est souvent aussi important que frapper les canons. C’est cette logique, lentement, méthodiquement, que ce bilan à “71 véhicules” met en lumière, presque malgré lui.
Instinctivment, on est tenté de regarder d’abord le nombre de soldats, puis les chars, et de reléguer le reste au rang d’accessoire. Mais plus je creuse ces bilans, plus je me rends compte que la vraie bataille se joue souvent ailleurs : dans un dépôt de munitions qui explose à l’arrière, dans un pont logistique saturé, dans une route secondaire devenue impraticable parce qu’un convoi a été anéanti. Ces 71 véhicules détruits me parlent presque plus que certains chiffres tonitruants, parce qu’ils dévoilent l’architecture cachée de la guerre. Et je me surprends à ressentir une gêne : nous sommes en train de commenter, presque avec froideur, l’effondrement méticuleux de systèmes entiers, alors que, dans le même temps, des hommes continuent de monter dans ces camions en sachant très bien qu’ils roulent vers une cible.
Section 5 : Une guerre d’attrition qui redessine le front
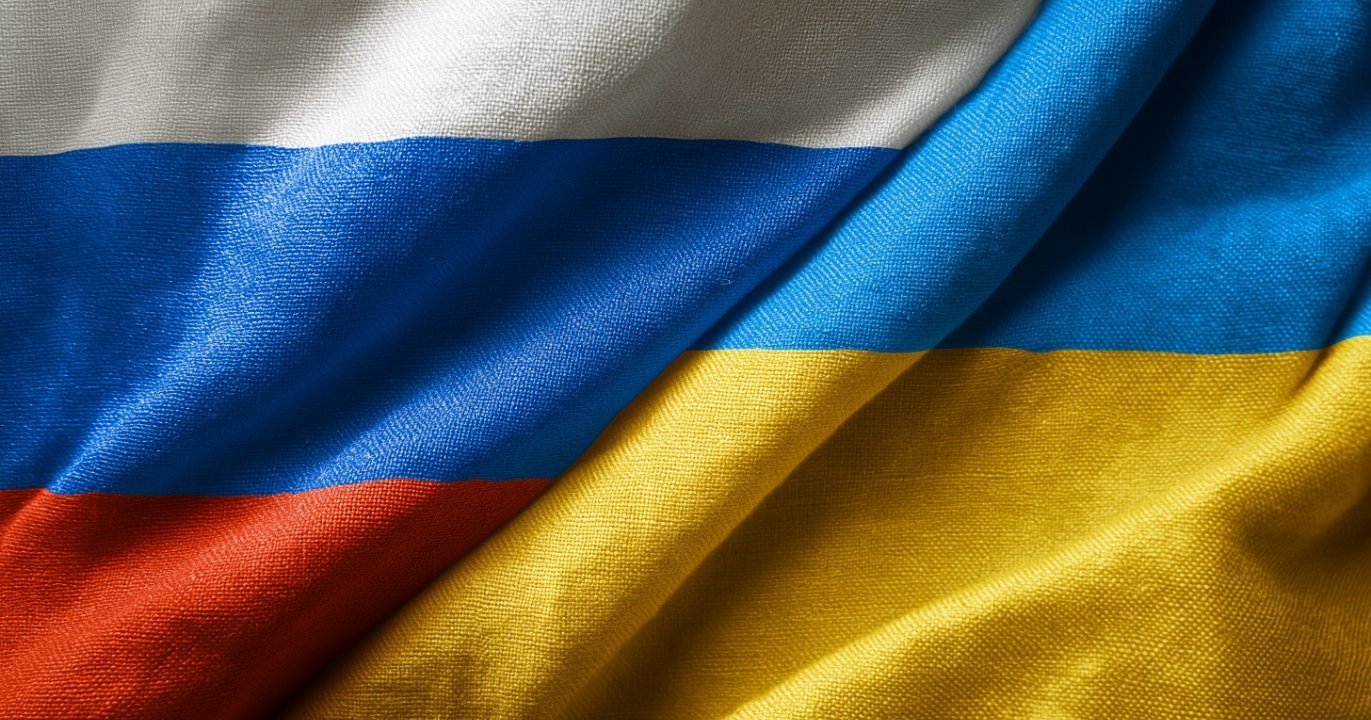
Des gains territoriaux limités, des pertes colossales
Ce qui choque, quand on met en regard ces bilans de pertes et la carte du front, c’est le décalage apparent entre l’ampleur des sacrifices et la modestie des gains territoriaux. Malgré des journées comme celle-ci, à 1 060 soldats et des dizaines d’équipements détruits, la ligne de front ne bouge parfois que de quelques centaines de mètres, quand elle bouge. Des analyses indépendantes montrent que, depuis des mois, la Russie avance par petites touches, grappillant des villages, des positions fortifiées, au prix d’un coût humain énorme. L’Ukraine, de son côté, tient, recule parfois, contre-attaque ailleurs, mais ne parvient pas non plus à inverser spectaculairement la tendance. C’est l’essence même d’une guerre d’attrition : chaque camp cherche moins à conquérir massivement du terrain qu’à écraser lentement les capacités de l’autre, en espérant que, tôt ou tard, la société et le pouvoir politique adverses diront « stop ».
Dans ce modèle, une journée à 1 060 pertes russes n’est pas un “événement” isolé, mais un maillon dans une chaîne. Ce qui compte, ce n’est pas seulement le chiffre lui-même, c’est la capacité de la Russie à absorber un tel choc, puis à en absorber un autre le lendemain, et encore un autre la semaine suivante. Jusqu’ici, malgré des tensions visibles, le régime a réussi à maintenir la machine de guerre en marche : la mobilisation continue, la production d’armement est redirigée vers une économie quasi de guerre, la propagande s’efforce de transformer ces pertes en sacrifice acceptable, voire en preuve de “détermination”. Mais chaque nouvelle centaine de morts ajoute aussi un peu de pression dans des familles russes qui, même si elles ne peuvent pas toujours le dire, voient très bien qui manque autour de la table. C’est là, à moyen terme, que les chiffres militaires rencontrent la réalité politique.
Quand la durée devient l’arme principale
La vraie arme de cette guerre, ce n’est plus seulement le char ou le missile, c’est la durée. La stratégie ukrainienne consiste, en partie, à prolonger le conflit suffisamment longtemps pour rendre le coût insupportable pour Moscou, tout en misant sur le soutien continu des alliés occidentaux. La Russie, elle, semble parier sur l’inverse : user la patience de l’Ukraine, épuiser la fatigue des opinions publiques occidentales, compter sur des changements politiques dans certaines capitales pour réduire l’aide militaire. Dans ce bras de fer, les bilans de pertes deviennent des indicateurs indirects de la résilience des deux systèmes. Une journée à 1 060 pertes, quelques jours après une autre à 1 100, montre que la Russie accepte – ou est contrainte d’accepter – un niveau de pertes que beaucoup jugeaient impensable avant 2022. Mais la question, la vraie, est celle-ci : jusqu’à quand ?
Pour l’Ukraine, chaque journée de ce genre est à la fois une preuve de capacité de résistance et un avertissement terrible : tant que la guerre reste dans ce format, le pays ne peut pas vraiment se reconstruire, ne peut pas ramener ses réfugiés, ne peut pas réorienter son économie vers autre chose que la survie. Pour la Russie, c’est une fuite en avant : plus les pertes s’accumulent, plus il devient politiquement difficile de justifier un compromis perçu comme une “retraite”. Et pour nous, observateurs extérieurs, ces chiffres sont un miroir désagréable : ils nous renvoient l’image d’un continent qui tolère, dans son voisinage immédiat, une guerre dont la variable principale est devenue le temps, comme si l’on avait admis que la seule issue réaliste, pour l’instant, était de laisser l’horloge faire son œuvre.
Je ne peux pas m’empêcher d’avoir cette pensée un peu brutale : si nous acceptons sans broncher des jours à 1 060 morts et blessés, c’est aussi parce que la ligne de front est loin de nous. Quand la durée devient une arme, le danger, c’est que nous finissions par nous dire : “encore quelques mois, encore quelques rotations, encore quelques milliards d’aide”, comme si cette guerre était un simple paramètre budgétaire ou diplomatique. Pour l’Ukraine et pour la Russie, ce n’est pas “encore quelques mois” : c’est une génération entière qui se joue, parfois dans l’indifférence poli des capitales lointaines. Et moi, je refuse de traiter ces bilans comme une simple colonne dans un rapport.
Section 6 : Entre propagande, transparence et brouillard de guerre

Des chiffres ukrainiens impossibles à vérifier, mais difficilement ignorables
Les autorités ukrainiennes l’admettent parfois du bout des lèvres : ces chiffres de pertes russes sont “en cours de confirmation”, souvent fondés sur des estimations consolidées en temps réel. Ils sont, par nature, partiels, sujets à erreurs, parfois à doublons. Et pourtant, ils forment aujourd’hui l’un des rares ensembles de données publiés régulièrement sur l’ampleur de cette guerre. La Russie, elle, a cessé très tôt de communiquer de manière transparente sur ses pertes, préférant évoquer des chiffres très inférieurs, souvent datés, ou recourir à des formulations vagues. Les sources occidentales, qu’il s’agisse de services de renseignement ou de centres de recherche, avancent leurs propres estimations, souvent élevées, mais publiées de manière plus ponctuelle. Face à cela, les bilans quotidiens ukrainiens deviennent, qu’on le veuille ou non, une référence, même pour ceux qui les contestent.
Ce qui rend ces chiffres difficiles à balayer, c’est leur cohérence interne dans le temps. Jour après jour, ils s’inscrivent dans une courbe qui, sans être parfaitement fiable, reste compatible avec ce que l’on sait par ailleurs : le recours massif de Moscou à des vagues d’attaques d’infanterie, la multiplication des témoignages de pertes lourdes dans certaines régions russes, les estimations occidentales évoquant des centaines de milliers de militaires russes tués ou blessés. On peut débattre pour savoir si la réalité est à 60, 70 ou 80 % des chiffres ukrainiens, mais la tendance est là : nous sommes confrontés à un niveau de pertes initialement jugé “inimaginable” dans une guerre entre États européens au XXIᵉ siècle. Et si le brouillard de guerre empêche de trancher avec précision, il n’empêche pas de voir la silhouette massive du désastre.
La bataille des récits : qui gagne vraiment en communiquant sur les pertes ?
Il ne faut pas sous-estimer la dimension symbolique de ces bilans. Pour l’Ukraine, communiquer chaque jour sur les pertes russes, c’est affirmer qu’elle garde une forme de maîtrise de la narration. Même si la ligne de front est parfois défavorable, même si certaines offensives échouent, ces chiffres rappellent que la Russie paye, elle aussi, un prix colossal. Pour la Russie, ne pas communiquer – ou communiquer très peu – relève d’un choix inverse : minimiser la perception interne de l’ampleur du sacrifice consenti, entretenir l’idée que l’opération reste “sous contrôle”. Les deux stratégies ont un coût. À Kyiv, la transparence relative crée une attente : si un jour les chiffres venaient à baisser fortement, certains y verraient le signe d’un affaiblissement ukrainien. À Moscou, le silence alimente la défiance et pousse des médias indépendants, des ONG, des familles à chercher par d’autres moyens la vérité sur le sort de leurs proches.
Dans cette bataille des récits, aucune des deux parties n’est totalement désintéressée, et aucune n’a le monopole de la vérité. Mais cela ne signifie pas que tout se vaut. Les bilans quotidiens de l’Ukraine peuvent être vus comme un mélange de communication politique et de compte rendu opérationnel. Ils reflètent un rapport de force réel, même s’ils le mettent en scène. En face, l’absence de communication crédible de la part de Moscou ne produit pas un “équilibre”, mais plutôt un vide occupé par des estimations extérieures et par des récits fragmentaires. En tant que lecteur, nous sommes condamnés à faire avec cette asymétrie : prendre acte du caractère orienté de ces bilans, tout en refusant de tomber dans un relativisme confortable qui placerait au même niveau une donnée documentée – même imparfaitement – et un silence organisé.
Je ne crois pas à la neutralité pure dans ce conflit. Pas après des années d’invasion, de villes bombardées, de populations déplacées. Mais je crois à la responsabilité de ne pas avaler n’importe quoi au nom de “notre camp”. Les bilans ukrainiens sur les pertes russes jouent sur une corde sensible : ils rassurent ceux qui soutiennent Kyiv, ils donnent le sentiment que l’énorme effort consenti n’est pas vain. Et pourtant, si nous voulons rester lucides, il faut accepter cette tension : oui, ces chiffres sont un outil de communication, et oui, ils n’en restent pas moins l’un des rares éclats de vérité chiffrée dans un paysage saturé de bruit et de mensonges. Ce n’est pas confortable, mais la lucidité ne l’est jamais.
Section 7 : Le coût humain pour la Russie, le choc politique à Moscou
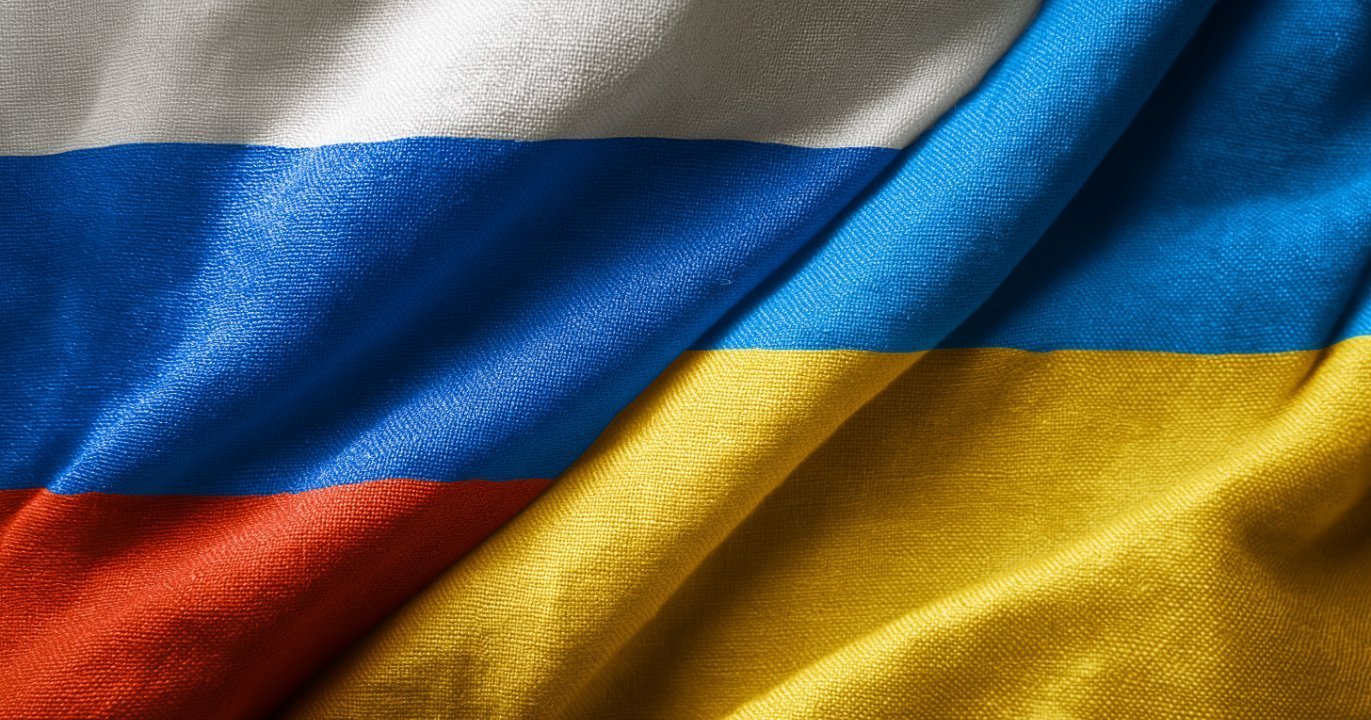
Une génération marquée à vie par la guerre
Qu’on retienne les chiffres ukrainiens dans leur intégralité ou qu’on les réduise de moitié, une évidence s’impose : la société russe paye un prix humain considérable. Des centaines de milliers de militaires passés par le front, des dizaines – peut-être des centaines – de milliers de morts, un nombre encore plus grand de blessés, parfois lourdement handicapés. Chaque jour à 1 060 pertes supplémentaires ajoute une couche de traumatisme collectif. Des villages entiers voient partir leurs jeunes hommes, certains ne reviennent pas, d’autres reviennent brisés, physiquement ou psychologiquement. Longtemps, le pouvoir a pu contenir ce choc en dirigeant l’effort de mobilisation vers des régions périphériques, plus pauvres, moins visibles médiatiquement. Mais au fil du temps, la guerre s’est rapprochée du cœur démographique du pays, et le coût humain devient plus difficile à camoufler.
Cette réalité se traduira, tôt ou tard, par des répercussions politiques. Pas forcément sous la forme de manifestations massives – l’appareil répressif russe est rodé, les marges de contestation publique sont étroites – mais par une érosion plus souterraine : méfiance envers l’État, perte de confiance dans la parole officielle, fatigue, retrait silencieux. L’addition quotidienne de ces 1 060 pertes, puis de 900, puis de 1 200, construit un ressentiment qui ne s’exprimera peut-être pas demain, mais qui pèsera sur la stabilité future du régime. L’histoire montre que les guerres d’usure prolongées laissent rarement intact le système politique qui les a menées. Même si le pouvoir parvient à “tenir”, il devra composer avec une société plus fracturée, plus endeuillée, plus sceptique. Et ces bilans, qu’on les lise à Kyiv, à Moscou ou à Paris, sont le préambule chiffré de cette histoire-là.
Un pouvoir qui joue sa survie sur le dos des soldats
Pour le pouvoir russe, chaque journée de pertes massives est un pari terrible : continuer à engager des troupes, souvent peu formées, pour maintenir l’illusion d’une dynamique offensive, au risque de vider peu à peu le réservoir humain disponible. Dans cette logique, les soldats deviennent une ressource politique autant que militaire. Renoncer à offensives coûteuses, c’est admettre que la stratégie précédente a échoué. Persister, c’est accepter de lier un peu plus la survie du régime à la poursuite d’une guerre qui ne se termine pas. Pour l’instant, le pouvoir semble avoir choisi la seconde option, en misant sur l’idée qu’une partie importante de la population acceptera ces sacrifices tant qu’ils ne bouleversent pas trop brutalement son quotidien. Mais même un système autoritaire doit composer avec une donnée simple : plus les pertes augmentent, plus le nombre de familles concernées s’élargit, plus la possibilité d’un “retour de flamme” social existe, même si personne ne peut en prévoir la forme exacte.
Les bilans comme celui-ci, à 1 060 pertes russes en une journée, sont donc aussi des messages adressés au Kremlin. L’Ukraine ne frappe pas seulement une armée, elle frappe une narration : celle d’un pouvoir qui promettait une opération “rapide”, “maîtrisée”, et qui se retrouve englué dans un conflit qui ressemble de plus en plus à un bourbier historique. Chaque nouvelle colonne de pertes rend plus fragile le récit initial, oblige à inventer de nouvelles justifications, de nouveaux slogans. Ce n’est pas un hasard si, en parallèle, le discours officiel se durcit, se radicalise parfois : plus le coût réel de la guerre est élevé, plus il devient nécessaire de reconstruire la légitimité de ce coût par des récits grandiloquents. Mais les chiffres, eux, restent têtus. Et même dans un pays où l’information est contrôlée, on ne peut pas éternellement cacher l’ampleur d’une telle saignée.
Je pense souvent aux mères russes qui ne lisent pas ces bilans ukrainiens, mais qui vivent la réalité qu’ils décrivent. Elles n’ont pas besoin de savoir qu’il y a eu “+1 060” aujourd’hui. Elles savent simplement que leur fils ne répond plus, que l’avis officiel parle de “mort héroïque” ou de “disparition”, que personne ne donne vraiment de détails. Pour elles, la guerre n’est pas un graphique, c’est une chaise vide. Et je me demande parfois si, à force, ce fossé entre l’iconographie héroïque du pouvoir et la réalité concrète des pertes ne finira pas par fissurer des loyautés que l’on croyait acquises. Les chiffres, ici, ne sont pas seulement des données : ce sont des bombes à retardement politiques.
Section 8 : L’autre face des chiffres – soldats ukrainiens et société épuisée

Les pertes ukrainiennes, l’angle mort volontaire des bilans
Une chose frappe immédiatement dans ces bilans officiels : ils détaillent méticuleusement les pertes russes, mais restent beaucoup plus discrets sur les pertes ukrainiennes. C’est compréhensible d’un point de vue stratégique : aucun état-major ne souhaite étaler sa propre vulnérabilité. Pourtant, il serait illusoire de croire que l’Ukraine inflige 1 060 pertes par jour sans subir elle-même un coût humain massif. Des déclarations publiques de responsables ukrainiens et des évaluations occidentales évoquent déjà des centaines de milliers de militaires ukrainiens tués ou blessés depuis 2022. Sur le terrain, chaque village repris, chaque position défendue, chaque frappe de contre-batterie réussie se paye, là aussi, en vies brisées. L’Ukraine, elle aussi, est en train de former une génération marquée à vie par la guerre, physiquement et psychologiquement.
Ce silence relatif sur les pertes ukrainiennes crée un décalage narratif. À l’extérieur, on pourrait presque se laisser convaincre que la guerre se résume à des colonnes de pertes russes et à des images de soldats ukrainiens héroïques. À l’intérieur du pays, en revanche, personne n’est dupe. La plupart des familles ont un proche mobilisé, un ami tombé, un voisin amputé, un collègue parti sur le front. Les hôpitaux, les centres de rééducation, les cimetières racontent une autre histoire, plus sombre, que les communiqués officiels ne peuvent pas totalement effacer. Cela n’ôte rien à la légitimité de la défense ukrainienne, mais cela rappelle une vérité inconfortable : la guerre d’attrition est une tragédie bilatérale. Elle n’épargne ni le pays agressé ni le pays agresseur, même si la responsabilité morale n’est pas la même.
Une société ukrainienne qui tient, mais à quel prix ?
L’ampleur des pertes russes, mises en avant dans ce bilan à 1 060 soldats, ne doit pas masquer l’autre réalité : la résilience ukrainienne a un coût colossal. Le pays vit depuis plus de deux ans et demi au rythme des sirènes, des coupures d’électricité, des mobilisations successives, des attaques de drones et de missiles sur ses villes. Une partie de la population a quitté le pays, une autre tente de maintenir une forme de normalité sous le poids permanent de l’incertitude. Les forces armées, de leur côté, doivent non seulement tenir la ligne, mais aussi intégrer de nouveaux systèmes d’armement, adapter en permanence leur doctrine, gérer un afflux continu de blessés et de traumatismes. Chaque succès tactique, chaque colonne de pertes russes marquée en gras dans les communiqués, est acheté au prix d’une fatigue sociale et institutionnelle extrême.
Dans ce contexte, la mise en avant des pertes russes répond aussi à un besoin psychologique : rappeler aux Ukrainiens que leur endurance n’est pas vaine, que chaque jour sur le front affaiblit réellement l’adversaire. Mais pour que cette narration reste crédible, il faudra, tôt ou tard, affronter de manière plus transparente la question des pertes ukrainiennes elles-mêmes, ne serait-ce que pour préparer la société à la phase suivante : celle de la reconstruction, du retour des combattants, du traitement des traumatismes. Tant que nous ne verrons que la moitié du tableau – celle des 1 060 pertes russes du jour – nous resterons, même en tant qu’observateurs extérieurs, partiellement aveugles à la dimension totale du désastre.
Je refuse de jouer le jeu confortable qui consisterait à me réjouir, même brièvement, d’un chiffre comme “+1 060” sans penser à ce qu’il implique pour l’autre camp. Oui, ces pertes sont infligées par un pays agressé à un pays agresseur. Oui, il y a une asymétrie morale fondamentale. Mais si nous voulons garder un regard humain sur cette guerre, nous ne pouvons pas nous contenter des colonnes qui nous arrangent. Les Ukrainiens ne sont pas des abstractions héroïques : ce sont eux aussi des corps, des vies, des familles. Et même si les bilans officiels n’en parlent pas, nous avons le devoir, en tant que lecteurs, de garder cette autre colonne – celle des pertes ukrainiennes – dans un coin de notre conscience.
Section 9 : Les drones, symboles d’une guerre industrielle low-cost

239 drones abattus : l’ère des essaims et des capteurs
Le chiffre de 239 drones russes détruits en un seul jour résume à lui seul la mutation profonde de cette guerre. Nous ne sommes plus seulement dans un conflit de chars et de canons, mais dans une bataille permanente pour le contrôle de l’espace aérien à basse altitude. La Russie emploie des drones de reconnaissance, des munitions rôdeuses, des appareils kamikazes visant les infrastructures, les tranchées, les véhicules isolés. L’Ukraine, de son côté, développe une défense multi-couches, combinant systèmes anti-aériens, brouillage électronique et… ses propres essaims de drones. Quand un bilan indique “+239 drones” abattus côté russe, cela ne veut pas seulement dire que des appareils ont été détruits : cela signifie que, dans le ciel au-dessus du front, une bataille invisible mais constante se joue à chaque minute.
Ces drones, souvent produits à moindre coût, parfois avec des composants civils, rappellent que la guerre est entrée dans une phase de massification technologique. On ne compte plus les attaques filmées par ces petits engins, diffusées ensuite sur les réseaux sociaux, transformant chaque coup au but en clip de propagande. Mais derrière ces images, il y a une réalité plus silencieuse : des équipes entières consacrent leurs journées à piloter, à entretenir, à améliorer ces appareils, à inventer des contre-mesures. Les “239 drones” de ce bilan reflètent aussi une course industrielle : qui pourra produire, adapter, déployer le plus vite ? Qui saura transformer des milliers de petits appareils en un avantage stratégique réel, et pas seulement en une succession de vidéos spectaculaires ?
Une économie de guerre à bas coût, mais à haut rendement létal
Les drones représentent également une nouvelle forme de rapport coût-efficacité dans la guerre. Un drone bon marché, monté avec des composants accessibles, peut détruire un véhicule qui coûte des centaines de milliers, voire des millions de dollars. À l’inverse, abattre un essaim de drones peut obliger à utiliser des missiles anti-aériens coûteux, ce qui pèse lourd sur les stocks. Dans ce contexte, le chiffre de “239 drones abattus” raconte une bataille économique autant que tactique. La Russie tente d’inonder le champ de bataille avec des appareils souvent produits en série, parfois avec l’aide d’alliés, tandis que l’Ukraine doit arbitrer en permanence entre l’utilisation de systèmes sophistiqués et le développement de solutions plus rustiques, mais économiques.
La présence massive de drones change aussi la psychologie du front. Les soldats savent qu’ils peuvent être observés, ciblés, filmés à tout moment. Le ciel n’est plus seulement un espace d’aviation, c’est un réseau de capteurs mortels. Dans ces conditions, chaque drone abattu côté russe représente un court répit, une bulle d’invisibilité gagnée pour quelques heures. Mais tant que la guerre continue, ces bulles se refermeront, et de nouveaux appareils viendront les remplacer. Les “239 drones” de ce bilan ne sont donc ni une fin ni un tournant : ils sont un instantané d’une dynamique appelée à durer, à se sophistiquer, et à se généraliser dans d’autres conflits. C’est peut-être l’une des leçons les plus inquiètantes de cette guerre : ce qui se passe aujourd’hui au-dessus du Donbass sera probablement, demain, la norme ailleurs.
Quand je lis “+239 drones”, j’ai presque l’impression de lire une ligne de code, une métrique technique. Et pourtant, ce chiffre résume peut-être mieux que tout le monde combien la guerre a changé. Nous sommes en train de normaliser l’idée que des petits engins, parfois bricolés dans des ateliers improvisés, peuvent décider de la vie ou de la mort d’un homme en quelques secondes. Il y a quelque chose d’inhumain dans cette distance, dans cette capacité à “cliquer” sur un écran pour guider une charge explosive. Et je me surprends à avoir peur non seulement pour l’Ukraine, mais pour nous tous : parce que ce qui est testé là-bas, dans la boue et les ruines, est en train d’écrire le manuel de nos futurs conflits.
Section 10 : Matériels, chaînes logistiques et économie de guerre russe

Des stocks qui s’épuisent, des usines qui tournent à plein régime
Les chiffres de ce bilan – un char, six blindés, 14 systèmes d’artillerie, 71 véhicules – pourraient donner l’impression que la Russie dispose d’une réserve inépuisable. Après tout, des milliers d’équipements sont encore en ligne, et Moscou n’a cessé de remettre en service des matériels plus anciens. Mais à mesure que la guerre se prolonge, chaque nouvelle perte pèse plus lourd. Les stocks de matériels modernes se réduisent, obligeant les forces russes à déployer des modèles moins performants, moins protégés, parfois sortis de dépôts où ils croupissaient depuis des années. Les usines tournent, certaines ont été converties en sites de production militaire, mais elles ne peuvent pas, à elles seules, compenser un rythme de pertes aussi soutenu, surtout dans un contexte de sanctions internationales et de difficultés d’accès à certains composants.
En parallèle, l’économie russe s’est progressivement adaptée à un mode quasi-permanent de mobilisation industrielle. Le budget militaire a été augmenté, des secteurs entiers ont été réorientés, des entreprises ont été mises sous pression pour répondre aux commandes du ministère de la Défense. Sur le papier, cela permet de maintenir la machine en marche. Dans la pratique, cela signifie des arbitrages douloureux : moins d’investissements dans d’autres secteurs, plus de dépendance à l’égard d’alliés économiques, plus de vulnérabilité à de nouveaux cycles de sanctions. Chaque char, chaque blindé, chaque pièce d’artillerie détruits dans cette journée à 1 060 pertes ne sont pas seulement des objets physiques : ce sont aussi des heures de travail, des matières premières, des compromis budgétaires qui devront être recommencés de zéro.
Le front invisible des camions et des ateliers
On parle souvent des usines, des chaînes de montage, mais le front invisible de cette guerre industrielle se joue aussi dans les ateliers de réparation, les dépôts, les réseaux de transport. Chaque véhicule endommagé mais pas détruit doit être récupéré, transporté, évalué, réparé, renvoyé au front. Chaque perte totale – comme ces 71 véhicules et camions-citernes du dernier bilan – vient alourdir la charge sur un système logistique déjà sous tension. Les chauffeurs, les mécaniciens, les planificateurs logistiques sont devenus aussi essentiels à l’effort de guerre que les artilleurs ou les équipages de chars. Et eux aussi s’usent, eux aussi prennent des risques, eux aussi figurent, de façon less discrète, dans ces colonnes de “personnel éliminé”.
En ciblant ces éléments, l’Ukraine ne cherche pas seulement à “faire mal” à court terme, mais à dégrader la capacité de régénération de l’appareil militaire russe. Une armée qui ne parvient plus à réparer correctement ses blindés, qui manque de pièces détachées, qui doit étirer ses convois parce qu’elle a perdu une partie de ses camions, finit par devenir moins mobile, moins réactive, plus vulnérable. Les 1 060 soldats, le char, les six blindés, les 71 véhicules de ce bilan sont les pièces visibles d’un mécanisme plus large : celui d’une économie qui, pour continuer à soutenir l’effort de guerre, doit accepter de sacrifier une part croissante de sa richesse, de son capital humain et de sa stabilité future.
On dit souvent que “l’économie de guerre” est une notion abstraite, un concept de manuel. Mais quand je lis ces bilans, quand je vois ce qu’ils impliquent pour les usines, les ateliers, les chauffeurs, je n’arrive plus à voir ça comme un simple modèle théorique. Ce sont des villes entières qui vivent au rythme des commandes militaires, des familles qui dépendent de salaires versés par des industries dont la survie est liée à celle du conflit. Et je ne peux pas m’empêcher de penser, avec un malaise tenace, que chaque char détruit, chaque camion brûlé nourrit une boucle perverse : il faudra produire plus pour remplacer, donc prolonger l’effort, donc prolonger la guerre. C’est une spirale dont il est très difficile de sortir.
Section 11 : Comment les alliés lisent ces bilans quotidiens

À Washington, Bruxelles, Berlin : des chiffres qui pèsent sur les décisions
Les chiffres du jour – 1 060 militaires russes, un char, six blindés, 14 systèmes d’artillerie, 239 drones, 71 véhicules – ne restent pas confinés aux communiqués ukrainiens. Ils sont scrutés dans les capitales occidentales, intégrés dans des tableaux de synthèse, discutés dans des réunions où se décident l’ampleur et la nature de l’aide à l’Ukraine. Pour les décideurs américains ou européens, ces bilans servent à répondre à plusieurs questions cruciales : l’Ukraine parvient-elle encore à infliger des pertes significatives ? La capacité offensive russe est-elle réellement entamée ? Les systèmes livrés – artillerie, défense aérienne, drones – produisent-ils un effet concret sur le champ de bataille ? Dans cette perspective, une journée à “+1 060” côté russe est interprétée comme la preuve que l’aide fournie n’est pas un puits sans fond, mais qu’elle se traduit par une érosion réelle de l’appareil militaire adverse.
Mais ces chiffres nourrissent aussi des débats plus ambivalents. Certains y voient la preuve que la stratégie actuelle – soutien militaire fort à l’Ukraine, objectif de rendre la guerre trop coûteuse pour Moscou – fonctionne et doit être poursuivie. D’autres y lisent, au contraire, la confirmation que le conflit s’enlise dans une logique où ni la Russie ni l’Ukraine ne peuvent atteindre rapidement leurs objectifs, malgré des pertes colossales. Pour eux, chaque “1 060” supplémentaire renforce l’argument en faveur d’une pression diplomatique plus forte pour pousser vers un compromis. Les mêmes chiffres, les mêmes colonnes, peuvent donc alimenter des lectures radicalement différentes. C’est ce qui rend la position des alliés si délicate : ils doivent interpréter ces données sans se laisser enfermer ni dans le triomphalisme ni dans le défaitisme.
Un indicateur parmi d’autres, mais impossible à ignorer
Il serait exagéré de dire que ces bilans quotidiens déterminent à eux seuls la politique des alliés. Ils sont un indicateur parmi d’autres : la situation sur le terrain, l’état des stocks de munitions, les sondages d’opinion, les évolutions politiques internes aux pays membres de l’OTAN, les signaux envoyés par Moscou. Mais ils ont un poids symbolique puissant. Un chiffre comme 1 060 pertes russes rappelle à ceux qui siègent loin du front que cette guerre n’est pas un simple bras de fer diplomatique, mais un affrontement qui broie des vies à un rythme quasi industriel. Cela peut, parfois, renforcer la détermination à soutenir l’Ukraine, au nom d’une justice minimale : si un peuple est prêt à payer un tel prix pour sa souveraineté, comment justifier un retrait de soutien ?
Dans le même temps, ces bilans peuvent susciter une fatigue, voire une lassitude, chez certains responsables : l’impression d’être face à des colonnes de chiffres qui se ressemblent, sans que la situation stratégique ne change vraiment. C’est là que se joue une partie de l’avenir de la guerre : la capacité de Kyiv à montrer que ces pertes ne sont pas seulement un “coût” pour la Russie, mais qu’elles s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, susceptible de déboucher sur une configuration plus favorable. Sans cela, le risque est réel de voir certains alliés glisser vers une position plus ambiguë, où l’on continue d’armer l’Ukraine tout en multipliant les signaux en faveur d’un “compromis rapide”, même si ce compromis entérine des pertes territoriales durables.
Je me mets parfois à la place de ces diplomates, assis dans des salles capitonnées, devant des tableaux où sont alignés les “+1 060”, “+1 170”, “+910” des dernières semaines. Comment ne pas ressentir une forme de vertige, voire de découragement, devant cette mécanique qui semble tourner sans fin ? Et pourtant, ce serait trop facile de se réfugier dans cette fatigue. Parce que, pour ceux qui se battent et qui meurent, ces chiffres ne sont pas des lignes dans un tableau : ce sont des jours de vie arrachés, des futurs détruits. En tant que chroniqueur, je n’ai pas le pouvoir de décider de l’aide militaire ou des négociations. Mais j’ai au moins celui de rappeler que, derrière ces bilans, il y a une responsabilité partagée : celle de ne pas laisser cette guerre se transformer en simple routine diplomatique.
Section 12 : Droit international, responsabilité et banalisation des morts

Des colonnes de chiffres, mais aussi des obligations juridiques
On pourrait croire que ces bilans de pertes, avec leur vocabulaire sec – “personnel”, “véhicules”, “équipement spécial” – relèvent uniquement du langage militaire. Pourtant, ils renvoient aussi à une dimension plus discrète, mais fondamentale : celle du droit international humanitaire. Chaque jour où 1 060 militaires sont mis hors de combat, des hôpitaux de campagne sont saturés, des prisonniers sont capturés, des corps sont laissés sur le terrain. Les belligérants ont des obligations précises : traiter les blessés, respecter les prisonniers, identifier les morts, informer les familles. Ces obligations sont parfois respectées, parfois bafouées. Les bilans officiels n’en parlent pas, mais ils en sont le préambule chiffré. On ne peut pas prétendre se soucier du droit tout en considérant ces colonnes comme des abstractions neutres.
Dans cette perspective, la manière dont nous parlons de ces pertes compte aussi. Réduire systématiquement les soldats adverses à des “unités éliminées” sans jamais évoquer leur statut humain nourrit une forme de déshumanisation qui, historiquement, a souvent servi de terreau à des violations graves. Cela ne signifie pas qu’il faille mettre sur le même plan l’agresseur et l’agressé, ni effacer les responsabilités. Cela signifie simplement que, même face à une armée qui mène une guerre d’invasion, le cadre juridique reste un repère nécessaire. Les “1 060 militaires russes” de ce bilan ne sont pas des “cibles” abstraites : ce sont des personnes qui, en droit, ont droit à un traitement digne, même tombées entre les mains de l’ennemi ou abandonnées par leur propre hiérarchie.
Le risque de la banalisation : quand la mort devient une métrique
À force de voir ces bilans défiler, il existe un risque réel : celui de la banalisation. Quand “+1 060” succède à “+1 170” puis à “+960”, l’esprit peut se mettre à traiter ces chiffres comme des unités de mesure, au même titre que des indicateurs économiques ou des statistiques sanitaires. C’est une forme de défense psychologique : pour ne pas être submergés par le vertige, nous simplifions, nous rangeons, nous comparons. Mais à long terme, cette habitude peut nous rendre insensibles à ce qui se joue réellement. Si la mort de milliers de personnes devient une métrique comme une autre, que restera-t-il de notre capacité à être choqués, à refuser l’inacceptable ?
C’est là que notre responsabilité, en tant que lecteurs, commentateurs, décideurs, devient cruciale. Nous ne pouvons pas empêcher la publication de ces bilans, ni les transformer en hommages individuels à chaque personne disparue. Mais nous pouvons refuser de les consommer comme un simple contenu parmi d’autres, en les replaçant, chaque fois que possible, dans leur contexte humain. Les “1 060” de ce jour sont des pères, des fils, des frères, des amis. Ils ont été envoyés dans une guerre que beaucoup n’avaient pas choisie. Reconnaître cela ne revient pas à excuser l’agression russe, mais à maintenir, malgré tout, une forme de cohérence morale. Sans elle, nous risquons de perdre plus qu’une guerre : nous risquons de perdre notre capacité à être touchés par la souffrance des autres, même quand ces autres portent l’uniforme d’un pays que nous condamnons.
Je ne veux pas m’habituer à ces chiffres. Je ne veux pas les lire en buvant mon café comme si de rien n’était. Et pourtant, je sais que c’est exactement ce qui menace : la routine, la répétition, la fatigue. Écrire sur “1 060 militaires” de plus, c’est aussi lutter contre cette pente glissante. Ce que j’essaie de faire, maladroitement parfois, c’est de garder une ligne intérieure : ne pas nier la nécessité de nommer les choses, de compter, d’analyser, mais refuser de laisser ces nombres devenir un simple bruit de fond. Si nous perdons cette bataille-là, si nous cessons d’être heurtés par ces bilans, alors quelque chose d’essentiel en nous aura déjà été emporté par la guerre.
Section 13 : Quand +1 060 devient un chiffre parmi d’autres

La fatigue compassionnelle, l’ennemi silencieux
À mesure que la guerre s’installe dans la durée, un phénomène bien connu des psychologues apparaît : la fatigue compassionnelle. Au début, chaque nouvelle attaque, chaque nouveau bilan provoque une réaction forte : indignation, tristesse, mobilisation. Puis, peu à peu, le cerveau s’adapte, par simple mécanisme de survie émotionnelle. Ce qui aurait été intolérable hier devient “encore une fois”. C’est particulièrement vrai pour les publics éloignés du front, en Europe occidentale, en Amérique du Nord, qui reçoivent ces informations filtrées par l’écran, mêlées à des préoccupations quotidiennes sans rapport. Pour eux, les “1 060” d’aujourd’hui viennent s’ajouter à une longue série, où l’unité de mesure s’estompe peu à peu. Est-ce que 1 060 est “pire” que 960 ? que 1 170 ? Le cerveau, saturé, cesse de faire la différence.
Ce glissement est dangereux, parce qu’il ouvre la porte à une forme de résignation passive. Si “tout est terrible”, alors plus rien ne l’est vraiment. Les bilans quotidiens deviennent un décor, une toile de fond tragique mais acceptée, comme la météo ou les fluctuations des marchés. Dans ce contexte, la phrase “1 060 militaires russes mis hors de combat en 24 heures” risque de ne plus provoquer ce qu’elle devrait provoquer : un arrêt, un silence, un effort de compréhension. À la place, elle devient un élément de plus dans un flux qui nous dépasse. C’est pour cela que la manière dont on raconte ces chiffres compte autant que les chiffres eux-mêmes. Les nommer ne suffit pas : il faut leur rendre, autant que possible, leur capacité à nous atteindre.
Réapprendre à lire les bilans de guerre
Peut-on réapprendre à lire ces bilans autrement ? Peut-on se forcer à voir, derrière “+1 060”, autre chose qu’un nombre ? Une piste consiste à replacer ces données dans des comparaisons qui parlent. 1 060 militaires, c’est l’équivalent de plusieurs bataillons décimés en un jour. C’est plus que la population de certains villages. C’est un amphithéâtre universitaire rempli de personnes qui, la veille, existaient encore. Une autre piste consiste à regarder les noms, quand ils émergent, à écouter les témoignages de familles, de survivants, même lacunaires. Cela ne supprimera pas la distance, mais cela peut empêcher la désincarnation totale de la guerre.
Pour les médias, les chroniqueurs, les analystes, la responsabilité est double : ne pas sur-spectaculariser ces bilans – au risque d’en faire un spectacle obscène – mais ne pas les enfouir non plus sous un jargon technique. Nous avons besoin de mots qui disent ce que ces chiffres signifient, sans les transformer en instrument de voyeurisme. C’est un équilibre difficile, je le sais, et je ne prétends pas l’atteindre à chaque fois. Mais renoncer à cet effort reviendrait à abandonner la guerre aux seuls chiffres et aux seuls stratèges, en laissant de côté ceux qui, précisément, en subissent la première violence : les êtres humains pris dans cette machine à détruire.
Parfois, j’ai presque honte de la facilité avec laquelle j’aligne ces nombres : 1 060, 11 387, 23 678… Ils roulent sous les doigts comme des données neutres, alors qu’ils condensent une somme de souffrances qui m’échappe totalement. La seule façon que j’ai trouvée pour ne pas me perdre là-dedans, c’est de me forcer à imaginer, au moins quelques secondes, des visages, des lieux, des scènes concrètes derrière ces chiffres. Ce n’est pas grand-chose, je le sais. Mais c’est ma manière à moi de résister à la tentation de traiter ces bilans comme des statistiques de plus. Tant que j’y parviens, même imparfaitement, je me dis que tout n’est pas encore perdu en moi.
Section 14 : Les scénarios de la suite du conflit

Continuer la guerre d’attrition : le scénario du pire… et du probable
En regardant ce bilan – 1 060 militaires russes, un char, six blindés, 14 pièces d’artillerie, 239 drones, 71 véhicules – on pourrait être tenté de chercher le “tournant”, le moment où la courbe s’inverse, où l’on pourrait dire : là, ça bascule. La vérité, c’est qu’une guerre d’attrition offre rarement ce type de moment spectaculaire. Le scénario le plus probable, si rien ne change radicalement sur le plan politique ou militaire, est celui d’une poursuite de cette logique : des lignes de front qui bougent lentement, des pertes continues, des sociétés qui s’adaptent malgré tout, des alliés qui ajustent leur soutien au gré des cycles électoraux et des crises. Dans ce cadre, les “1 060” d’aujourd’hui deviendront, demain, simplement une des nombreuses journées lourdes parmi d’autres, sauf si une accumulation de facteurs finit par faire craquer l’un des deux camps.
Ce scénario est le plus inquiétant, parce qu’il est à la fois plausible et insidieux. Il ne promet ni victoire rapide ni défaite nette, mais une forme de conflit semi-permanent, normalisé, intégré aux routines institutionnelles. L’Ukraine continuerait de défendre son territoire au prix d’un effort colossal, la Russie poursuivrait son offensive par vagues, en espérant que le temps joue pour elle, les alliés tenteraient de maintenir l’équilibre entre soutien et gestion de leurs propres contraintes internes. Dans cette configuration, chaque bilan comme celui-ci, à 1 060 pertes russes, deviendrait un rappel récurrent de ce que coûte, concrètement, l’absence de solution politique. Et plus cette situation durerait, plus il serait difficile, émotionnellement comme diplomatiquement, de revenir en arrière.
Brisures possibles : escalade, négociation, effondrement partiel
Cela ne signifie pas, pour autant, que l’avenir soit écrit. Plusieurs types de “brisures” restent possibles. Une escalade militaire majeure – par exemple, l’emploi de nouveaux systèmes d’armes à plus longue portée, ou un élargissement du théâtre des opérations – pourrait modifier brutalement la dynamique des pertes, en la rendant encore plus meurtrière. Une ouverture de négociations, si elle était sérieuse et soutenue par les principaux acteurs, pourrait transformer ces bilans en données historiques, plutôt qu’en flux quotidien. Un effondrement partiel d’une des armées, sur un secteur clé du front, pourrait aussi créer un basculement, forçant l’autre camp à réviser ses objectifs. Dans chacun de ces scénarios, les chiffres comme ceux du jour prendraient une nouvelle signification : celle de la période “avant”, celle où la machine tournait à plein régime.
Ce qui est certain, c’est que, pour sortir de cette spirale, il faudra, à un moment donné, affronter la question centrale que ces “1 060” posent sans la formuler : jusqu’où est-on prêt à aller, en vies humaines et en ressources, pour atteindre tel ou tel objectif politique ? Pour l’Ukraine, la réponse est liée à sa survie même en tant qu’État souverain. Pour la Russie, elle est liée au maintien d’un récit impérial et à la survie d’un régime. Pour les alliés, elle est liée à la crédibilité de leurs engagements et à leur vision de l’ordre européen. Tant que cette question restera sans réponse claire, les bilans quotidiens continueront de tomber, comme des rappels insistants de ce qu’il en coûte de laisser une guerre s’installer sans horizon défini.
Je n’ai pas de scénario miracle. Je ne crois pas à la solution simple qui résoudrait tout en quelques mois. Mais je sais une chose : tant que nous accepterons de lire des chiffres comme “+1 060” sans exiger, en parallèle, que l’on parle sérieusement d’issues politiques, nous contribuerons, même passivement, à la prolongation de cette logique d’attrition. Je ne dis pas qu’il suffit de “vouloir la paix” pour qu’elle apparaisse. Je dis simplement qu’on ne peut pas se contenter de commenter, jour après jour, la comptabilité de la guerre sans poser – et reposer – la question : vers quoi tout cela est-il censé nous mener ?
Conclusion : Refuser de s’habituer à la comptabilité macabre

Un dernier chiffre, ou un signal d’alarme ?
Alors, que faire de ce bilan précis : 1 060 militaires russes mis hors de combat en une journée, un char, six blindés, 14 systèmes d’artillerie, 239 drones, 71 véhicules ? On pourrait le ranger dans la longue liste des bilans quotidiens, l’ajouter à un fichier, tracer une courbe, calculer une moyenne. On pourrait, aussi, le regarder comme un signal d’alarme. Il dit que la guerre n’est pas “gelée”, qu’elle ne se résume pas à des manœuvres diplomatiques ou à des discours, mais qu’elle continue de broyer des corps et des ressources à un rythme que notre esprit peine à saisir. Il dit que la stratégie actuelle – une guerre d’attrition assumée, où l’on espère que l’adversaire craquera en premier – a un coût qui augmente chaque jour, pour les soldats, pour les sociétés, pour l’ordre international.
Si nous décidons de voir ce chiffre comme un simple “bilan de plus”, alors nous acceptons, implicitement, que cette logique se poursuive. Si nous le voyons comme un signal d’alarme, alors il nous oblige à poser des questions inconfortables : quelles sont les lignes rouges ? quelles sont les conditions minimales d’un accord acceptable pour les parties ? jusqu’où peut-on pousser une société, qu’elle soit ukrainienne ou russe, dans cette épreuve d’endurance ? Ces questions n’ont pas de réponses faciles, mais refuser de les poser, c’est déjà y répondre – en faveur du statu quo, c’est-à-dire en faveur de la poursuite de cette comptabilité macabre.
Garder vivant notre capacité à être heurtés
La seule certitude que je retire de ce bilan, c’est celle-ci : nous n’avons pas le droit de nous y habituer. Pas en tant que citoyens, pas en tant qu’observateurs, pas en tant que décideurs. Nous pouvons accepter que la guerre, dans sa brutalité, produise des chiffres comme “1 060” sans que cela s’arrête du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas accepter que ces chiffres cessent de nous heurter. Tant que nous serons encore capables de ressentir, face à eux, une forme de vertige, de colère, de tristesse, il restera un espace pour exiger autre chose que la perpétuation d’une machine à pertes. Quand plus rien ne nous fera réagir, quand les bilans deviendront un simple fond sonore, alors la guerre aura gagné quelque chose de plus précieux que du territoire : notre capacité à considérer chaque vie comme irremplaçable.
Le bilan du jour, avec ses 1 060 soldats russes, son char, ses six blindés, ses 14 pièces d’artillerie, ses 239 drones, ses 71 véhicules, ne changera pas à lui seul le cours du conflit. Mais il peut changer quelque chose en nous, si nous le laissons faire : il peut nous rappeler que, derrière chaque nombre, il y a des vies, des choix politiques, des responsabilités. Il peut nous rappeler que la guerre en Ukraine n’est pas une abstraction lointaine, mais une blessure ouverte au cœur de notre continent. Et il peut, peut-être, nous pousser à refuser, encore et encore, que la comptabilité des morts devienne une routine acceptable.
Je ne sais pas combien de temps encore nous lirons des chiffres comme “+1 060” dans les bilans quotidiens. Je sais seulement que je veux continuer à les regarder avec inconfort, avec cette boule dans la gorge qui me rappelle que ce n’est pas normal, que ça ne doit jamais le devenir. En tant que chroniqueur, je n’ai pas la naïveté de croire qu’un article peut changer la stratégie des états-majors. Mais si ce texte parvient, ne serait-ce qu’un peu, à fissurer l’indifférence, à redonner du poids à ces chiffres, alors il aura au moins servi à une chose : empêcher, pour un moment encore, que la guerre ne se transforme en fond d’écran statistique.
Sources

Sources primaires
Les données chiffrées sur les pertes russes quotidiennes – incluant les 1 060 militaires mis hors de combat, le char, les six véhicules blindés, les 14 systèmes d’artillerie, les 239 drones et les 71 véhicules et camions-citernes – proviennent des communiqués officiels de l’état-major des forces armées ukrainiennes publiés le 1ᵉʳ décembre 2025, relayés notamment par l’agence officielle ArmyInform et par des médias ukrainiens en langue anglaise. Ces bilans détaillent également les pertes cumulées depuis le 24 février 2022, indiquant environ 1 173 920 militaires russes mis hors de combat, ainsi que plus de 11 387 chars, 23 678 véhicules blindés, 34 754 systèmes d’artillerie, 1 552 lance-roquettes multiples, 1 253 systèmes de défense aérienne, 430 avions, 347 hélicoptères, 86 090 drones, 4 024 missiles de croisière, 28 navires, 1 sous-marin, 68 583 véhicules et camions-citernes et 4 010 équipements spéciaux, selon ces mêmes rapports datés du 1ᵉʳ décembre 2025.
Ces informations sont recoupées avec des agrégateurs de données publics qui compilent quotidiennement les bilans de l’état-major ukrainien (notamment des plateformes de suivi des pertes russes basées sur les chiffres officiels) et avec des synthèses de médias ukrainiens de référence, qui citent explicitement ces communiqués et en rappellent la nature : estimations militaires publiées à des fins d’information et de communication stratégique, dont la vérification indépendante complète reste limitée dans le contexte du brouillard de guerre.
Sources secondaires
Pour contextualiser l’ampleur de ces pertes, l’article s’appuie sur des analyses publiées par des médias ukrainiens et internationaux spécialisés dans le suivi du conflit, ainsi que sur des centres de recherche occidentaux qui évaluent les pertes globales des forces russes et ukrainiennes depuis 2022. Des rapports de think tanks et de projets de suivi indépendants – combinant imagerie satellite, sources ouvertes et données officielles – offrent un ordre de grandeur des pertes cumulées (personnel, blindés, artillerie, aéronefs, drones, véhicules) et confirment la nature hautement attritionnelle de la guerre actuelle, en soulignant les limites de toute estimation chiffrée dans un contexte de conflit actif.
Enfin, des travaux académiques et des synthèses publiés en 2024 et 2025 sur la guerre d’attrition, l’économie de guerre russe, le rôle des drones et l’impact des pertes massives sur la stabilité politique et la cohésion sociale en Russie et en Ukraine ont été mobilisés pour éclairer les enjeux de long terme : capacité de régénération des forces, adaptation industrielle, fatigue des sociétés, débats dans les capitales alliées, risques d’escalade ou de stagnation prolongée. Ces sources secondaires ne fournissent pas de chiffres identiques à ceux des communiqués ukrainiens, mais elles en confirment la tendance générale : une guerre à très haut coût humain et matériel, dont les bilans quotidiens – tel celui des 1 060 pertes russes – ne sont que la photographie partielle d’un désastre beaucoup plus vaste.
Sources
Sources primaires
Les données chiffrées sur les pertes russes quotidiennes – incluant les 1 060 militaires mis hors de combat, le char, les six véhicules blindés, les 14 systèmes d’artillerie, les 239 drones et les 71 véhicules et camions-citernes – proviennent des communiqués officiels de l’état-major des forces armées ukrainiennes publiés le 1ᵉʳ décembre 2025, relayés notamment par l’agence officielle ArmyInform et par des médias ukrainiens en langue anglaise. Ces bilans détaillent également les pertes cumulées depuis le 24 février 2022, indiquant environ 1 173 920 militaires russes mis hors de combat, ainsi que plus de 11 387 chars, 23 678 véhicules blindés, 34 754 systèmes d’artillerie, 1 552 lance-roquettes multiples, 1 253 systèmes de défense aérienne, 430 avions, 347 hélicoptères, 86 090 drones, 4 024 missiles de croisière, 28 navires, 1 sous-marin, 68 583 véhicules et camions-citernes et 4 010 équipements spéciaux, selon ces mêmes rapports datés du 1ᵉʳ décembre 2025.
Ces informations sont recoupées avec des agrégateurs de données publics qui compilent quotidiennement les bilans de l’état-major ukrainien (notamment des plateformes de suivi des pertes russes basées sur les chiffres officiels) et avec des synthèses de médias ukrainiens de référence, qui citent explicitement ces communiqués et en rappellent la nature : estimations militaires publiées à des fins d’information et de communication stratégique, dont la vérification indépendante complète reste limitée dans le contexte du brouillard de guerre.
Sources secondaires
Pour contextualiser l’ampleur de ces pertes, l’article s’appuie sur des analyses publiées par des médias ukrainiens et internationaux spécialisés dans le suivi du conflit, ainsi que sur des centres de recherche occidentaux qui évaluent les pertes globales des forces russes et ukrainiennes depuis 2022. Des rapports de think tanks et de projets de suivi indépendants – combinant imagerie satellite, sources ouvertes et données officielles – offrent un ordre de grandeur des pertes cumulées (personnel, blindés, artillerie, aéronefs, drones, véhicules) et confirment la nature hautement attritionnelle de la guerre actuelle, en soulignant les limites de toute estimation chiffrée dans un contexte de conflit actif.
Enfin, des travaux académiques et des synthèses publiés en 2024 et 2025 sur la guerre d’attrition, l’économie de guerre russe, le rôle des drones et l’impact des pertes massives sur la stabilité politique et la cohésion sociale en Russie et en Ukraine ont été mobilisés pour éclairer les enjeux de long terme : capacité de régénération des forces, adaptation industrielle, fatigue des sociétés, débats dans les capitales alliées, risques d’escalade ou de stagnation prolongée. Ces sources secondaires ne fournissent pas de chiffres identiques à ceux des communiqués ukrainiens, mais elles en confirment la tendance générale : une guerre à très haut coût humain et matériel, dont les bilans quotidiens – tel celui des 1 060 pertes russes – ne sont que la photographie partielle d’un désastre beaucoup plus vaste.
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.