
Une terminologie d’extrême droite dans un document officiel
Commençons par le plus choquant, le plus insupportable, le plus révélateur aussi de ce qui se passe dans la tête de cette administration. Le document utilise l’expression « civilizational erasure » — effacement civilisationnel — pour décrire ce qui attend l’Europe. Pas déclin. Pas crise. Pas difficultés. Non : effacement. Comme si le continent européen, avec ses 450 millions d’habitants, ses démocraties séculaires, ses universités prestigieuses, ses industries de pointe, était en train de disparaître purement et simplement. Et pourquoi cet effacement, selon Washington ? À cause de l’Union européenne et des « organismes transnationaux » qui « sapent la liberté politique et la souveraineté ». À cause des politiques migratoires qui « transforment le continent et créent des conflits ». À cause de la censure de la liberté d’expression et de la suppression de l’opposition politique. À cause des taux de natalité en chute libre et de la perte des identités nationales. Lisez bien cette liste. C’est exactement le discours de l’extrême droite européenne. C’est le programme de l’AfD en Allemagne, du Rassemblement National en France, de la Lega en Italie, du PVV aux Pays-Bas. Mot pour mot.
Ce n’est pas un hasard. C’est une stratégie délibérée. Le document va jusqu’à affirmer que « dans quelques décennies au plus tard, certains membres de l’OTAN deviendront majoritairement non-européens » — une référence à peine voilée à la théorie du grand remplacement, cette idée complotiste selon laquelle l’immigration musulmane et africaine va « remplacer » les populations blanches européennes. Oui, vous avez bien lu. La Maison-Blanche, le bureau ovale, le cœur du pouvoir américain, reprend dans un document officiel une théorie raciste popularisée par des suprémacistes blancs et des terroristes d’extrême droite. Le texte poursuit en suggérant que ces changements démographiques rendront ces pays « méconnaissables dans 20 ans ou moins » et qu’il n’est « pas évident » qu’ils auront « des économies et des armées assez fortes pour rester des alliés fiables ». Traduction : une Europe moins blanche sera une Europe moins fiable. Une Europe multiethnique ne mérite pas la confiance de Washington. C’est du racisme pur et simple, habillé dans le langage feutré de la diplomatie. Et c’est maintenant la position officielle des États-Unis d’Amérique.
L’Europe « méconnaissable dans 20 ans »
Le document ne se contente pas de diagnostiquer cet « effacement civilisationnel ». Il en tire des conclusions stratégiques. Si l’Europe est condamnée à disparaître, pourquoi continuer à investir dans sa défense ? Pourquoi maintenir des dizaines de milliers de soldats américains sur le continent ? Pourquoi garantir la sécurité de pays qui, selon Washington, sont en train de se saborder eux-mêmes ? La logique est implacable, et elle mène directement à la conclusion que l’administration Trump veut imposer : l’Europe doit se débrouiller seule. Le texte l’affirme sans détour : « Les jours où les États-Unis soutenaient l’ordre mondial entier comme Atlas sont terminés. » Atlas qui portait le monde sur ses épaules. Une métaphore grandiose pour décrire ce que Washington considère comme un fardeau insupportable. Mais cette métaphore révèle aussi quelque chose de plus profond : une vision de l’Amérique comme victime, exploitée par des alliés ingrats qui profitent de sa générosité sans rien donner en retour. C’est faux, bien sûr. L’Europe a soutenu les États-Unis en Afghanistan pendant 20 ans. Les soldats européens sont morts à Kaboul pour défendre des intérêts américains. Les économies européennes ont accepté des sanctions contre la Russie qui leur ont coûté des centaines de milliards d’euros, pendant que les États-Unis vendaient leur gaz de schiste à prix d’or. Mais dans la vision trumpienne du monde, rien de tout cela ne compte. Seul compte le fait que l’Europe ne dépense pas assez pour sa propre défense, qu’elle dépend encore de la protection américaine, qu’elle ose critiquer les politiques de Washington.
Et donc, selon ce document, l’Europe doit changer. Radicalement. Rapidement. Le texte appelle à « cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l’Europe au sein des nations européennes » — une formulation extraordinaire qui signifie en clair : Washington va soutenir activement les partis et les mouvements qui s’opposent aux politiques actuelles de l’UE. C’est de l’ingérence, assumée, revendiquée, théorisée. Les États-Unis vont financer, encourager, légitimer les forces politiques qui partagent leur vision de l’Europe : une Europe des nations, hostile à l’immigration, méfiante envers les institutions supranationales, alignée sur les positions américaines en matière de commerce et de sécurité. Le document salue d’ailleurs la montée des « partis patriotiques européens » — un euphémisme transparent pour désigner l’extrême droite. L’AfD en Allemagne, qui vient d’être classée comme organisation d’extrême droite par les services de renseignement allemands. Le Rassemblement National en France, héritier du Front National fondé par un ancien Waffen-SS. La Lega en Italie, qui a longtemps flirté avec le séparatisme et le racisme anti-méridional. Voilà les « patriotes » que Washington veut voir au pouvoir en Europe. Voilà les alliés de la nouvelle Amérique trumpienne. Et si vous trouvez ça inquiétant, vous avez raison. Parce que ça l’est.
Il y a des moments où la colère ne suffit plus. Où il faut aller au-delà de l’indignation, au-delà de la protestation, pour toucher quelque chose de plus profond. Une rage froide, calculée, qui refuse de se laisser intimider. Parce que ce document, ce n’est pas juste une insulte. C’est une déclaration de guerre idéologique. Washington nous dit : votre modèle de société est mort, vos valeurs sont obsolètes, votre avenir n’existe pas. Et nous devrions accepter ça ? Nous devrions baisser la tête et remercier l’Amérique pour ses conseils éclairés ? Non. Mille fois non. L’Europe a ses problèmes, oui. Ses contradictions, ses échecs, ses hypocrisies. Mais elle reste un continent de libertés, de droits, de solidarité. Un continent où on ne laisse pas les gens mourir faute d’assurance maladie. Où on ne met pas des enfants en cage à la frontière. Où on ne glorifie pas les milliardaires qui ne paient pas d’impôts. Et si ça fait de nous des « civilisations en voie d’effacement », alors qu’il en soit ainsi. Je préfère disparaître en défendant mes valeurs que survivre en les trahissant.
L'OTAN n'est plus une "alliance en expansion perpétuelle"
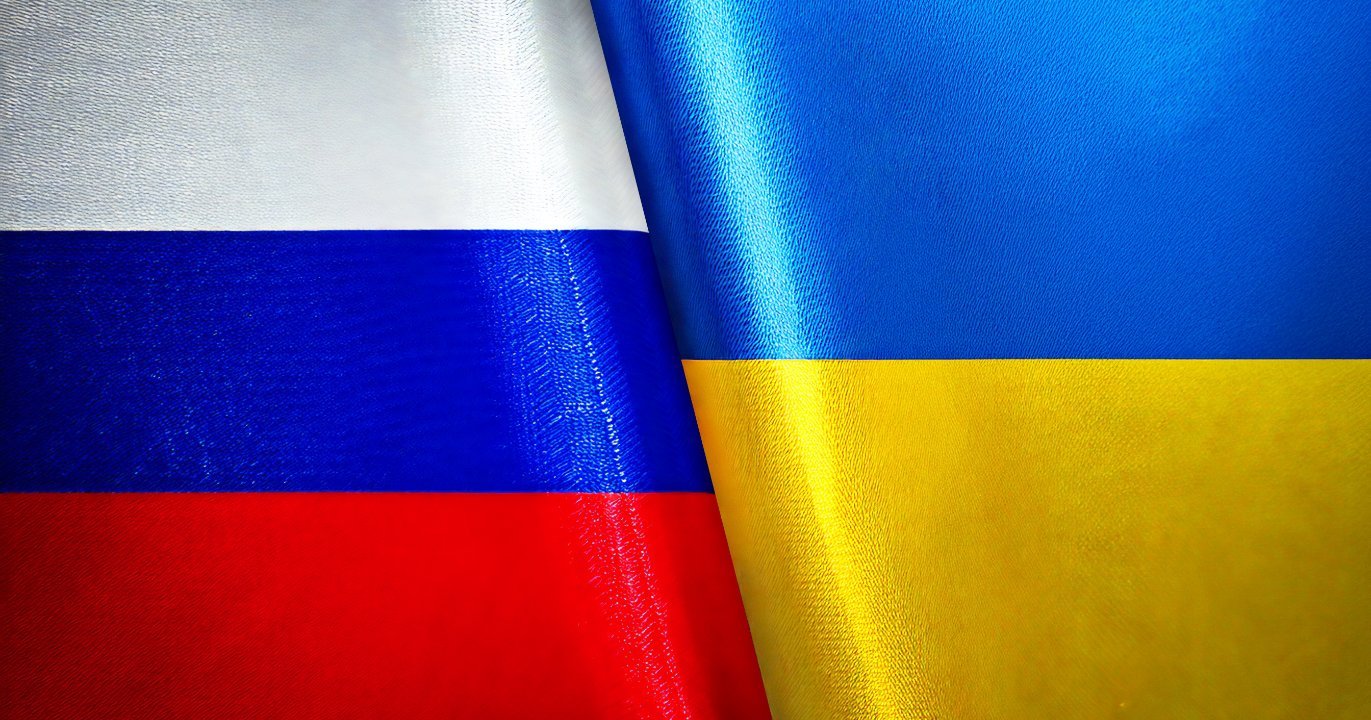
La fin de la politique de porte ouverte
Passons maintenant à ce qui constitue peut-être le changement le plus radical de ce document : la position sur l’OTAN. Depuis la fin de la Guerre froide, l’Alliance atlantique a fonctionné selon un principe simple : la politique de porte ouverte. Tout pays européen démocratique qui le souhaite peut demander à adhérer, et si les membres actuels sont d’accord, il est accepté. C’est ainsi que l’OTAN est passée de 16 membres en 1990 à 32 aujourd’hui, intégrant les anciens pays du Pacte de Varsovie, les États baltes, les Balkans occidentaux. Cette expansion a été présentée comme un succès historique : la victoire de la démocratie sur le totalitarisme, l’extension de la zone de paix et de stabilité en Europe. Mais pour Moscou, c’était une provocation intolérable, un encerclement stratégique, une menace existentielle. Et maintenant, Washington donne raison à Moscou. Le document de stratégie nationale affirme qu’il est temps de « mettre fin à la perception, et d’empêcher la réalité, de l’OTAN comme une alliance en expansion perpétuelle ». Lisez bien cette phrase. « Mettre fin à la perception » — c’est-à-dire arrêter de dire que l’OTAN peut s’élargir. « Empêcher la réalité » — c’est-à-dire s’assurer qu’elle ne s’élargisse effectivement plus. C’est un gel de l’expansion de l’OTAN, pur et simple. Un cadeau inestimable à Vladimir Poutine, qui réclame exactement cela depuis des années.
Les implications sont vertigineuses. Cela signifie que l’Ukraine, qui a officiellement demandé son adhésion à l’OTAN en septembre 2022, n’y entrera jamais. Cela signifie que la Géorgie, qui aspire à rejoindre l’Alliance depuis 2008, peut abandonner tout espoir. Cela signifie que la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, tous ces pays qui voyaient dans l’OTAN une garantie de sécurité face à l’agressivité russe ou aux tensions régionales, sont laissés à leur sort. Et cela signifie surtout que Poutine a gagné. Que son invasion de l’Ukraine, loin de provoquer un renforcement de l’OTAN, a abouti au résultat inverse : un gel de l’expansion, une reconnaissance implicite que Moscou a un droit de veto sur l’architecture de sécurité européenne. Le document va même plus loin en affirmant que la gestion des relations européennes avec la Russie « nécessitera un engagement diplomatique américain significatif, à la fois pour rétablir les conditions de stabilité stratégique à travers la masse continentale eurasiatique, et pour atténuer le risque de conflit entre la Russie et les États européens ». Traduction : Washington se positionne comme médiateur entre l’Europe et la Russie, pas comme allié de l’Europe contre la Russie. C’est un renversement complet de la logique qui a prévalu depuis 1949, date de création de l’OTAN.
Un cadeau empoisonné à Vladimir Poutine
Poutine doit jubiler. Depuis le début de son règne, il n’a cessé de dénoncer l’expansion de l’OTAN comme la principale menace pour la sécurité russe. Dans son discours du 24 février 2022, juste avant l’invasion de l’Ukraine, il a passé des heures à expliquer que l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’OTAN était une ligne rouge infranchissable, une menace existentielle pour la Russie, une raison suffisante pour déclencher une guerre. À l’époque, les Occidentaux ont rejeté cet argument comme une manipulation cynique, un prétexte pour justifier une agression impérialiste. Mais aujourd’hui, Trump lui donne raison. En affirmant que l’OTAN ne doit plus s’élargir, Washington valide rétroactivement le discours de Poutine. Pire : le document suggère que les Européens eux-mêmes sont responsables de la guerre en Ukraine parce qu’ils ont entretenu des « attentes irréalistes » concernant le conflit. Selon le texte, de nombreux gouvernements européens sont des « gouvernements minoritaires instables… dont beaucoup foulent aux pieds les principes de base de la démocratie pour supprimer l’opposition ». Et ces gouvernements, affirme le document, ignorent la volonté de leur peuple, qui veut la paix, à cause de la « subversion des processus démocratiques ». C’est une accusation stupéfiante. Washington accuse les démocraties européennes d’être antidémocratiques parce qu’elles soutiennent l’Ukraine contre l’agression russe.
Cette inversion de la réalité est hallucinante. Les sondages montrent que les Européens soutiennent massivement l’aide à l’Ukraine, même si ce soutien s’accompagne d’inquiétudes sur le coût et la durée du conflit. Les gouvernements européens, loin de « supprimer l’opposition », font face à des débats démocratiques intenses sur leur politique ukrainienne. Mais dans la vision trumpienne, tout cela n’est que manipulation et censure. La « vraie » volonté du peuple européen, selon Washington, serait de faire la paix avec la Russie, d’accepter ses revendications, de reconnaître ses sphères d’influence. Et si les gouvernements européens ne le font pas, c’est parce qu’ils sont corrompus, autoritaires, déconnectés de leur base. Cette rhétorique est dangereuse. Elle légitime les forces politiques qui, en Europe, réclament l’abandon de l’Ukraine et la normalisation des relations avec Moscou. Elle affaiblit les gouvernements qui tentent de maintenir une ligne ferme face à l’agression russe. Elle crée des divisions au sein de l’Alliance atlantique au moment précis où l’unité serait la plus nécessaire. Et elle envoie un message clair à Poutine : continuez, Washington ne vous arrêtera pas, et bientôt l’Europe non plus.
Ukraine sacrifiée sur l'autel du pragmatisme

« Cessation expéditive des hostilités » : le vocabulaire de la capitulation
Parlons maintenant de l’Ukraine. Ou plutôt, parlons de ce que Washington veut faire de l’Ukraine. Le document est d’une clarté brutale : il est dans l’intérêt fondamental des États-Unis de « négocier une cessation expéditive des hostilités en Ukraine ». Pas une paix juste. Pas une victoire ukrainienne. Pas même un compromis équilibré. Non : une « cessation expéditive ». Le mot est important. « Expéditive » signifie rapide, sans délai, sans trop de considérations pour les détails. Peu importe les conditions, peu importe les garanties de sécurité, peu importe le sort des territoires occupés. Ce qui compte, c’est que ça s’arrête vite. Pourquoi cette urgence ? Le document l’explique : pour « stabiliser les économies européennes, prévenir une escalade ou une expansion involontaire de la guerre, et rétablir la stabilité stratégique avec la Russie ». Lisez bien cette liste de priorités. Stabiliser les économies européennes — parce que les sanctions contre la Russie coûtent cher et que les prix de l’énergie restent élevés. Prévenir l’escalade — parce que Washington a peur d’être entraîné dans un conflit direct avec Moscou. Et surtout, rétablir la stabilité stratégique avec la Russie — parce que Trump veut faire des affaires avec Poutine, négocier un nouveau partage du monde, reconnaître les sphères d’influence respectives.
Notez ce qui n’apparaît pas dans cette liste. La souveraineté ukrainienne. L’intégrité territoriale de l’Ukraine. Le droit international. La justice pour les victimes de crimes de guerre. Rien de tout cela ne figure parmi les priorités américaines. Le document mentionne bien la nécessité d’assurer « la survie de l’Ukraine en tant qu’État viable » et de permettre « la récupération post-guerre de l’Ukraine ». Mais ces formulations sont révélatrices. « Survie » et « État viable » — pas prospérité, pas sécurité, pas souveraineté pleine et entière. Juste la survie. Comme si l’Ukraine était un patient en soins intensifs qu’on essaie de maintenir en vie, sans trop se soucier de sa qualité de vie future. Et « récupération post-guerre » — comme si la guerre était déjà terminée, comme si l’issue était déjà décidée, comme si l’Ukraine n’avait plus qu’à accepter sa défaite et à panser ses plaies. C’est le vocabulaire de la capitulation, habillé dans le langage diplomatique. Et c’est ce que Washington veut imposer à Kyiv. Les envoyés de Trump, Steve Witkoff et le général Keith Kellogg, ont déjà présenté à Moscou une version modifiée de leur plan de paix initial. Ce plan, selon les fuites, impliquerait des concessions territoriales ukrainiennes, un gel du conflit le long des lignes actuelles, et l’abandon de l’adhésion à l’OTAN. En échange, la Russie obtiendrait la levée progressive des sanctions et la reconnaissance de facto de ses conquêtes.
La « survie » comme seul objectif pour Kyiv
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se retrouve dans une position impossible. D’un côté, il dépend de l’aide militaire américaine pour continuer à résister à l’invasion russe. Sans les missiles ATACMS, sans les systèmes Patriot, sans les munitions d’artillerie, l’armée ukrainienne ne peut pas tenir. De l’autre côté, Washington lui demande maintenant d’accepter un accord qui reviendrait à valider l’agression russe, à abandonner des millions de citoyens ukrainiens sous occupation, à renoncer à ses aspirations euro-atlantiques. Et si Zelensky refuse ? Le document de stratégie nationale ne le dit pas explicitement, mais le message est clair : l’aide américaine pourrait s’arrêter. Trump l’a déjà laissé entendre à plusieurs reprises. « Si l’Ukraine ne veut pas négocier, elle se débrouillera seule. » C’est du chantage, pur et simple. Et ça fonctionne. Les dirigeants européens, selon les fuites révélées par Der Spiegel, ont averti Zelensky de ne pas céder aux demandes russes sans garanties de sécurité solides de la part des États-Unis. Mais quelles garanties Washington peut-il offrir, alors que ce même document de stratégie nationale affirme que l’OTAN ne doit plus s’élargir et que la priorité est de rétablir la stabilité avec Moscou ?
La réalité, c’est que l’Ukraine est en train d’être sacrifiée. Pas par les Européens, qui continuent à fournir une aide massive malgré leurs propres difficultés économiques. Pas par les Ukrainiens eux-mêmes, qui se battent avec un courage extraordinaire depuis bientôt quatre ans. Mais par Washington, qui a décidé que le conflit ukrainien était devenu un obstacle à ses propres objectifs stratégiques. Trump veut se concentrer sur la Chine, sur l’hémisphère occidental, sur la reconstruction de l’industrie américaine. Il veut réduire les engagements militaires à l’étranger, ramener les troupes américaines, forcer les alliés à payer davantage pour leur propre défense. Et dans cette logique, l’Ukraine n’est qu’un pion qu’on peut sacrifier pour obtenir un accord avec Moscou. Le document le dit presque ouvertement : « Les États-Unis rejettent le concept malavisé de domination mondiale pour eux-mêmes, mais doivent empêcher la domination mondiale… d’autres. » Traduction : nous ne voulons plus être le gendarme du monde, mais nous ne laisserons personne d’autre le devenir non plus. Et si cela signifie abandonner l’Ukraine à son sort, qu’il en soit ainsi. Après tout, selon le document, l’Europe manque de « confiance en soi » dans sa relation avec la Russie. Peut-être qu’un peu de réalisme géopolitique lui ferait du bien. Peut-être qu’accepter les sphères d’influence russes serait finalement plus sage que de s’accrocher à des principes dépassés comme la souveraineté et l’intégrité territoriale.
Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens face à cette trahison. L’Ukraine se bat pour sa survie. Pour son existence même en tant que nation. Ses villes sont bombardées, ses civils massacrés, ses enfants déportés. Et Washington dit : arrêtez de vous battre, acceptez la défaite, on a des choses plus importantes à faire. Comment peut-on être aussi cynique ? Comment peut-on regarder ce qui se passe à Marioupol, à Boutcha, à Kharkiv, et décider que la priorité c’est de « rétablir la stabilité stratégique avec la Russie » ? Je sais que la géopolitique est cruelle. Je sais que les grandes puissances ne font pas de sentiment. Mais il y a des limites. Il y a des lignes qu’on ne devrait pas franchir. Et abandonner un pays démocratique qui résiste à une invasion brutale, c’est franchir cette ligne. C’est trahir tout ce que l’Occident prétend défendre. Et le pire, c’est que cette trahison est présentée comme du réalisme, comme du pragmatisme, comme de la sagesse stratégique. Non. C’est de la lâcheté. Pure et simple.
Les accusations contre l'Union européenne

Censure, migration, perte d’identité
Revenons maintenant aux accusations que le document porte contre l’Union européenne. Elles sont nombreuses, variées, et toutes aussi infondées les unes que les autres. Selon Washington, l’UE et les « autres organismes transnationaux » mènent des « activités qui sapent la liberté politique et la souveraineté ». Quelles activités exactement ? Le document ne le précise pas. Mais on peut deviner. Les régulations européennes sur la protection des données personnelles, comme le RGPD, qui obligent les géants américains de la tech à respecter la vie privée des citoyens européens. Les règles de concurrence qui ont conduit à des amendes massives contre Google, Apple, Meta pour abus de position dominante. Les normes environnementales qui imposent des standards stricts aux entreprises, y compris américaines, qui veulent vendre en Europe. Les politiques commerciales qui protègent certains secteurs stratégiques de la concurrence déloyale. Tout cela, dans la vision trumpienne, constitue une atteinte à la liberté et à la souveraineté. Pas la liberté et la souveraineté des citoyens européens, bien sûr. Mais celle des entreprises américaines qui voudraient opérer en Europe sans contraintes, sans régulations, sans avoir à rendre de comptes à personne.
Ensuite, il y a les politiques migratoires. Le document affirme qu’elles « transforment le continent et créent des conflits ». C’est vrai que l’Europe fait face à des défis migratoires importants. Les flux en provenance du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie centrale ont augmenté ces dernières années, créant des tensions politiques et sociales dans plusieurs pays. Mais de là à parler de « transformation du continent » et d' »effacement civilisationnel », il y a un gouffre. Les migrants représentent environ 10% de la population européenne, un chiffre comparable à celui des États-Unis. Et contrairement à ce que suggère le document, l’Europe n’a pas abandonné le contrôle de ses frontières. Les accords de Dublin, le système Frontex, les partenariats avec les pays de transit comme la Turquie ou la Libye, tout cela vise précisément à gérer les flux migratoires de manière ordonnée. Le problème, c’est que cette gestion est difficile, complexe, imparfaite. Mais c’est très différent de l’image d’une Europe submergée, incapable de défendre ses frontières, en voie de disparition. Cette image, c’est celle que véhicule l’extrême droite européenne. Et maintenant, c’est aussi celle que véhicule la Maison-Blanche.
Une vision qui emprunte aux théories complotistes
Puis vient l’accusation de censure. Le document dénonce la « censure de la liberté d’expression et la suppression de l’opposition politique » en Europe. Encore une fois, aucun exemple concret n’est fourni. Mais on peut imaginer ce que Washington a en tête. Les lois européennes contre les discours de haine, qui interdisent l’incitation à la violence raciale ou religieuse. Les régulations sur les fake news et la désinformation, qui obligent les plateformes en ligne à retirer les contenus manifestement faux ou dangereux. Les poursuites judiciaires contre des personnalités politiques qui tiennent des propos racistes, antisémites ou négationnistes. Tout cela, dans la vision trumpienne, constitue de la censure. Peu importe que ces mesures visent à protéger la démocratie contre la manipulation et la haine. Peu importe qu’elles soient adoptées démocratiquement, appliquées par des tribunaux indépendants, contestables devant la justice. Pour Washington, toute limite à la liberté d’expression absolue est une forme de totalitarisme. C’est une vision simpliste, dangereuse, qui ignore les leçons de l’histoire européenne. Nous savons, nous Européens, ce qui se passe quand on laisse la haine et le mensonge se propager sans limites. Nous avons vu où cela mène. Et nous avons décidé collectivement que certaines lignes ne devaient pas être franchies. Si cela fait de nous des censeurs aux yeux de Washington, tant pis.
Enfin, il y a les accusations sur les taux de natalité et la perte d’identité nationale. Le document déplore que l’Europe connaisse des « taux de natalité en chute libre » et une « perte des identités nationales et de la confiance en soi ». C’est vrai que les taux de natalité européens sont bas, autour de 1,5 enfant par femme en moyenne, bien en dessous du seuil de renouvellement de 2,1. Mais c’est un phénomène commun à toutes les sociétés développées, y compris les États-Unis, où le taux de natalité est également en baisse. Et c’est un choix de société. Les femmes européennes ont accès à l’éducation, à l’emploi, à la contraception. Elles peuvent décider librement du nombre d’enfants qu’elles veulent avoir. Si elles choisissent d’en avoir moins, c’est leur droit. Quant à la « perte d’identité nationale », c’est un concept flou, manipulable, qui sert surtout à alimenter les peurs identitaires. Qu’est-ce qu’une identité nationale ? Est-ce qu’elle est figée dans le temps, immuable, ou est-ce qu’elle évolue avec la société ? Est-ce qu’un Français doit nécessairement être blanc, catholique, de souche, pour être vraiment français ? Ou est-ce que la France, c’est aussi les descendants d’immigrés maghrébins, africains, asiatiques, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui travaillent ici, qui paient leurs impôts ici ? Le document de stratégie nationale penche clairement pour la première option. Et c’est profondément inquiétant.
La "stabilité stratégique" avec Moscou

Russie partenaire, Europe menace
Venons-en maintenant à ce qui est peut-être le plus choquant dans ce document : la manière dont il traite la Russie. Pas comme une menace. Pas comme un adversaire. Mais comme un partenaire potentiel avec qui il faut rétablir la « stabilité stratégique ». Cette expression revient plusieurs fois dans le texte, et elle est lourde de sens. La stabilité stratégique, dans le jargon diplomatique, désigne un équilibre des forces qui réduit les risques de conflit entre grandes puissances. Pendant la Guerre froide, elle reposait sur la dissuasion nucléaire et les accords de contrôle des armements entre les États-Unis et l’URSS. Après 1991, elle a été remplacée par une vision plus unilatérale, où Washington dictait les règles et Moscou devait s’y conformer. Mais Trump veut revenir à un modèle de condominium, où les États-Unis et la Russie se reconnaissent mutuellement comme grandes puissances, respectent leurs sphères d’influence respectives, et gèrent ensemble les crises internationales. C’est exactement ce que Poutine réclame depuis des années. Et maintenant, Washington est prêt à le lui donner.
Le document affirme que « gérer les relations européennes avec la Russie nécessitera un engagement diplomatique américain significatif, à la fois pour rétablir les conditions de stabilité stratégique à travers la masse continentale eurasiatique, et pour atténuer le risque de conflit entre la Russie et les États européens ». Décortiquons cette phrase. « Gérer les relations européennes avec la Russie » — pas soutenir l’Europe face à l’agression russe, mais gérer leurs relations, comme si les deux parties étaient également responsables des tensions. « Engagement diplomatique américain significatif » — Washington se positionne comme médiateur, arbitre, pas comme allié de l’Europe. « Rétablir les conditions de stabilité stratégique » — revenir à un équilibre qui existait avant, c’est-à-dire avant l’expansion de l’OTAN, avant le soutien à l’Ukraine, avant les sanctions contre Moscou. « Atténuer le risque de conflit entre la Russie et les États européens » — comme si le risque venait des deux côtés, comme si l’Europe était aussi agressive que la Russie. C’est une équivalence morale inacceptable. La Russie a envahi l’Ukraine. La Russie bombarde des civils. La Russie déporte des enfants. La Russie menace d’utiliser l’arme nucléaire. Et Washington traite tout cela comme un simple différend entre voisins qu’il faut aider à résoudre.
L’inversion totale des priorités américaines
Cette approche représente une inversion totale de la politique américaine depuis 1945. Pendant 80 ans, les États-Unis ont considéré l’Europe comme leur allié principal, leur partenaire naturel, le cœur de l’Occident démocratique. Ils ont investi des milliards de dollars dans la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale avec le Plan Marshall. Ils ont maintenu des centaines de milliers de soldats sur le continent pour le protéger de la menace soviétique. Ils ont soutenu l’intégration européenne, encouragé l’élargissement de l’OTAN, défendu les valeurs démocratiques contre le totalitarisme. Tout cela reposait sur une conviction simple : l’Europe et l’Amérique partagent les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, le même destin. Elles forment ensemble une communauté atlantique unie face aux menaces extérieures. Mais Trump ne croit pas à cette communauté. Pour lui, l’Europe n’est pas un allié, c’est un concurrent économique, un fardeau militaire, un obstacle à ses ambitions. Et la Russie n’est pas un ennemi, c’est un partenaire potentiel, une grande puissance avec qui on peut faire des affaires, un acteur rationnel avec qui on peut négocier.
Cette vision est dangereuse pour plusieurs raisons. D’abord, elle ignore la nature du régime de Poutine. La Russie n’est pas une démocratie. C’est une autocratie où le pouvoir est concentré entre les mains d’un seul homme, où l’opposition est réprimée, où les médias sont contrôlés, où les élections sont truquées. Poutine ne respecte pas les règles du jeu international. Il les viole systématiquement quand elles ne servent pas ses intérêts. Il a annexé la Crimée en 2014, envahi l’Ukraine en 2022, soutenu le régime de Bachar al-Assad en Syrie, empoisonné ses opposants à l’étranger, interféré dans les élections occidentales. Et Trump pense qu’on peut faire confiance à un tel régime ? Qu’on peut signer des accords avec lui et s’attendre à ce qu’il les respecte ? C’est de la naïveté, ou de la complicité. Ensuite, cette vision affaiblit l’Europe au moment où elle en a le plus besoin. Face à la Russie, face à la Chine, face aux défis du changement climatique, de la migration, du terrorisme, l’Europe a besoin d’alliés solides, de partenaires fiables. Si Washington se retire, si l’OTAN s’affaiblit, si l’alliance atlantique se délite, l’Europe se retrouvera seule, vulnérable, incapable de défendre ses intérêts. Et c’est exactement ce que Poutine veut.
Il y a des moments où on se sent trahi. Pas par un ennemi, ça on s’y attend. Mais par un ami. Par quelqu’un en qui on avait confiance, sur qui on comptait, avec qui on avait construit quelque chose. Et cette trahison fait plus mal que n’importe quelle attaque frontale. Parce qu’elle détruit quelque chose de précieux : la confiance. L’alliance atlantique, ce n’était pas juste un traité militaire. C’était une relation. Une histoire commune. Des valeurs partagées. Des sacrifices mutuels. Et maintenant, Washington nous dit que tout ça ne compte plus. Que l’Europe est un problème, que la Russie est un partenaire, que l’OTAN est un fardeau. Comment voulez-vous qu’on réagisse à ça ? Avec de la compréhension ? De l’indulgence ? Non. Avec de la colère. Et avec la détermination de ne plus jamais dépendre de quelqu’un qui peut nous trahir aussi facilement.
Les "partis patriotiques" européens salués

AfD, Rassemblement National : les nouveaux alliés de Washington
Le document ne se contente pas de critiquer l’Europe actuelle. Il indique aussi quelle Europe Washington souhaite voir émerger. Et cette Europe-là ressemble beaucoup à celle que réclame l’extrême droite. Le texte salue explicitement « l’influence croissante des partis patriotiques européens » et affirme que « l’Amérique encourage ses alliés politiques en Europe à promouvoir ce renouveau d’esprit ». Traduisez : Washington soutient les partis nationalistes, populistes, anti-immigration, eurosceptiques qui montent en puissance sur le continent. L’Alternative für Deutschland (AfD) en Allemagne, classée comme organisation d’extrême droite par les services de renseignement allemands, qui réclame la sortie de l’euro et la fermeture des frontières. Le Rassemblement National en France, héritier du Front National fondé par Jean-Marie Le Pen, qui veut démanteler l’Union européenne et rétablir les frontières nationales. La Lega en Italie, dirigée par Matteo Salvini, qui a fait de la lutte contre l’immigration son cheval de bataille. Le Parti pour la liberté (PVV) aux Pays-Bas, mené par Geert Wilders, qui compare l’islam au nazisme. Le Fidesz en Hongrie, le parti de Viktor Orbán, qui a transformé son pays en démocratie illibérale. Voilà les « patriotes » que Washington veut voir au pouvoir en Europe.
Cette stratégie n’est pas nouvelle. Trump a toujours eu des affinités avec les leaders nationalistes européens. Il a reçu Orbán à la Maison-Blanche, l’a qualifié de « leader fantastique ». Il a soutenu le Brexit, félicité Nigel Farage pour sa victoire. Il a rencontré Marine Le Pen, exprimé son admiration pour sa « force ». Mais jusqu’à présent, ces sympathies restaient dans le domaine du personnel, du politique. Maintenant, elles deviennent doctrine officielle. Le document de stratégie nationale affirme que Washington va « cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l’Europe au sein des nations européennes ». C’est une déclaration d’ingérence assumée. Les États-Unis vont activement soutenir les forces politiques qui s’opposent aux politiques de l’Union européenne, qui contestent l’intégration européenne, qui veulent revenir à une Europe des nations souveraines. Comment ? Le document ne le précise pas. Mais on peut imaginer : financement de think tanks, soutien médiatique, légitimation diplomatique, pressions économiques. Tous les outils de l’influence américaine seront mobilisés pour favoriser l’émergence d’une Europe conforme aux intérêts de Washington. Une Europe faible, divisée, incapable de s’opposer aux décisions américaines.
L’ingérence assumée dans les affaires européennes
Cette ingérence viole tous les principes que les États-Unis prétendent défendre. Le respect de la souveraineté nationale. La non-intervention dans les affaires intérieures d’autres pays. Le soutien à la démocratie et à l’État de droit. Mais pour Trump, ces principes ne s’appliquent que quand ils servent les intérêts américains. Quand ils les contrarient, on les ignore. Le document justifie cette approche en affirmant que les gouvernements européens actuels « foulent aux pieds les principes de base de la démocratie pour supprimer l’opposition ». C’est une accusation grotesque. Les démocraties européennes sont parmi les plus solides au monde. Elles ont des élections libres et régulières, des médias indépendants, des systèmes judiciaires impartiaux, des contre-pouvoirs efficaces. Oui, elles font face à des défis : montée du populisme, polarisation politique, désinformation en ligne. Mais ces défis sont gérés démocratiquement, par le débat public, par les institutions, par les citoyens eux-mêmes. Dire que l’Europe supprime l’opposition politique, c’est du délire. Ou de la propagande. Probablement les deux.
En réalité, ce que Washington reproche à l’Europe, ce n’est pas d’être antidémocratique. C’est de ne pas suivre les directives américaines. Les gouvernements européens qui soutiennent l’Ukraine, qui maintiennent les sanctions contre la Russie, qui régulent les géants de la tech, qui imposent des normes environnementales strictes, sont qualifiés d’autoritaires. Tandis que les partis qui veulent abandonner l’Ukraine, lever les sanctions, déréglementer l’économie, fermer les frontières, sont salués comme des patriotes. C’est une inversion complète des valeurs. Et c’est profondément dangereux. Parce que si Washington réussit à porter au pouvoir ces partis d’extrême droite, l’Europe changera radicalement. L’Union européenne pourrait se désintégrer. L’OTAN pourrait imploser. Les démocraties libérales pourraient céder la place à des régimes illibéraux sur le modèle hongrois ou polonais (avant 2023). Les droits des minorités, des femmes, des LGBT, pourraient être remis en question. Les politiques climatiques pourraient être abandonnées. Les relations avec la Russie pourraient être normalisées, au détriment de l’Ukraine et des pays baltes. Est-ce vraiment ce que veut Washington ? Apparemment, oui. Parce que cette Europe-là serait plus facile à contrôler, plus docile, plus alignée sur les positions américaines. Une Europe faible est une Europe obéissante. Et c’est exactement ce que Trump recherche.
La réaction allemande : entre choc et dignité

Johann Wadephul refuse les « conseils extérieurs »
La réaction de Berlin au document de stratégie nationale a été mesurée, mais ferme. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré que l’Allemagne n’avait « pas besoin de conseils extérieurs » sur la liberté d’expression. Une formulation diplomatique qui cache mal l’irritation. Wadephul a souligné que « les États-Unis restent notre allié le plus important au sein de l’OTAN », mais il a ajouté que « cette alliance est centrée sur les questions de politique de sécurité ». Traduction : nous sommes alliés militaires, mais cela ne donne pas à Washington le droit de nous dicter nos politiques intérieures. C’est une ligne rouge que Berlin n’est pas prêt à franchir. L’Allemagne a une histoire particulière avec l’autoritarisme. Elle sait ce que signifie la perte de la démocratie, la suppression des libertés, la montée du totalitarisme. Et elle n’acceptera pas que quiconque, même son allié américain, l’accuse de dériver vers l’autoritarisme. Surtout quand ces accusations viennent d’une administration qui elle-même flirte avec l’illibéralisme, qui attaque les médias, qui conteste les résultats électoraux, qui menace ses opposants politiques.
Mais derrière cette dignité affichée, il y a aussi de l’inquiétude. L’Allemagne dépend des États-Unis pour sa sécurité. Elle n’a pas d’arme nucléaire. Son armée, la Bundeswehr, a été sous-financée pendant des décennies et peine à se moderniser. Elle compte sur le parapluie nucléaire américain et sur la présence de troupes américaines sur son sol pour dissuader toute agression russe. Si Washington se retire, si l’OTAN s’affaiblit, l’Allemagne se retrouvera vulnérable. Et elle le sait. C’est pourquoi Berlin marche sur des œufs. D’un côté, il faut défendre les valeurs démocratiques, rejeter les accusations infondées, maintenir la dignité nationale. De l’autre, il faut préserver la relation avec Washington, éviter une rupture complète, garder les canaux de communication ouverts. C’est un équilibre difficile à tenir. Et le document de stratégie nationale le rend encore plus difficile. Comment maintenir une alliance avec un partenaire qui vous accuse publiquement de sombrer dans l’autoritarisme et l’effacement civilisationnel ? Comment faire confiance à un allié qui salue vos opposants d’extrême droite et promet de soutenir leur ascension au pouvoir ? Ces questions hantent la chancellerie à Berlin. Et elles n’ont pas de réponses faciles.
Berlin coincé entre dépendance et désaccord
Le chancelier allemand, Friedrich Merz, se trouve dans une position particulièrement délicate. Élu en 2024 sur une plateforme de fermeté face à la Russie et de soutien à l’Ukraine, il doit maintenant composer avec une administration américaine qui veut exactement l’inverse. Selon les fuites révélées par Der Spiegel, Merz a accusé Washington de « jouer avec l’Europe et l’Ukraine » lors d’un appel avec d’autres dirigeants européens. C’est une critique sévère, qui reflète la frustration croissante de Berlin face à la politique américaine. Mais Merz ne peut pas aller trop loin. L’Allemagne a besoin des États-Unis. Pour sa sécurité, pour son économie, pour son influence internationale. Rompre avec Washington serait suicidaire. Alors Berlin essaie de naviguer entre deux écueils : ne pas céder aux pressions américaines, mais ne pas provoquer une rupture ouverte. C’est une stratégie de résistance passive, qui consiste à gagner du temps, à maintenir les positions actuelles, à espérer que la situation évoluera favorablement. Peut-être que Trump perdra les élections de 2028. Peut-être que sa politique se heurtera à des obstacles au Congrès. Peut-être que les Européens réussiront à construire une autonomie stratégique suffisante pour ne plus dépendre de Washington. Peut-être.
En attendant, l’Allemagne accélère son réarmement. Le gouvernement Merz a annoncé une augmentation massive du budget de la défense, avec l’objectif d’atteindre 3% du PIB d’ici 2027, puis 5% d’ici 2030 si nécessaire. C’est un effort colossal, qui nécessitera des sacrifices budgétaires dans d’autres domaines. Mais Berlin n’a pas le choix. Si l’Amérique se retire, l’Europe doit être capable de se défendre seule. Et l’Allemagne, en tant que plus grande économie européenne, doit montrer l’exemple. Le pays investit également dans sa base industrielle de défense, en relançant la production de chars, d’artillerie, de munitions. Il renforce ses partenariats avec la France, la Pologne, les pays nordiques, pour construire une défense européenne intégrée. Il soutient l’Ukraine avec des livraisons d’armes, de l’aide financière, de la formation militaire. Tout cela va dans le bon sens. Mais ce sera long. Très long. Et en attendant, l’Allemagne reste dépendante des États-Unis. C’est cette dépendance qui donne à Trump son pouvoir de chantage. Et c’est cette dépendance que Berlin doit absolument réduire si elle veut retrouver sa souveraineté stratégique.
La France face à un défi existentiel
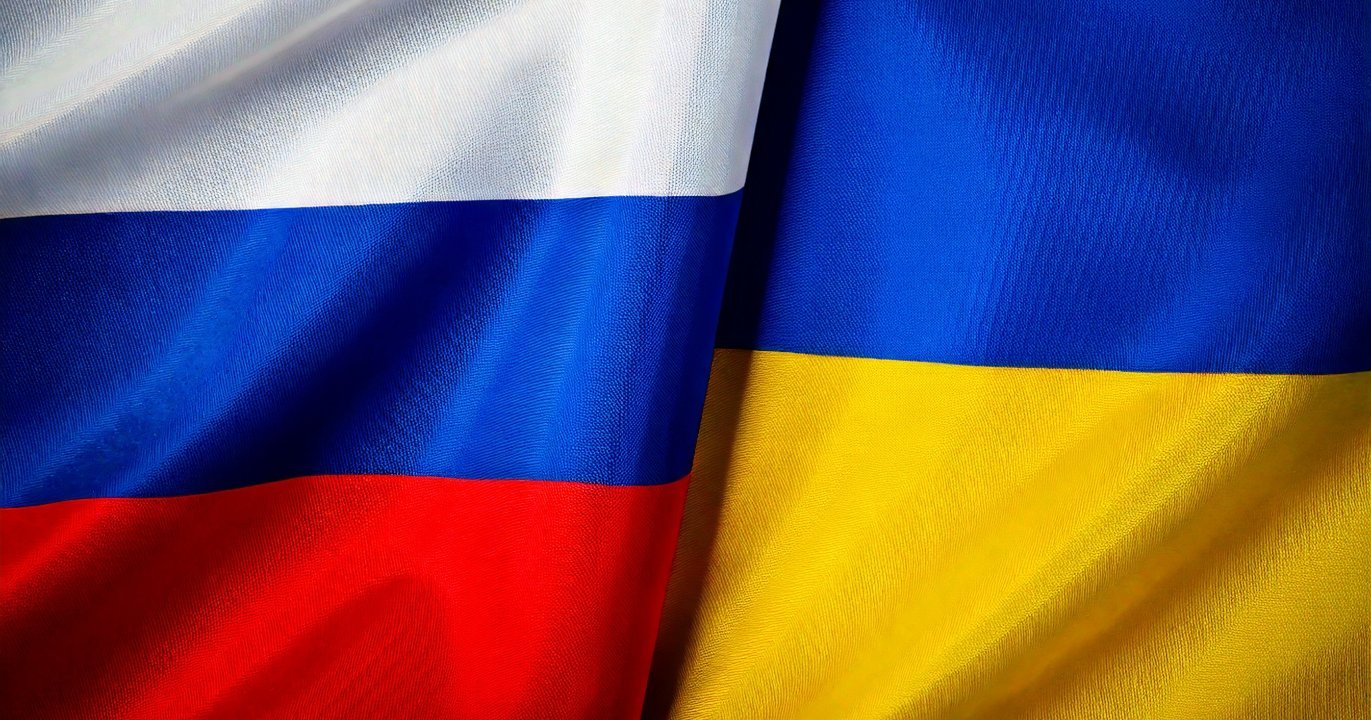
Macron et sa vision européenne contestée
Pour la France, le document de stratégie nationale américain représente un défi encore plus profond. Parce que la vision de l’Europe qu’il attaque, c’est précisément celle que défend le président Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Une Europe intégrée, souveraine, capable d’agir de manière autonome sur la scène internationale. Une Europe qui régule les marchés, protège ses citoyens, défend ses valeurs. Une Europe qui n’est pas un simple appendice des États-Unis, mais un acteur géopolitique à part entière. Macron a fait de cette vision le cœur de son projet politique. Il a multiplié les discours sur l’« autonomie stratégique européenne », sur la nécessité de ne plus dépendre de Washington pour la sécurité, sur l’importance de construire une défense européenne crédible. Il a poussé pour des investissements massifs dans les technologies de pointe, dans l’intelligence artificielle, dans le spatial, dans le nucléaire civil. Il a défendu une politique industrielle ambitieuse, avec des champions européens capables de rivaliser avec les géants américains et chinois. Et maintenant, Washington lui dit que tout cela est une erreur. Que l’Union européenne « sape la liberté politique et la souveraineté ». Que les politiques européennes mènent à l' »effacement civilisationnel ». Que l’Europe doit changer de trajectoire, sous peine de devenir « méconnaissable ».
C’est un camouflet personnel pour Macron. Mais c’est aussi un défi politique majeur. Parce que le document de stratégie nationale ne se contente pas de critiquer l’Europe actuelle. Il appelle explicitement à « cultiver la résistance » à cette Europe au sein des nations européennes. Et en France, cette résistance a un visage : le Rassemblement National de Marine Le Pen. Le parti d’extrême droite qui veut sortir de l’euro, démanteler l’Union européenne, fermer les frontières, expulser les immigrés. Le parti que Macron a combattu lors de toutes les élections présidentielles depuis 2017. Le parti qui représente tout ce qu’il déteste : le nationalisme étroit, la xénophobie, le repli sur soi. Et maintenant, Washington dit ouvertement qu’il soutient ce parti, qu’il encourage sa montée au pouvoir, qu’il voit en lui l’avenir de l’Europe. C’est une ingérence directe dans la politique intérieure française. Et c’est inacceptable. Macron ne peut pas laisser passer ça. Mais que peut-il faire ? Rompre avec Washington ? Impossible. La France a besoin des États-Unis, même si elle dispose de sa propre force de frappe nucléaire. Ignorer le document ? Difficile. Il représente la position officielle de l’administration américaine, pas une simple déclaration politique. Alors Macron choisit une troisième voie : la résistance diplomatique.
La stratégie française de résistance
Selon les fuites révélées par Der Spiegel, Macron a averti lors d’un appel avec d’autres dirigeants européens que Washington pourrait « trahir l’Ukraine » sur les questions territoriales. C’est une accusation grave, qui montre à quel point la méfiance s’est installée entre Paris et Washington. Macron ne croit plus aux promesses américaines. Il pense que Trump est prêt à sacrifier l’Ukraine pour obtenir un accord avec Poutine. Et il veut que l’Europe se prépare à cette éventualité. Comment ? En construisant une défense européenne autonome, capable de soutenir l’Ukraine même sans l’aide américaine. En renforçant les capacités militaires européennes, en développant une industrie de défense intégrée, en créant un commandement européen indépendant de l’OTAN. C’est un projet ambitieux, qui nécessitera des années et des centaines de milliards d’euros. Mais Macron pense que c’est la seule option. Parce que l’alternative, c’est la dépendance totale vis-à-vis d’un allié qui ne nous considère plus comme tel.
La France accélère donc ses efforts en matière de défense. Elle augmente son budget militaire, avec l’objectif d’atteindre 3% du PIB d’ici 2027. Elle modernise sa force de frappe nucléaire, avec de nouveaux sous-marins, de nouveaux missiles, de nouveaux bombardiers. Elle développe des capacités dans les domaines critiques : drones, cyber, spatial, intelligence artificielle. Elle renforce ses partenariats européens, notamment avec l’Allemagne dans le cadre du Système de combat aérien du futur (SCAF) et du char du futur (MGCS). Elle soutient l’Ukraine avec des livraisons massives d’armes, y compris des missiles SCALP à longue portée qui permettent de frapper en profondeur le territoire russe. Et elle multiplie les initiatives diplomatiques pour construire une coalition européenne capable de résister aux pressions américaines. Macron a organisé plusieurs sommets avec les dirigeants allemand, polonais, britannique, italien, pour coordonner les positions européennes. Il a proposé la création d’un fonds européen de défense, financé par des emprunts communs, pour accélérer les investissements militaires. Il a plaidé pour une réforme de l’OTAN, avec un pilier européen plus fort et plus autonome. Tout cela va dans le bon sens. Mais ce sera insuffisant si l’Europe reste divisée, si chaque pays poursuit ses propres intérêts, si les populistes arrivent au pouvoir et démantèlent l’Union de l’intérieur.
Je regarde Macron et je me dis : au moins, il essaie. Il se bat. Il refuse d’accepter la fatalité. Même si sa vision de l’Europe est imparfaite, même si ses politiques intérieures sont contestables, même si son style présidentiel agace, au moins il défend quelque chose. Une idée de l’Europe. Une ambition pour le continent. Une volonté de ne pas se soumettre. Et face à un document comme celui-là, face à une administration américaine qui nous traite comme des vassaux, face à une Russie qui nous menace, on a besoin de leaders qui se battent. Pas de leaders qui capitulent. Pas de leaders qui acceptent l’humiliation avec le sourire. Alors oui, je soutiens Macron dans ce combat. Même si je ne suis pas d’accord avec lui sur tout. Parce que ce combat, c’est le nôtre. C’est celui de l’Europe. Et nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre.
Le Royaume-Uni dans l'entre-deux

Londres cherche l’équilibre impossible
Le Royaume-Uni occupe une position unique dans ce bouleversement géopolitique. Sorti de l’Union européenne en 2020, il n’est plus directement concerné par les critiques que Washington adresse à Bruxelles. Mais il reste membre de l’OTAN, allié des États-Unis, et profondément lié à l’Europe par la géographie, l’histoire, l’économie. Le document de stratégie nationale ne mentionne pas explicitement le Royaume-Uni, mais les implications sont claires. Londres doit choisir son camp. Soit il s’aligne totalement sur Washington, accepte la nouvelle doctrine américaine, soutient le gel de l’expansion de l’OTAN et la normalisation avec Moscou. Soit il maintient sa solidarité avec l’Europe, continue à soutenir l’Ukraine, refuse de cautionner l’abandon des alliés européens. C’est un choix impossible. Parce que le Royaume-Uni a besoin des deux. Il a besoin des États-Unis pour sa sécurité, pour son économie, pour son influence mondiale. Mais il a besoin aussi de l’Europe, son premier partenaire commercial, son voisin immédiat, son allié naturel face aux menaces communes. Le gouvernement britannique essaie donc de naviguer entre ces deux pôles, de maintenir de bonnes relations avec Washington tout en renforçant ses liens avec l’Europe.
Le Premier ministre britannique a réagi au document de stratégie nationale avec prudence. Il a souligné que le Royaume-Uni reste « inébranlablement engagé » envers l’OTAN et la défense de l’Ukraine. Mais il a évité de critiquer directement Washington, préférant mettre l’accent sur les domaines de coopération possible. Le Royaume-Uni, a-t-il rappelé, est le deuxième contributeur à l’aide militaire ukrainienne après les États-Unis. Il a fourni des chars Challenger 2, des missiles Storm Shadow, des systèmes de défense aérienne, de la formation militaire. Il a imposé des sanctions sévères contre la Russie, gelé les avoirs des oligarques, interdit les importations de pétrole et de gaz russes. Et il continuera à le faire, quoi que décide Washington. C’est un message clair : le Royaume-Uni ne suivra pas aveuglément les États-Unis si cela signifie abandonner l’Ukraine. Mais en même temps, Londres ne veut pas provoquer une rupture avec Washington. Parce que le Royaume-Uni a d’autres priorités stratégiques, notamment dans l’Indo-Pacifique, où il a besoin du soutien américain.
AUKUS versus solidarité européenne
Le partenariat AUKUS, signé en 2021 entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, illustre bien ce dilemme. AUKUS vise à contrer l’influence chinoise dans l’Indo-Pacifique, notamment en fournissant à l’Australie des sous-marins nucléaires de conception britannique et américaine. C’est un projet stratégique majeur pour Londres, qui lui permet de maintenir sa présence dans une région clé, de renforcer ses liens avec Washington, de démontrer sa pertinence militaire post-Brexit. Mais AUKUS détourne aussi des ressources et de l’attention de l’Europe. Les sous-marins nucléaires coûtent des dizaines de milliards de livres. Les capacités industrielles mobilisées pour AUKUS ne peuvent pas être utilisées ailleurs. Et le focus stratégique sur l’Indo-Pacifique signifie moins d’engagement en Europe. Le document de stratégie nationale américain semble encourager cette réorientation. Il affirme que le Royaume-Uni devrait « assumer un rôle de leadership accru en Europe » plutôt que dans l’Indo-Pacifique. Traduction : laissez l’Asie aux Américains, concentrez-vous sur votre arrière-cour européenne. C’est exactement ce que Londres ne veut pas entendre. Parce que le Royaume-Uni se voit comme une puissance mondiale, pas comme une puissance régionale européenne.
Mais la réalité rattrape les ambitions. Le Royaume-Uni n’a pas les moyens d’être partout à la fois. Son budget de défense, bien que supérieur à celui de la plupart des pays européens, reste limité. Sa marine, autrefois la plus puissante du monde, ne compte plus que deux porte-avions, dont un seul est opérationnel à tout moment. Son armée de terre a été réduite à moins de 80 000 soldats, le niveau le plus bas depuis des siècles. Ses stocks de munitions sont insuffisants pour un conflit prolongé. Face à ces contraintes, Londres doit faire des choix. Et de plus en plus, ces choix penchent vers l’Europe. Le Royaume-Uni a rejoint l’Initiative européenne d’intervention (IEI), un cadre de coopération militaire entre pays européens. Il participe à des exercices conjoints avec la France, l’Allemagne, les pays nordiques. Il a signé des accords de défense bilatéraux avec la Pologne, les pays baltes, l’Ukraine. Il investit dans la défense du High North et de l’Arctique, où la menace russe se fait de plus en plus pressante. Tout cela montre que le Royaume-Uni, malgré le Brexit, reste profondément ancré dans la sécurité européenne. Et que face au retrait américain, il n’a pas d’autre choix que de renforcer ses liens avec ses voisins continentaux.
L'Europe de l'Est abandonnée

Pologne, pays baltes : la peur du retour russe
Pour les pays d’Europe de l’Est, le document de stratégie nationale américain est un cauchemar devenu réalité. La Pologne, les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Roumanie, tous ces pays qui ont rejoint l’OTAN après 1999 précisément pour se protéger de la Russie, se retrouvent maintenant dans une situation terrifiante. Washington leur dit que l’OTAN ne s’élargira plus, que la priorité est de rétablir la stabilité avec Moscou, que l’Europe doit gérer seule ses relations avec la Russie. Pour ces pays, c’est une condamnation à mort. Parce qu’ils savent ce que signifie vivre sous domination russe. Ils l’ont vécu pendant des décennies, sous l’Union soviétique. Ils connaissent la répression, la censure, les déportations, les purges. Et ils ne veulent pas y retourner. C’est pourquoi ils ont tout fait pour rejoindre l’OTAN, pour obtenir la garantie de l’article 5, pour s’assurer que si la Russie les attaque, les États-Unis viendront à leur secours. Mais maintenant, cette garantie semble de plus en plus fragile. Si Washington considère que la stabilité avec Moscou est plus importante que la défense des alliés européens, que vaut encore l’article 5 ? Si Trump est prêt à sacrifier l’Ukraine pour obtenir un accord avec Poutine, pourquoi ne sacrifierait-il pas aussi les pays baltes ?
La Pologne réagit avec une détermination farouche. Le gouvernement polonais, dirigé par le Premier ministre Donald Tusk, a annoncé une augmentation massive des dépenses militaires, avec l’objectif d’atteindre 5% du PIB d’ici 2026. C’est le niveau le plus élevé de toute l’OTAN, dépassant même les exigences formulées par Trump. La Pologne achète massivement des équipements militaires : des chars K2 Black Panther sud-coréens, des obusiers K9 Thunder, des avions de combat FA-50, des systèmes de défense aérienne Patriot américains. Elle construit une ligne de fortifications le long de sa frontière avec la Biélorussie et l’enclave russe de Kaliningrad, surnommée le « Bouclier de l’Est ». Elle augmente les effectifs de son armée, avec l’objectif d’atteindre 300 000 soldats d’ici 2030. Et elle renforce ses partenariats régionaux, notamment avec l’Ukraine, les pays baltes, les pays nordiques. Le message est clair : la Pologne se prépare à se défendre seule si nécessaire. Elle ne compte plus sur la protection américaine. Elle construit sa propre capacité de dissuasion. Et elle encourage ses voisins à faire de même.
Les pays les plus exposés, les plus trahis
Les pays baltes sont dans une situation encore plus précaire. Petits, avec des populations de moins de deux millions d’habitants chacun, ils ne peuvent pas se défendre seuls contre la Russie. Leur survie dépend entièrement de l’OTAN. Et maintenant, l’OTAN semble les abandonner. Le document de stratégie nationale ne mentionne même pas les pays baltes. Comme s’ils n’existaient pas. Comme si leur sécurité n’avait aucune importance. C’est une insulte. Et c’est terrifiant. Parce que la Russie n’a jamais accepté l’indépendance des pays baltes. Moscou les considère comme faisant partie de sa sphère d’influence naturelle, comme des territoires temporairement perdus qu’il faudra un jour récupérer. Poutine l’a dit explicitement à plusieurs reprises. Et maintenant, avec le retrait américain, avec le gel de l’expansion de l’OTAN, avec la priorité donnée à la stabilité avec Moscou, les pays baltes se demandent combien de temps il leur reste avant que la Russie ne passe à l’action. Un an ? Cinq ans ? Dix ans ? Personne ne le sait. Mais la menace est réelle. Et elle se rapproche.
Les pays baltes réagissent en renforçant leurs défenses, mais leurs moyens sont limités. L’Estonie a augmenté son budget de défense à 3,4% du PIB, le plus élevé d’Europe après la Pologne. Elle a acheté des systèmes de défense aérienne, des missiles antichars, des drones. Elle a construit des bunkers, des dépôts de munitions, des infrastructures militaires. Elle a rétabli le service militaire obligatoire. Mais tout cela reste dérisoire face à la puissance militaire russe. La Lettonie et la Lituanie font des efforts similaires, avec les mêmes limites. Leur seul espoir, c’est que l’OTAN tienne ses engagements. Que l’article 5 reste valide. Que les troupes américaines, britanniques, allemandes, françaises stationnées sur leur territoire interviennent en cas d’agression. Mais avec le document de stratégie nationale, cet espoir s’amenuise. Parce que si Washington considère que la stabilité avec Moscou est plus importante que la défense des alliés, pourquoi risquerait-il une guerre nucléaire pour Tallinn ou Riga ? C’est la question qui hante les dirigeants baltes. Et ils n’ont pas de réponse rassurante.
La doctrine Monroe ressuscitée

L’Amérique latine comme nouveau terrain de jeu
Le document de stratégie nationale ne se contente pas de redéfinir la relation de Washington avec l’Europe. Il annonce aussi un pivot vers l’hémisphère occidental. Le texte invoque la doctrine Monroe, cette politique formulée en 1823 qui affirmait que les Amériques devaient rester sous influence américaine, à l’abri des interventions européennes. Trump va plus loin en proposant un « corollaire Trump » à cette doctrine : les États-Unis doivent dominer leur propre hémisphère, y concentrer leurs ressources militaires, y affirmer leur puissance. Le document affirme qu’il faut « réajuster notre présence militaire mondiale pour faire face aux menaces urgentes dans notre hémisphère ». Traduction : retirer des troupes d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie, et les redéployer en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pourquoi ? Pour lutter contre les cartels de la drogue, contrôler les flux migratoires, contrer l’influence chinoise et russe dans la région. C’est un changement stratégique majeur, qui reflète les priorités de Trump : sécuriser les frontières américaines, combattre le trafic de drogue, affirmer la domination régionale.
Cette stratégie se traduit déjà sur le terrain. Le porte-avions USS Gerald Ford, le plus grand navire de guerre du monde, est actuellement déployé dans les Caraïbes avec son groupe aéronaval. C’est un déploiement inhabituel, qui montre l’importance que Washington accorde désormais à cette région. L’armée américaine a également intensifié ses opérations contre les trafiquants de drogue, avec des frappes aériennes contre des bateaux suspects, des raids terrestres contre des laboratoires de production, des opérations de surveillance maritime. Ces opérations ont fait des dizaines de morts, soulevant des questions sur leur légalité et leur proportionnalité. Mais pour Trump, c’est une priorité absolue. Il veut montrer qu’il est dur contre la drogue, qu’il protège les frontières américaines, qu’il ne laisse personne défier la puissance américaine dans son propre arrière-cour. Et tant pis si cela signifie violer la souveraineté des pays latino-américains, ignorer le droit international, provoquer des tensions diplomatiques. L’hémisphère occidental appartient aux États-Unis, et Washington entend le faire savoir.
Le redéploiement militaire vers l’hémisphère occidental
Ce pivot vers l’Amérique latine a des conséquences directes pour l’Europe. Si les États-Unis redéploient leurs forces vers l’hémisphère occidental, cela signifie moins de troupes en Europe, moins de matériel, moins d’engagement. Le document de stratégie nationale l’affirme explicitement : il faut se retirer des « théâtres qui sont moins importants pour la sécurité nationale américaine qu’ils ne l’étaient autrefois ». Quels théâtres ? L’Europe, évidemment. Le Moyen-Orient aussi, où Washington veut réduire sa présence après des décennies d’interventions coûteuses et infructueuses. Mais surtout l’Europe. Parce que selon Trump, l’Europe est riche, stable, capable de se défendre seule. Elle n’a plus besoin de la protection américaine. Et si elle en a encore besoin, qu’elle paie pour l’obtenir. Le document mentionne l’engagement de La Haye, selon lequel les pays de l’OTAN doivent dépenser 5% de leur PIB pour la défense. C’est un chiffre irréaliste, que même les États-Unis n’atteignent pas (leur budget de défense représente environ 3,5% du PIB). Mais Trump l’impose comme condition pour maintenir la protection américaine. Si l’Europe ne paie pas, l’Amérique se retire. C’est du chantage, pur et simple.
Les implications sont vertigineuses. Si les États-Unis retirent leurs troupes d’Europe, qui défendra le continent face à la Russie ? Les armées européennes, dans leur état actuel, ne sont pas prêtes. Elles manquent de matériel, de munitions, de capacités logistiques, de commandement intégré. Elles pourraient tenir quelques semaines, peut-être quelques mois, mais pas indéfiniment. Et la Russie le sait. Poutine attend juste le bon moment pour tester la détermination européenne. Peut-être en provoquant un incident dans les pays baltes. Peut-être en intensifiant les opérations hybrides : cyberattaques, sabotages, désinformation. Peut-être en soutenant des mouvements séparatistes dans les Balkans ou en Moldavie. Les options ne manquent pas. Et sans la garantie américaine, l’Europe sera vulnérable. C’est pourquoi le pivot vers l’hémisphère occidental est si dangereux. Il ne s’agit pas seulement d’un redéploiement militaire. C’est un abandon stratégique. Une décision de laisser l’Europe se débrouiller seule, quelles que soient les conséquences. Et ces conséquences pourraient être catastrophiques.
Je ressens une douleur sourde en écrivant ces lignes. Pas une douleur physique, mais quelque chose de plus profond. La douleur de voir un monde qu’on croyait stable s’effondrer sous nos yeux. La douleur de réaliser que les certitudes sur lesquelles on a construit sa vie ne tiennent plus. L’alliance atlantique, l’OTAN, la protection américaine, tout ça semblait éternel. Inébranlable. Et maintenant, ça s’écroule. En quelques pages d’un document officiel. Sans guerre, sans catastrophe, juste par décision politique. Et on se retrouve là, nous Européens, à regarder ce naufrage en se demandant ce qu’on va faire. Comment on va survivre. Comment on va protéger nos familles, nos pays, nos valeurs. Je n’ai pas de réponse. Personne n’en a. Mais je sais une chose : on ne peut plus compter sur personne d’autre que nous-mêmes. Et ça fait peur. Terriblement peur.
Les implications pour la défense européenne
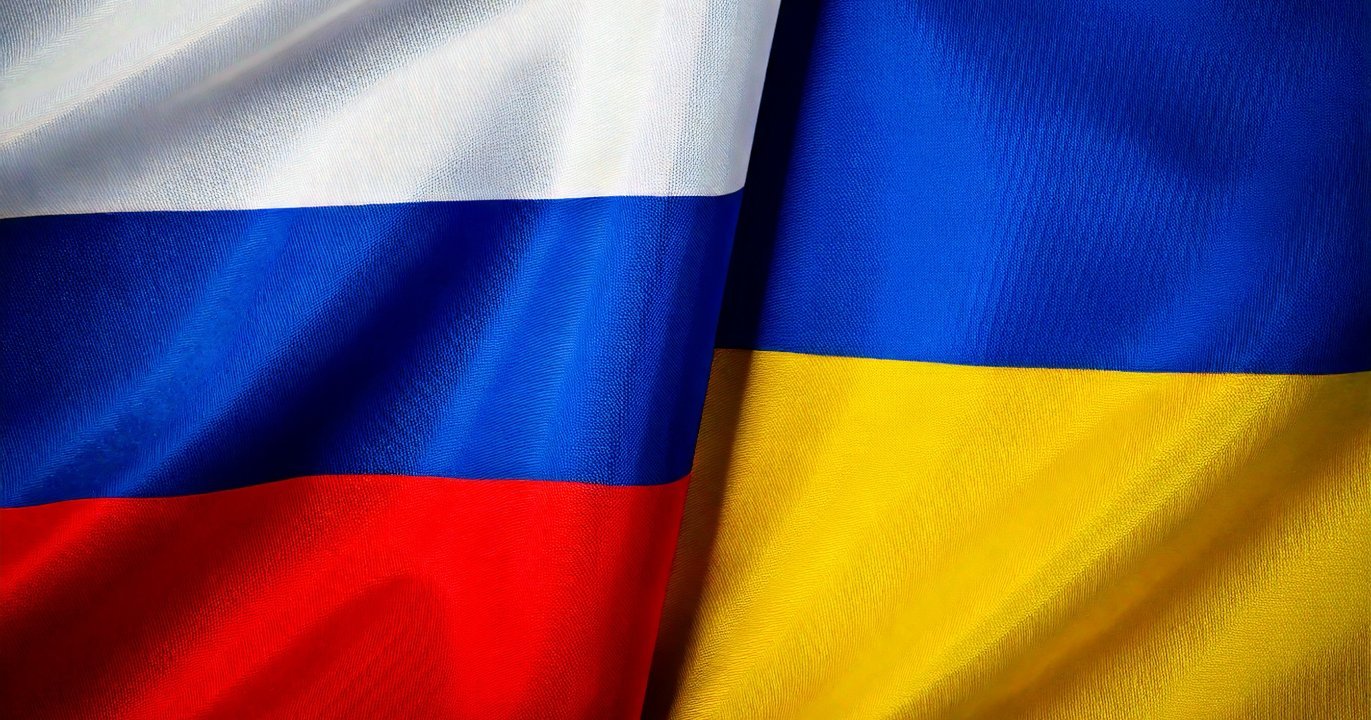
5% du PIB : l’engagement de La Haye
Le document de stratégie nationale mentionne ce qu’il appelle l’« engagement de La Haye », selon lequel les pays de l’OTAN s’engagent à dépenser 5% de leur PIB pour la défense. C’est une référence au sommet de l’OTAN qui s’est tenu à La Haye en juin 2025, où Trump a fait pression sur les alliés européens pour qu’ils augmentent drastiquement leurs budgets militaires. À l’époque, cet engagement avait été présenté comme un objectif à long terme, une aspiration plutôt qu’une obligation. Mais maintenant, le document de stratégie nationale en fait une condition pour le maintien de la protection américaine. Si l’Europe ne paie pas, l’Amérique se retire. C’est aussi simple que ça. Le problème, c’est que 5% du PIB représente un effort colossal. Pour donner un ordre de grandeur, la plupart des pays européens dépensent actuellement entre 1,5% et 2,5% de leur PIB pour la défense. Atteindre 5% signifierait doubler ou tripler ces budgets. Pour l’Allemagne, cela représenterait environ 200 milliards d’euros par an, contre 85 milliards actuellement. Pour la France, environ 140 milliards, contre 60 milliards. Pour l’Italie, 100 milliards, contre 35 milliards. Des sommes astronomiques, qui nécessiteraient des coupes massives dans d’autres domaines : santé, éducation, retraites, infrastructures.
Est-ce réaliste ? Probablement pas, du moins pas à court terme. Mais est-ce nécessaire ? Peut-être. Parce que si les États-Unis se retirent vraiment, l’Europe devra assumer seule sa défense. Et cela coûtera cher. Très cher. Les experts estiment qu’une défense européenne autonome, capable de dissuader la Russie sans l’aide américaine, nécessiterait des investissements de l’ordre de 500 à 800 milliards d’euros sur dix ans. Il faudrait construire de nouvelles capacités dans tous les domaines : défense aérienne, missiles de croisière, sous-marins nucléaires, satellites de reconnaissance, drones de combat, cyberdéfense, commandement intégré. Il faudrait aussi reconstituer les stocks de munitions, moderniser les infrastructures militaires, augmenter les effectifs, améliorer la formation. C’est un chantier titanesque, qui prendra des années, peut-être des décennies. Mais l’alternative, c’est la vulnérabilité. C’est accepter de dépendre de la bonne volonté de Washington, de subir ses caprices, de plier à ses exigences. Et après ce document de stratégie nationale, cette dépendance n’est plus acceptable. L’Europe doit se réarmer. Massivement. Rapidement. Ou elle disparaîtra.
L’Europe doit se défendre seule d’ici 2027
Le document de stratégie nationale fixe un calendrier implicite. D’ici 2027, l’Europe doit être capable de se défendre seule. C’est dans deux ans. Deux ans pour construire une défense européenne crédible. Deux ans pour combler des décennies de sous-investissement. Deux ans pour créer ce qui n’existe pas encore : un commandement militaire européen intégré, une industrie de défense coordonnée, une stratégie commune face aux menaces. C’est impossible, bien sûr. Mais c’est aussi nécessaire. Parce que Trump ne bluff pas. Il est sérieux. Il veut vraiment retirer les troupes américaines d’Europe, réduire l’engagement de Washington, forcer les Européens à payer pour leur propre sécurité. Et si l’Europe n’est pas prête en 2027, elle se retrouvera nue face à la Russie. Les pays européens le savent. C’est pourquoi ils accélèrent leurs efforts de réarmement. L’Allemagne, la France, la Pologne, le Royaume-Uni, tous augmentent leurs budgets militaires. Mais ce n’est pas suffisant. Parce que le problème n’est pas seulement financier. C’est aussi politique, industriel, stratégique.
Politiquement, l’Europe reste divisée. Chaque pays a ses propres priorités, ses propres menaces, ses propres intérêts. La Pologne veut se défendre contre la Russie. La France veut maintenir son influence en Afrique. L’Allemagne veut protéger ses routes commerciales. L’Italie veut contrôler la migration méditerranéenne. Comment coordonner tout ça ? Comment créer une stratégie commune quand les intérêts divergent ? C’est le défi que l’Europe doit relever. Et elle n’a que deux ans pour le faire. Industriellement, l’Europe manque de capacités. Son industrie de défense est fragmentée, avec des dizaines d’entreprises qui produisent des équipements incompatibles, qui se font concurrence au lieu de coopérer, qui dépendent de composants américains ou asiatiques. Il faut consolider cette industrie, créer des champions européens, investir dans la recherche et le développement, sécuriser les chaînes d’approvisionnement. Là encore, c’est un chantier énorme, qui prendra du temps. Stratégiquement, l’Europe manque de vision. Quelle est la menace principale ? La Russie ? La Chine ? Le terrorisme ? Les cyberattaques ? Les flux migratoires ? Tout ça à la fois ? Et comment y répondre ? Avec quelle doctrine militaire ? Quelles capacités ? Quels partenariats ? Ces questions fondamentales n’ont pas encore de réponses claires. Et sans réponses, pas de stratégie. Et sans stratégie, pas de défense crédible.
Les réactions des think tanks et experts

CSIS, Atlantic Council : l’alarme des analystes
Les think tanks américains et européens ont réagi avec une rare unanimité au document de stratégie nationale. Leurs analyses convergent vers une conclusion alarmante : ce document pourrait détruire l’OTAN et fracturer l’Occident. Le Center for Strategic and International Studies (CSIS), l’un des think tanks les plus influents de Washington, a publié une note intitulée « La stratégie de sécurité nationale qui pourrait détruire l’alliance de l’OTAN ». Les auteurs y expliquent que le document rompt avec 80 ans de politique étrangère américaine, abandonne les alliés européens au moment où ils en ont le plus besoin, et envoie un signal catastrophique à Moscou et Pékin. Selon le CSIS, cette stratégie affaiblit la position américaine dans le monde, encourage les adversaires à tester la détermination de Washington, et crée un vide stratégique que la Chine et la Russie s’empresseront de combler. L’Atlantic Council, un autre think tank majeur, a organisé une table ronde d’experts pour analyser le document. Leurs conclusions sont tout aussi sombres. Ils soulignent que le langage utilisé — « effacement civilisationnel », « théorie du grand remplacement », soutien aux « partis patriotiques » — emprunte directement à l’extrême droite européenne et aux théories complotistes. C’est une rupture idéologique majeure, qui transforme les États-Unis d’un défenseur de la démocratie libérale en promoteur du nationalisme ethnique.
Les experts européens sont encore plus critiques. Le German Marshall Fund, qui se consacre aux relations transatlantiques, a publié une série d’analyses par pays montrant l’impact dévastateur du document sur chaque capitale européenne. À Berlin, c’est le choc et l’incompréhension. À Paris, c’est la colère et la détermination à résister. À Varsovie, c’est la peur et l’urgence de se réarmer. À Rome, c’est l’embarras, parce que le gouvernement italien partage certaines des positions de Trump mais ne peut pas le dire ouvertement. Partout, c’est la même question : que faire maintenant ? Comment répondre à cette trahison ? Comment reconstruire la confiance ? Ou faut-il accepter que la confiance est morte, que l’alliance atlantique appartient au passé, que l’Europe doit désormais tracer son propre chemin ? Le European Policy Centre, un think tank bruxellois, va encore plus loin. Dans une note intitulée « La nouvelle stratégie de sécurité nationale de Trump : une menace existentielle pour l’Europe », les auteurs affirment que ce document représente un danger plus grand pour l’Europe que n’importe quelle menace militaire russe. Parce qu’il sape les fondements mêmes de la sécurité européenne : l’alliance avec les États-Unis, la garantie de l’OTAN, la solidarité transatlantique. Sans ces fondements, l’Europe est vulnérable. Et Trump le sait.
« Le document qui pourrait détruire l’OTAN »
Le titre de l’analyse du CSIS n’est pas exagéré. Ce document pourrait vraiment détruire l’OTAN. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire. Mais progressivement, par érosion de la confiance, par accumulation de désaccords, par divergence croissante des intérêts. L’OTAN repose sur un principe simple : l’article 5, qui stipule qu’une attaque contre un membre est une attaque contre tous. C’est la garantie ultime, celle qui dissuade toute agression. Mais cette garantie n’a de valeur que si les membres y croient. Si les Européens pensent que Washington ne viendra pas à leur secours en cas d’attaque russe, l’article 5 devient une coquille vide. Et le document de stratégie nationale sème précisément ce doute. En affirmant que la priorité est de rétablir la stabilité avec Moscou, en appelant à un gel de l’expansion de l’OTAN, en critiquant les gouvernements européens qui soutiennent l’Ukraine, Washington envoie un message clair : nous ne sommes plus prêts à risquer une guerre pour vous. Vous êtes seuls. Débrouillez-vous. Ce message est dévastateur. Parce qu’il détruit la crédibilité de la dissuasion. Et sans dissuasion crédible, l’OTAN ne sert à rien.
Les experts militaires le savent. Ils ont modélisé des dizaines de scénarios de conflit en Europe. Et dans presque tous, la présence américaine est décisive. Sans les États-Unis, l’Europe ne peut pas arrêter une offensive russe majeure. Elle peut ralentir l’avancée, infliger des pertes, tenir quelques semaines. Mais pas gagner. Pas seule. C’est pourquoi la garantie américaine est si importante. Elle ne sert pas seulement à défendre l’Europe en cas d’attaque. Elle sert surtout à dissuader l’attaque. À faire comprendre à Moscou que le coût d’une agression serait trop élevé, que les risques seraient trop grands, que les conséquences seraient catastrophiques. Mais si cette dissuasion s’effondre, si Poutine pense qu’il peut attaquer sans déclencher une réponse américaine, alors il le fera. Peut-être pas demain. Peut-être pas l’année prochaine. Mais un jour. Quand il jugera le moment opportun. Quand l’Europe sera suffisamment divisée, suffisamment affaiblie, suffisamment distraite. Et ce jour-là, sans la protection américaine, l’Europe sera seule face à la tempête. C’est ce scénario cauchemardesque que les experts tentent d’éviter. Mais avec ce document de stratégie nationale, il devient de plus en plus plausible. De plus en plus probable. De plus en plus inévitable.
L'aspect économique : tarifs et mercantilisme
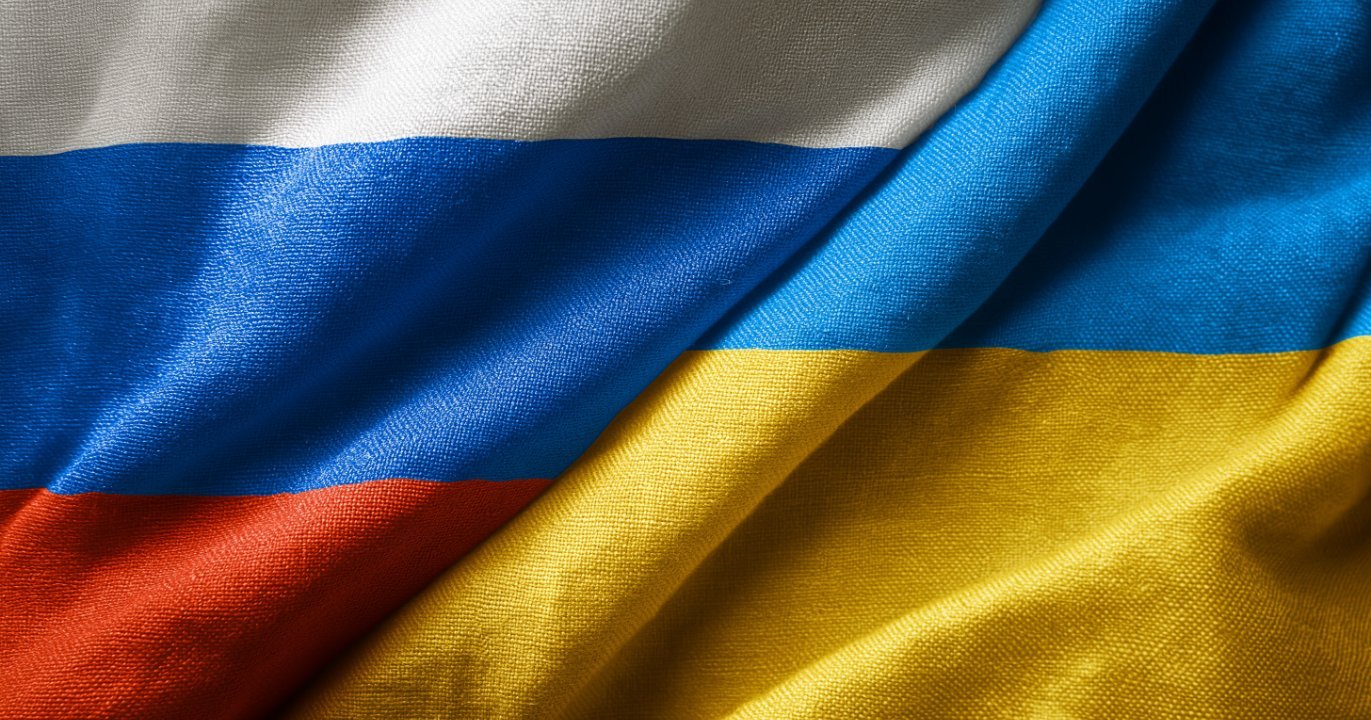
« America First » devient « America Alone »
Le document de stratégie nationale ne se limite pas aux questions militaires et diplomatiques. Il contient aussi une vision économique claire : l’« America First » poussé à son extrême logique. Le texte affirme que la force économique est la base de la sécurité nationale, que les États-Unis doivent protéger leurs industries stratégiques, sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement, réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. Pour y parvenir, Washington utilisera tous les outils à sa disposition : tarifs douaniers, restrictions à l’exportation, sanctions secondaires, pressions sur les entreprises, contrôles des investissements. C’est du mercantilisme pur et dur, une vision de l’économie mondiale comme un jeu à somme nulle où le gain de l’un est la perte de l’autre. Cette approche est aux antipodes de l’ordre économique libéral que les États-Unis ont eux-mêmes construit après 1945. Cet ordre reposait sur le libre-échange, l’ouverture des marchés, la coopération internationale, les institutions multilatérales comme l’OMC, le FMI, la Banque mondiale. Trump rejette tout cela. Pour lui, ces institutions sont des obstacles à la puissance américaine, des contraintes inutiles, des reliques d’une époque révolue.
Les conséquences pour l’Europe sont considérables. Les tarifs douaniers que Trump a imposés ou menace d’imposer touchent de nombreux secteurs : automobile, acier, aluminium, produits agricoles, technologies. Ces tarifs renchérissent les exportations européennes vers les États-Unis, réduisent la compétitivité des entreprises européennes, provoquent des pertes d’emplois. Et ils déclenchent des représailles. L’Union européenne a déjà imposé des contre-tarifs sur des produits américains, créant une spirale protectionniste qui nuit aux deux parties. Mais Trump s’en fiche. Pour lui, l’important c’est de protéger l’industrie américaine, de ramener des emplois aux États-Unis, de réduire le déficit commercial. Peu importe si cela provoque une guerre commerciale, si cela affaiblit les alliés, si cela déstabilise l’économie mondiale. « America First » signifie littéralement : l’Amérique d’abord, et tant pis pour les autres. Ou plutôt, comme le formulent certains analystes : « America Alone ». Une Amérique seule, isolée, repliée sur elle-même, qui ne compte que sur ses propres forces et se méfie de tout le monde.
Les chaînes d’approvisionnement comme armes
Le document de stratégie nationale accorde une importance particulière aux chaînes d’approvisionnement. Il affirme que la dépendance américaine vis-à-vis des importations étrangères, notamment chinoises, constitue une vulnérabilité stratégique majeure. C’est vrai. Les États-Unis importent la majorité de leurs terres rares, essentielles pour l’électronique et les technologies de défense. Ils dépendent de la Chine pour de nombreux composants électroniques, produits pharmaceutiques, équipements médicaux. Cette dépendance donne à Pékin un levier de pression considérable. En cas de conflit, la Chine pourrait couper ces approvisionnements, paralysant l’économie et l’armée américaines. C’est pourquoi Trump veut relocaliser ces industries, reconstruire une base industrielle nationale, sécuriser les chaînes d’approvisionnement. Mais cette stratégie a un coût. Produire aux États-Unis coûte plus cher qu’en Chine. Les salaires sont plus élevés, les régulations plus strictes, les coûts de production supérieurs. Pour compenser, il faut soit accepter des prix plus élevés, soit subventionner massivement les industries, soit les deux. Et c’est exactement ce que fait Trump, avec des centaines de milliards de dollars d’aides publiques pour les semi-conducteurs, les batteries, l’énergie verte, la défense.
L’Europe se retrouve prise entre deux feux. D’un côté, elle partage les préoccupations américaines sur la dépendance vis-à-vis de la Chine. Elle aussi veut sécuriser ses chaînes d’approvisionnement, développer ses propres capacités industrielles, réduire sa vulnérabilité. De l’autre côté, elle ne peut pas se permettre une rupture complète avec la Chine, son deuxième partenaire commercial. L’économie européenne dépend des exportations vers la Chine, des investissements chinois, des chaînes de valeur intégrées. Couper ces liens provoquerait une récession majeure. Alors l’Europe essaie de naviguer entre ces deux extrêmes : désrisquer sans découpler, diversifier sans rompre, protéger sans isoler. C’est une stratégie délicate, qui mécontente tout le monde. Washington accuse l’Europe d’être trop molle avec la Chine. Pékin accuse l’Europe d’être trop alignée sur Washington. Et l’Europe se retrouve seule, coincée entre deux géants qui la pressent de choisir son camp. Le document de stratégie nationale aggrave cette pression. Il affirme que les États-Unis vont combattre la « surcapacité mercantiliste » — une référence à peine voilée aux exportations chinoises subventionnées. Et il appelle les alliés à faire de même. Traduction : l’Europe doit s’aligner sur la politique commerciale américaine, imposer les mêmes tarifs, adopter les mêmes restrictions. Sinon, elle sera considérée comme complice de la Chine. C’est du chantage économique, qui s’ajoute au chantage sécuritaire. Et l’Europe n’a pas beaucoup de marge de manœuvre.
Je regarde l’économie mondiale se fragmenter sous mes yeux et je me demande où tout ça va nous mener. Pendant des décennies, on nous a dit que la mondialisation était inévitable, bénéfique, irréversible. Que le libre-échange enrichissait tout le monde, que l’interdépendance garantissait la paix, que les frontières économiques appartenaient au passé. Et maintenant, tout ça s’effondre. Les tarifs reviennent. Les blocs se forment. Les chaînes d’approvisionnement se fragmentent. Et on se retrouve dans un monde qui ressemble de plus en plus à celui d’avant 1914 : des empires rivaux, des zones d’influence, des guerres commerciales qui préfigurent peut-être des guerres tout court. C’est terrifiant. Parce qu’on sait comment ça s’est terminé la dernière fois. Et on n’a aucune garantie que cette fois sera différente.
Ce que révèle ce document sur Trump 2.0

Idéologie avant pragmatisme
Ce document de stratégie nationale révèle quelque chose de fondamental sur le second mandat de Trump. Contrairement à son premier mandat, où l’improvisation et le chaos dominaient, où les décisions changeaient au gré des humeurs présidentielles, ce second mandat est guidé par une idéologie cohérente. Une vision du monde claire, structurée, assumée. Cette vision repose sur plusieurs piliers. D’abord, le nationalisme ethnique. L’idée que les nations sont définies par leur composition ethnique et culturelle, que l’immigration transforme et détruit les identités nationales, que le multiculturalisme mène à l' »effacement civilisationnel ». C’est une vision qui emprunte directement aux théories de l’extrême droite, qui rejette le modèle de société multiculturelle et inclusive que l’Occident a construit depuis 1945. Ensuite, l’unilatéralisme. L’idée que les États-Unis doivent agir seuls, sans se soucier des alliés, des institutions internationales, des règles du jeu. Que la puissance américaine ne doit être contrainte par rien ni personne. Que « America First » signifie littéralement : l’Amérique d’abord, et tant pis pour les autres. Enfin, le réalisme cynique. L’idée que les relations internationales sont un jeu de pouvoir pur, sans place pour les valeurs, les principes, la morale. Que la démocratie, les droits de l’homme, l’État de droit ne sont que des outils de propagande, des prétextes pour justifier la domination. Que ce qui compte vraiment, c’est la force, l’intérêt national, la capacité à imposer sa volonté.
Cette idéologie n’est pas nouvelle. Elle a toujours été présente dans le discours de Trump. Mais maintenant, elle devient doctrine officielle. Elle guide les décisions du gouvernement, oriente les budgets, structure la politique étrangère. Et c’est ce qui la rend si dangereuse. Parce qu’une idéologie cohérente est plus difficile à combattre qu’un chaos improvisé. On peut attendre que le chaos se dissipe, que les contradictions s’accumulent, que le système s’effondre sous son propre poids. Mais une idéologie cohérente, elle, persiste. Elle se renforce. Elle se propage. Et elle transforme durablement les institutions, les politiques, les mentalités. C’est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Trump n’est plus un accident de l’histoire, une anomalie passagère. Il représente un mouvement politique profond, enraciné dans une partie significative de la population américaine, soutenu par des think tanks, des médias, des élus. Un mouvement qui survivra à Trump lui-même, qui continuera après 2028, qui façonnera la politique américaine pour les décennies à venir. Et ce mouvement est fondamentalement hostile à l’Europe telle qu’elle existe aujourd’hui. Hostile à l’Union européenne, hostile au multilatéralisme, hostile au modèle de société européen. C’est cette hostilité que le document de stratégie nationale exprime. Et c’est cette hostilité que l’Europe doit maintenant affronter.
Le retour du nationalisme blanc assumé
Le document de stratégie nationale marque aussi le retour d’un nationalisme blanc assumé dans la politique américaine officielle. Les références à l' »effacement civilisationnel », à la « théorie du grand remplacement », aux changements démographiques qui rendraient certains pays de l’OTAN « majoritairement non-européens », tout cela relève d’une idéologie raciale explicite. Ce n’est plus du dog whistle, ces codes subtils que les politiciens utilisent pour parler de race sans le dire ouvertement. C’est direct. Brutal. Assumé. Le document affirme que l’Europe blanche est en train de disparaître, que cette disparition est une catastrophe civilisationnelle, que Washington doit soutenir les forces politiques qui s’y opposent. C’est du suprémacisme blanc à peine déguisé. Et c’est maintenant la position officielle des États-Unis d’Amérique. Comment en est-on arrivé là ? Comment un pays fondé sur l’immigration, qui se définit comme une nation d’immigrants, qui a inscrit dans sa Constitution l’égalité de tous les citoyens indépendamment de leur origine, peut-il adopter une telle idéologie ? La réponse est complexe, mais elle tient en partie à la peur du déclin. Une partie de la population américaine blanche se sent menacée par les changements démographiques, par la montée des minorités, par la perte de son statut dominant. Et Trump exploite cette peur, la nourrit, la transforme en programme politique.
Cette idéologie a des conséquences concrètes. Elle justifie les politiques anti-immigration, les restrictions sur les réfugiés, les contrôles aux frontières. Elle légitime la discrimination, le racisme, la xénophobie. Elle crée un climat de peur et de méfiance envers tout ce qui est perçu comme étranger, différent, menaçant. Et elle exporte ce climat en Europe, en soutenant les partis d’extrême droite qui partagent cette vision. Le document de stratégie nationale le dit explicitement : Washington va « cultiver la résistance » aux politiques actuelles de l’Europe, soutenir les « partis patriotiques », encourager un « renouveau d’esprit ». Traduction : Washington va financer, légitimer, promouvoir les mouvements nationalistes blancs en Europe. C’est une stratégie délibérée de déstabilisation, qui vise à transformer l’Europe de l’intérieur, à la rendre plus conforme aux intérêts et à l’idéologie de Washington. Et c’est profondément inquiétant. Parce que l’Europe a déjà connu le nationalisme ethnique. Elle sait où il mène. Aux discriminations, aux persécutions, aux génocides. L’histoire européenne du XXe siècle est jalonnée de ces horreurs. Et maintenant, Washington veut ramener tout ça. Au nom de la défense de la civilisation occidentale. Au nom de la lutte contre l’effacement. Au nom de valeurs qui n’ont rien à voir avec les vraies valeurs de l’Occident : la liberté, l’égalité, la dignité humaine.
Les scénarios pour l'Europe

Autonomie stratégique accélérée
Face à ce document de stratégie nationale, l’Europe a plusieurs options. La première, c’est l’autonomie stratégique accélérée. Accepter que l’alliance avec les États-Unis est morte, ou du moins gravement affaiblie. Accepter que l’Europe doit désormais compter sur ses propres forces. Et agir en conséquence. Cela signifie des investissements massifs dans la défense, la construction d’une industrie militaire européenne intégrée, la création d’un commandement européen autonome, le développement de capacités stratégiques propres : dissuasion nucléaire élargie, satellites de reconnaissance, drones de combat, cyberdéfense, missiles de croisière. Cela signifie aussi une politique étrangère européenne unifiée, capable de parler d’une seule voix, de défendre les intérêts européens, de résister aux pressions extérieures. C’est un projet ambitieux, qui nécessitera des années et des centaines de milliards d’euros. Mais c’est peut-être la seule option viable à long terme. Parce que la dépendance vis-à-vis de Washington n’est plus tenable. Trump l’a démontré. Et même si Trump perd les élections de 2028, le trumpisme survivra. Le mouvement politique qu’il représente ne disparaîtra pas. Les forces qui l’ont porté au pouvoir resteront actives. Et elles continueront à pousser pour une Amérique repliée sur elle-même, méfiante envers ses alliés, hostile à l’Europe.
L’autonomie stratégique européenne n’est pas une idée nouvelle. Macron en parle depuis 2017. Mais jusqu’à présent, elle restait largement théorique. Un objectif lointain, une aspiration plus qu’un programme concret. Maintenant, elle devient une nécessité urgente. Et plusieurs pays européens commencent à la prendre au sérieux. La France accélère ses investissements dans la défense, modernise sa force de frappe nucléaire, développe ses capacités spatiales et cyber. L’Allemagne sort de son pacifisme historique, augmente massivement son budget militaire, relance son industrie de défense. La Pologne se réarme à marche forcée, achète des équipements par dizaines de milliards d’euros, construit des fortifications le long de ses frontières. Les pays nordiques renforcent leur coopération militaire, intègrent leurs forces armées, créent des commandements communs. Tout cela va dans le bon sens. Mais ce n’est pas encore suffisant. Parce que l’autonomie stratégique ne se résume pas à des budgets et des équipements. Elle nécessite aussi une volonté politique, une vision commune, une capacité à prendre des décisions difficiles. Et sur ce plan, l’Europe reste divisée. Entre ceux qui veulent maintenir l’alliance avec Washington à tout prix, et ceux qui veulent s’en émanciper. Entre ceux qui privilégient la défense territoriale, et ceux qui veulent projeter la puissance européenne au-delà du continent. Entre ceux qui acceptent le réarmement, et ceux qui y résistent pour des raisons budgétaires ou idéologiques. Ces divisions affaiblissent l’Europe. Et elles doivent être surmontées si l’autonomie stratégique doit devenir réalité.
Fragmentation ou unité face à la menace
La deuxième option, c’est la fragmentation. Chaque pays européen pour soi, poursuivant ses propres intérêts, négociant séparément avec Washington, Moscou, Pékin. C’est le scénario du pire. Parce qu’une Europe divisée est une Europe faible. Incapable de se défendre, incapable de peser sur la scène internationale, incapable de protéger ses citoyens. Et c’est exactement ce que veulent les adversaires de l’Europe. Poutine l’a dit explicitement : son objectif est de diviser l’Europe, de briser l’unité européenne, de traiter avec chaque pays séparément. Trump partage cet objectif, même s’il ne le formule pas aussi crûment. Le document de stratégie nationale encourage la fragmentation en soutenant les partis nationalistes, en critiquant l’Union européenne, en appelant à un retour aux souverainetés nationales. Si cette stratégie réussit, l’Europe se désintégrera. L’Union européenne implosera. L’OTAN deviendra obsolète. Et chaque pays européen se retrouvera seul, vulnérable, à la merci des grandes puissances. C’est un retour au XIXe siècle, à l’époque des empires et des sphères d’influence. Et on sait comment ça s’est terminé : par deux guerres mondiales qui ont dévasté le continent.
Mais il y a une troisième option : l’unité face à la menace. Utiliser ce choc, cette trahison américaine, comme catalyseur pour renforcer l’intégration européenne. Transformer la crise en opportunité. Construire enfin cette Europe de la défense dont on parle depuis des décennies. Créer une véritable politique étrangère commune. Développer une autonomie stratégique crédible. C’est difficile. Très difficile. Parce que cela nécessite de surmonter des siècles de rivalités nationales, de méfiances mutuelles, de différences culturelles. Mais c’est possible. L’histoire l’a montré. Après 1945, des pays qui s’étaient entretués pendant des siècles ont réussi à construire ensemble une union pacifique et prospère. Ils l’ont fait parce qu’ils n’avaient pas le choix. Parce que l’alternative était pire. Et maintenant, l’Europe se retrouve dans une situation similaire. Face à une Amérique qui l’abandonne, une Russie qui la menace, une Chine qui la courtise pour mieux la diviser. L’unité n’est plus un luxe. C’est une question de survie. Et les Européens doivent en prendre conscience. Rapidement. Avant qu’il ne soit trop tard.
Je veux croire en cette troisième option. Je veux croire que l’Europe peut se ressaisir, s’unir, se défendre. Que nous ne sommes pas condamnés à la fragmentation, au déclin, à la disparition. Que nous avons encore la force, la volonté, la capacité de construire notre propre destin. Mais je ne suis pas naïf. Je sais que les obstacles sont immenses. Que les divisions sont profondes. Que les intérêts divergent. Que les populistes gagnent du terrain. Que le temps presse. Mais je refuse d’abandonner. Je refuse d’accepter que l’Europe est finie, que notre modèle de société est obsolète, que notre avenir n’existe pas. Parce que ce serait trahir tout ce pour quoi nos parents et grands-parents se sont battus. Tout ce qu’ils ont construit sur les ruines de la guerre. Et je ne suis pas prêt à faire ça. Alors oui, je garde espoir. Un espoir fragile, précaire, menacé. Mais un espoir quand même. Parce que sans espoir, il ne reste rien.
Conclusion : l'Europe à la croisée des chemins
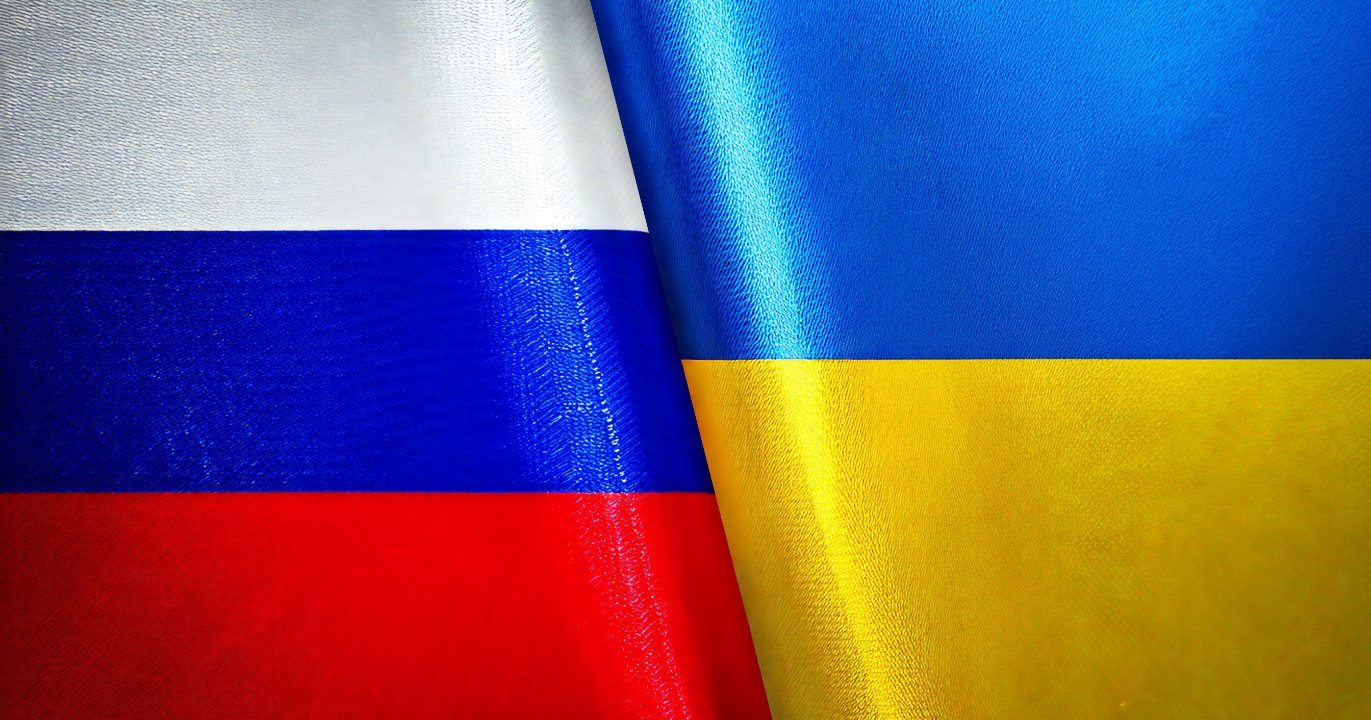
Un moment historique de rupture
Le 4 décembre 2025 restera dans l’histoire comme un tournant. Le jour où l’alliance atlantique, cette construction qui avait survécu à la Guerre froide, aux attentats du 11 septembre, aux crises financières, s’est fissurée de manière peut-être irréparable. Le document de stratégie nationale publié ce jour-là n’est pas un simple texte diplomatique. C’est un acte de rupture. Une déclaration selon laquelle les États-Unis ne considèrent plus l’Europe comme un allié privilégié, mais comme un problème à gérer. Selon laquelle l’OTAN n’est plus une alliance en expansion, mais une structure figée qui ne doit plus accueillir de nouveaux membres. Selon laquelle la Russie mérite plus de respect que l’Union européenne. Selon laquelle l’Ukraine doit accepter la défaite. Selon laquelle l’Europe est en voie d' »effacement civilisationnel » et doit changer radicalement de trajectoire. Ces affirmations ne sont pas des opinions personnelles de Trump. Ce sont des positions officielles du gouvernement américain, qui guideront la politique étrangère des États-Unis pour les années à venir. Et elles changent tout. Parce qu’elles détruisent les fondements sur lesquels l’Europe a construit sa sécurité depuis 1949. La garantie américaine. La solidarité transatlantique. L’article 5 de l’OTAN. Tout cela devient soudain incertain, fragile, conditionnel.
L’Europe se retrouve donc à un moment de vérité. Elle doit choisir. Soit elle accepte cette nouvelle réalité, s’adapte, construit son autonomie stratégique, assume sa propre défense. Soit elle refuse, résiste, tente de maintenir l’alliance atlantique malgré tout, espère que Trump perdra les élections de 2028 et que tout redeviendra comme avant. Soit elle se fragmente, chaque pays poursuivant ses propres intérêts, négociant séparément avec les grandes puissances, abandonnant le projet européen. Ces trois options sont sur la table. Et le choix qui sera fait dans les mois et années à venir déterminera le destin du continent pour les décennies à venir. Ce n’est pas une exagération. C’est la réalité. L’Europe est à la croisée des chemins. Et la route qu’elle prendra maintenant façonnera son avenir. Soit elle devient une puissance autonome, capable de se défendre, de défendre ses valeurs, de peser sur la scène internationale. Soit elle devient un terrain de jeu pour les grandes puissances, divisée, affaiblie, incapable de contrôler son propre destin. Il n’y a pas de troisième voie. Pas de statu quo possible. Parce que le statu quo vient de voler en éclats.
La nécessité d’une réponse unie
Face à ce défi existentiel, l’Europe n’a qu’une option viable : l’unité. Une unité qui dépasse les clivages nationaux, les différences idéologiques, les intérêts particuliers. Une unité fondée sur la reconnaissance d’une menace commune et la nécessité d’y répondre ensemble. Cette unité ne sera pas facile à construire. Les divisions sont profondes. Entre l’Est et l’Ouest, entre le Nord et le Sud, entre les grands et les petits pays, entre les atlantistes et les souverainistes. Mais ces divisions doivent être surmontées. Parce que l’alternative, c’est la disparition. Pas immédiate, pas spectaculaire. Mais progressive, inexorable. Une Europe fragmentée ne peut pas se défendre contre la Russie. Elle ne peut pas négocier d’égal à égal avec la Chine. Elle ne peut pas résister aux pressions américaines. Elle devient un objet de l’histoire, pas un sujet. Un terrain où se jouent les rivalités des autres, pas un acteur qui façonne son propre destin. Et c’est inacceptable. Parce que l’Europe a trop à offrir au monde. Ses valeurs démocratiques, son modèle social, sa diversité culturelle, son engagement pour les droits humains, sa lutte contre le changement climatique. Tout cela mérite d’être préservé, défendu, promu. Mais cela ne sera possible que si l’Europe est forte. Unie. Déterminée.
La réponse européenne doit être à la hauteur du défi. Elle doit être rapide, parce que le temps presse. Massive, parce que les besoins sont immenses. Coordonnée, parce que les efforts dispersés ne suffiront pas. Et déterminée, parce que les obstacles seront nombreux. Concrètement, cela signifie plusieurs choses. D’abord, une augmentation drastique des budgets de défense, avec l’objectif d’atteindre collectivement les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du continent sans dépendre de Washington. Ensuite, la création d’une véritable industrie de défense européenne, capable de produire les équipements dont l’Europe a besoin, de l’artillerie aux missiles en passant par les drones et les satellites. Puis, l’établissement d’un commandement militaire européen intégré, capable de planifier et de conduire des opérations de grande envergure. Enfin, le développement d’une politique étrangère commune, avec une voix unique sur la scène internationale, des positions coordonnées face aux crises, une capacité à défendre les intérêts européens. Tout cela est réalisable. Techniquement, économiquement, militairement. La seule question est : politiquement, l’Europe en a-t-elle la volonté ? Les dirigeants européens sont-ils prêts à prendre les décisions difficiles, à affronter les résistances, à assumer les coûts ? Les citoyens européens sont-ils prêts à soutenir ces efforts, à accepter les sacrifices nécessaires, à croire en un projet européen renforcé ? C’est la question à laquelle nous devrons répondre dans les mois et années à venir. Et de cette réponse dépendra notre avenir.
Je termine cet article avec un sentiment mélangé. De la colère, oui. De la tristesse, certainement. Mais aussi, étrangement, une forme de détermination. Parce que ce document de stratégie nationale, aussi choquant soit-il, a au moins le mérite de la clarté. Il nous dit la vérité. Une vérité brutale, insupportable, mais une vérité quand même. Washington ne nous considère plus comme des alliés. L’alliance atlantique est morte, ou mourante. Et nous devons nous débrouiller seuls. Eh bien soit. Débrouillons-nous. Construisons cette Europe de la défense dont on parle depuis des décennies. Créons cette autonomie stratégique qui nous permettra de contrôler notre destin. Montrons au monde que l’Europe n’est pas finie, qu’elle n’est pas en voie d’effacement, qu’elle a encore quelque chose à dire, à offrir, à défendre. Ça ne sera pas facile. Ça prendra du temps. Ça coûtera cher. Mais nous n’avons pas le choix. Parce que l’alternative, c’est la disparition. Et je refuse d’accepter ça. Nous refusons d’accepter ça. Alors battons-nous. Pour notre continent. Pour nos valeurs. Pour notre avenir.
Sources
Sources primaires
The White House – « National Security Strategy » (4 décembre 2025) – Document officiel de 33 pages publié par l’administration Trump définissant la stratégie de sécurité nationale des États-Unis
Kyiv Independent – « New US strategy document takes hard line on Europe’s ‘trajectory,’ NATO enlargement » par Martin Fornusek (5 décembre 2025) – Analyse détaillée du document de stratégie nationale et de ses implications pour l’Europe
Kyiv Post – « US Strategy Urges Halt to NATO Expansion, Warns Europe of ‘Civilizational Erasure' » par Alisa Orlova (5 décembre 2025) – Couverture des principales dispositions du document concernant l’OTAN et l’Europe
Euromaidan Press – « The new US security strategy includes a clause on ‘containing NATO expansion’ and criticism of Europe » par Maria Tril (5 décembre 2025) – Analyse de la position américaine sur l’expansion de l’OTAN et l’Ukraine
BBC News – « Trump administration says Europe faces ‘civilisational erasure' » par Brandon Livesay (5 décembre 2025) – Couverture des réactions européennes au document de stratégie nationale
CNN – « Trump lays bare his contempt for Europe in blistering new national security plan » par Nick Paton Walsh (5 décembre 2025) – Analyse critique du document et de son ton envers l’Europe
Der Spiegel – Transcription de l’appel entre dirigeants européens révélant les inquiétudes de Merz et Macron sur la politique américaine (décembre 2025)
Sources secondaires
German Marshall Fund – « The Trump Administration’s National Security Strategy » (5 décembre 2025) – Analyses par pays des implications du document pour les relations transatlantiques
Center for Strategic and International Studies (CSIS) – « The NSS That Could Destroy the NATO Alliance » (décembre 2025) – Évaluation des risques pour l’OTAN
Atlantic Council – « Experts react: What Trump’s National Security Strategy means for US foreign policy » (5 décembre 2025) – Table ronde d’experts sur les implications du document
Council on Foreign Relations (CFR) – « Unpacking a Trump Twist of the National Security Strategy » (décembre 2025) – Analyse des changements par rapport aux stratégies précédentes
Reuters – « Trump administration says Europe risks ‘civilisational erasure' » (5 décembre 2025) – Couverture internationale des réactions au document
The Guardian – « ‘Cultivate resistance’: policy paper lays bare Trump support for far-right » (5 décembre 2025) – Analyse de la dimension idéologique du document
European Policy Centre – « Trump’s new National Security Strategy – an existential threat to Europe » (décembre 2025) – Évaluation des menaces pour la sécurité européenne
Breaking Defense – « US National Security Strategy calls for reviving ‘Monroe Doctrine' » (5 décembre 2025) – Analyse du pivot vers l’hémisphère occidental
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.