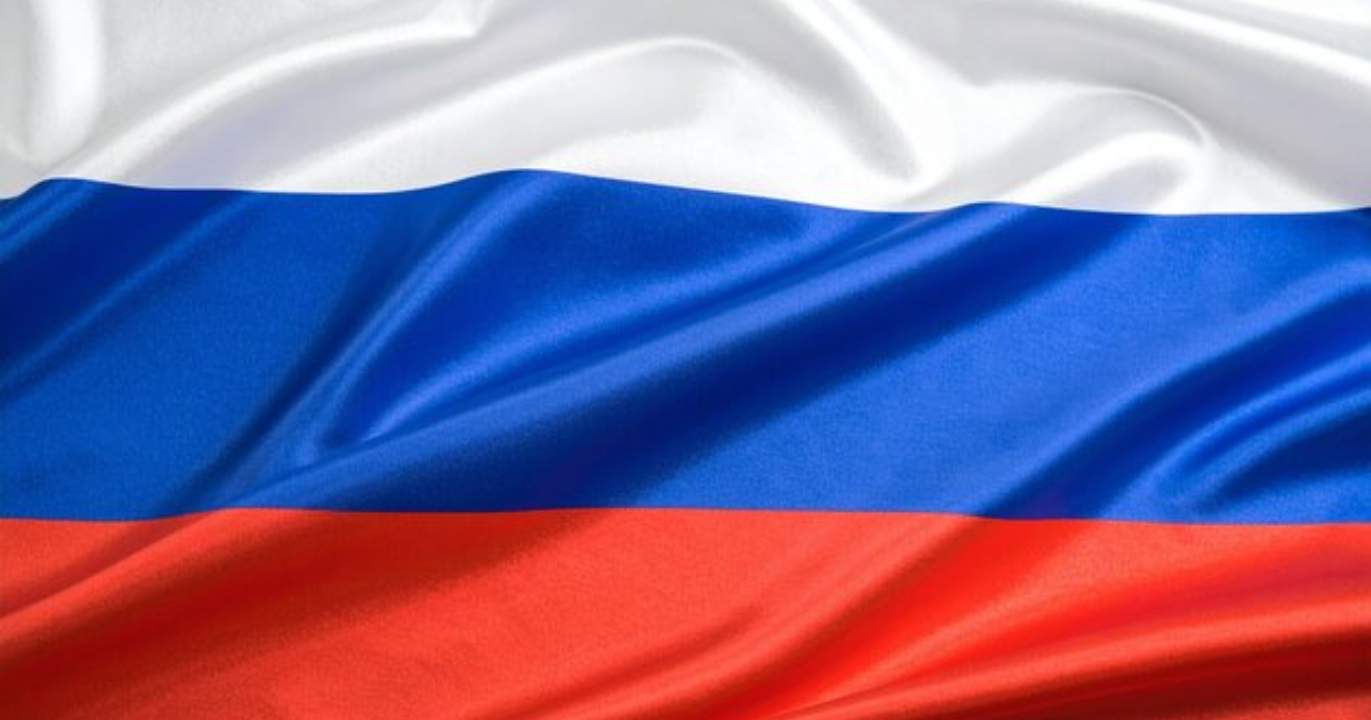
Quand l’Union soviétique s’effondra, l’Occident avait une occasion historique. Pour la première fois depuis 1945, il était possible de construire un ordre mondial véritablement pacifique, d’intégrer la Russie dans la famille des nations démocratiques, de tendre la main à un ancien ennemi devenu vulnérable.
Ce n’est pas ce qui s’est passé.
Ce qui s’est passé ressemble davantage à ce que font les vautours quand ils trouvent une carcasse encore chaude. Les conseillers économiques américains, menés par Jeffrey Sachs et ses disciples de Harvard, débarquèrent à Moscou avec une recette miracle : la « thérapie de choc ». L’idée était simple – libéraliser tout, privatiser tout, et le marché magique ferait le reste. Ce fut le plus grand transfert de richesse de l’histoire de l’humanité, mais pas dans le sens prévu.
En janvier 1992, Boris Eltsine libéralisa les prix du jour au lendemain. L’inflation explosa à 2 500% en un an. Les économies de toute une vie, ces roubles que les babouchkas avaient patiemment mis de côté pendant des décennies, ne valaient plus rien. Littéralement. Un retraité qui avait économisé assez pour acheter une voiture se retrouvait avec de quoi s’acheter un paquet de cigarettes.
Puis vinrent les privatisations. Sur le papier, chaque citoyen russe reçut des « vouchers » représentant sa part du patrimoine national. En pratique, des millions de Russes affamés vendirent leurs vouchers pour quelques dollars à des hommes d’affaires bien connectés. C’est ainsi que naquirent les oligarques – ces milliardaires sortis de nulle part qui s’approprièrent les fleurons de l’industrie soviétique pour des sommes dérisoires.
Mikhaïl Khodorkovski acheta Ioukos, une compagnie pétrolière valant des dizaines de milliards, pour 309 millions de dollars. Roman Abramovitch obtint Sibneft pour une fraction de sa valeur réelle. Boris Berezovski, Vladimir Goussinski, Vladimir Potanine – ces noms qui ne disaient rien à personne devinrent synonymes de richesse obscène pendant que le reste du pays sombrait.
La grande dépression russe

Les statistiques des années 90 en Russie ressemblent à celles d’un pays en guerre – parce que c’en était une, même si les bombes ne tombaient pas du ciel.
Le PIB russe s’effondra de 40% entre 1991 et 1998. Pour mettre cela en perspective, la Grande Dépression américaine des années 30 représentait une chute de 27%. L’effondrement russe fut pire, beaucoup pire, et personne en Occident ne sembla s’en soucier.
L’espérance de vie des hommes russes passa de 64 ans en 1990 à 57 ans en 1994. Une chute de sept ans en quatre ans. Dans aucun pays développé, en temps de paix, on n’avait jamais vu une telle catastrophe démographique. Les hommes mouraient – d’alcoolisme, de suicide, de désespoir, de maladies qui n’auraient jamais dû les tuer.
Les rues de Moscou et Saint-Pétersbourg se remplirent de mendiants, d’orphelins, de vétérans de l’Afghanistan en uniforme tendant la main. Les scientifiques qui avaient construit les fusées soviétiques vendaient des légumes au marché. Les professeurs d’université conduisaient des taxis la nuit pour survivre. Les médecins quittaient leurs hôpitaux pour devenir chauffeurs de mafia – ça payait mieux.
Dans les usines, les salaires n’étaient plus versés pendant des mois, parfois des années. Les ouvriers étaient payés « en nature » – en bouteilles de vodka, en casseroles, en tout ce que l’usine produisait. Un système de troc médiéval s’installa au cœur de ce qui avait été la deuxième économie mondiale.
Les écoles manquaient de chauffage. Les hôpitaux manquaient de médicaments. L’armée, cette fière Armée Rouge qui avait vaincu Hitler, ne pouvait plus nourrir ses conscrits. Des soldats mouraient de malnutrition dans leurs casernes. Des sous-marins nucléaires rouillaient dans leurs ports parce qu’il n’y avait plus d’argent pour les entretenir.
L'humiliation géopolitique
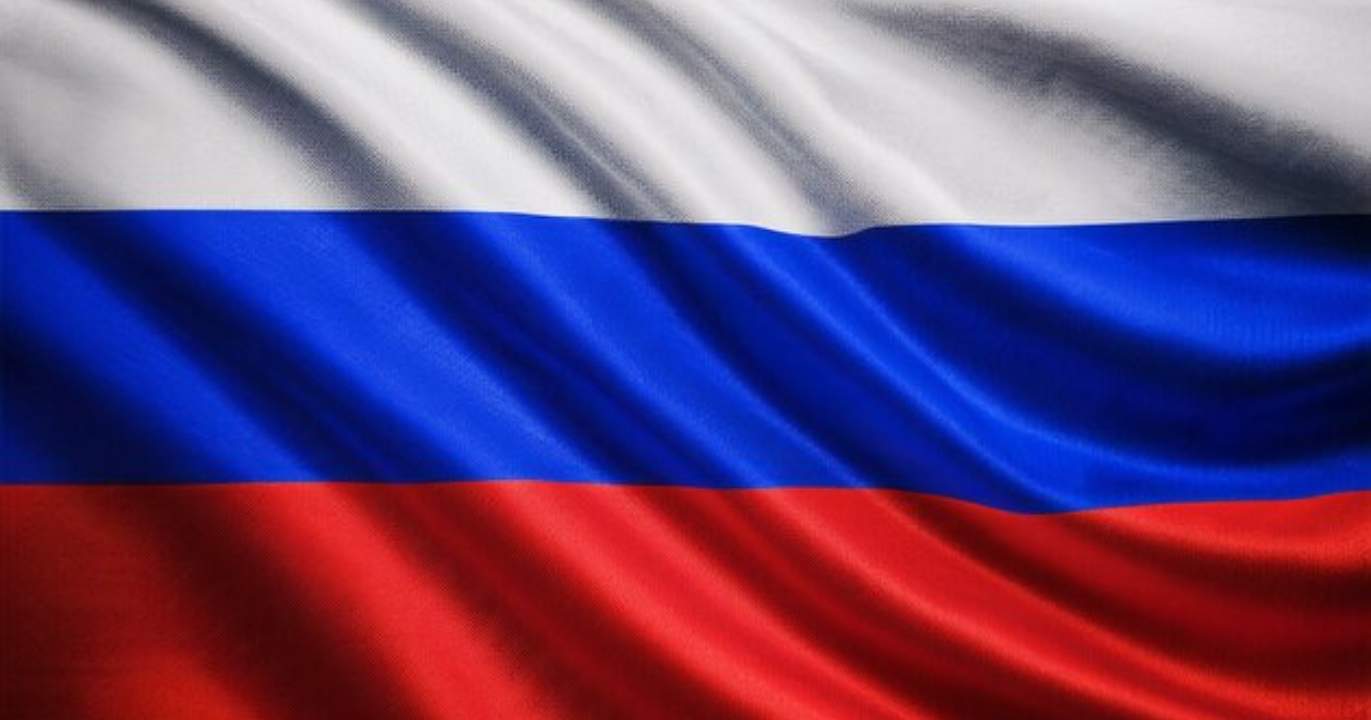
Mais pour beaucoup de Russes, la souffrance économique n’était pas le pire. Le pire, c’était l’humiliation. Cette impression constante que l’Occident, et particulièrement les États-Unis, prenait plaisir à piétiner un adversaire à terre.
En 1990, lors des négociations sur la réunification allemande, le secrétaire d’État américain James Baker avait promis à Mikhaïl Gorbatchev que l’OTAN ne s’étendrait « pas d’un pouce vers l’Est ». C’était un gentleman’s agreement, non écrit, mais les Russes s’en souvenaient. Ils se souviennent de tout.
En 1999, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque rejoignirent l’OTAN. Puis ce fut le tour des pays baltes en 2004, ces anciennes républiques soviétiques où vivaient des millions de Russes ethniques. Chaque élargissement était présenté comme un « droit souverain » de ces pays, et techniquement, c’était vrai. Mais pour Moscou, c’était la preuve que les promesses américaines ne valaient rien.
La même année 1999, l’OTAN bombarda la Serbie pendant 78 jours pour la forcer à abandonner le Kosovo. La Russie, alliée traditionnelle des Serbes, ne put rien faire. Elle protesta aux Nations Unies, mais ses protestations furent ignorées. Vladimir Poutine, alors directeur du FSB, observait. Il prenait des notes.
En 2003, les Américains envahirent l’Irak sans mandat de l’ONU, prouvant que les règles internationales ne s’appliquaient qu’aux faibles. En 2011, l’OTAN transforma une résolution humanitaire sur la Libye en opération de changement de régime, tuant Kadhafi. La Russie avait voté pour cette résolution, pensant qu’il s’agissait vraiment de protéger des civils. Elle se sentit trahie.
Mais l’humiliation la plus profonde était peut-être la plus quotidienne. C’était la condescendance des experts occidentaux qui venaient expliquer aux Russes comment gérer leur pays. C’était les films hollywoodiens où le méchant avait toujours un accent russe. C’était les articles de presse qui traitaient la Russie comme un pays du tiers-monde avec des armes nucléaires. C’était le sentiment que l’Occident avait gagné la guerre froide et qu’il ne laisserait jamais les Russes l’oublier.
Boris Eltsine : le tsar ivre

Au milieu de ce chaos régnait Boris Eltsine, premier président de la Fédération de Russie. Grand, massif, souvent ivre, Eltsine était l’incarnation parfaite du désarroi russe. L’homme qui avait eu le courage de monter sur un tank pour défier le coup d’État de 1991 était devenu une caricature titubante, incapable de descendre d’un avion sans trébucher.
Les images d’Eltsine ivre sont gravées dans la mémoire collective russe. Le voici qui essaie de diriger un orchestre en Allemagne, agitant les bras de façon grotesque. Le voici qui manque de tomber en descendant les marches lors d’une visite officielle. Le voici qui disparaît pendant des jours, officiellement pour « problèmes de santé », en réalité pour des cuites monumentales.
Pour les Russes, Eltsine était l’incarnation de leur humiliation. Leur président était la risée du monde, et par extension, ils l’étaient aussi. Les Américains riaient, les Européens levaient les yeux au ciel, et chaque photo d’Eltsine titubant était une gifle au visage de 145 millions de personnes.
Pire encore, Eltsine semblait incapable de dire non à l’Occident. Il acceptait les « conseils » du FMI qui plongeaient son peuple dans la misère. Il restait silencieux quand l’OTAN bombardait la Serbie. Il laissait les oligarques piller le pays pendant que Bill Clinton lui tapait dans le dos et l’appelait « mon ami Boris ».
En 1996, Eltsine était si impopulaire qu’il faillit perdre l’élection présidentielle face au candidat communiste Guennadi Ziouganov. Sa cote de popularité était tombée à 3%. Trois pour cent. Il fut réélu grâce à une campagne massive financée par les oligarques et, selon de nombreuses sources, par une manipulation à grande échelle des résultats. L’Occident applaudit sa « victoire démocratique ».
La crise de 1998 : le fond du gouffre

Si les années 90 furent une descente aux enfers, août 1998 fut l’arrivée au fond du gouffre.
Le 17 août, le gouvernement russe annonça qu’il ne pouvait plus rembourser sa dette. Le rouble s’effondra, perdant les deux tiers de sa valeur en quelques semaines. Les banques fermèrent leurs portes. Les guichets automatiques cessèrent de fonctionner. Les gens qui avaient de l’argent en banque le virent disparaître du jour au lendemain – encore une fois.
Pour la deuxième fois en sept ans, les économies des Russes ordinaires furent anéanties. Une nouvelle génération apprit que les promesses de l’économie de marché ne valaient rien, que la stabilité était une illusion, que seuls les puissants et les connectés survivaient.
Le FMI, qui avait accordé des milliards de dollars de prêts à la Russie pendant les années 90, haussa les épaules. L’argent avait largement disparu dans les poches des oligarques et les comptes offshore. La corruption était endémique, mais les conseillers occidentaux qui l’avaient encouragée – ou du moins ignorée – n’assumaient aucune responsabilité.
C’est dans ce contexte de chaos absolu qu’un homme petit, discret, aux yeux de glace, commença son ascension vers le pouvoir.
L'émergence de Poutine

En août 1999, Boris Eltsine, malade, alcoolique, à bout de forces, nomma un obscur bureaucrate nommé Vladimir Poutine au poste de Premier ministre. C’était le cinquième Premier ministre en moins de deux ans. Personne ne s’attendait à ce qu’il dure plus longtemps que les autres.
Poutine n’avait aucun charisme évident, aucune base politique propre, aucune expérience électorale. Il avait passé sa carrière dans l’ombre – d’abord au KGB, puis comme adjoint du maire de Saint-Pétersbourg, puis comme directeur du FSB. C’était un homme de l’appareil, pas un leader populaire.
Mais Poutine avait quelque chose que les autres n’avaient pas : une détermination froide et une absence totale de scrupules. Quelques semaines après sa nomination, des explosions détruisirent des immeubles d’habitation à Moscou et dans d’autres villes, tuant près de 300 personnes. Le gouvernement accusa les terroristes tchétchènes. Poutine lança la seconde guerre de Tchétchénie avec une brutalité qui choqua même les vétérans de l’Afghanistan.
« On ira les buter jusque dans les chiottes », déclara-t-il. Cette phrase grossière, impensable dans la bouche d’un dirigeant occidental, fit de lui un héros aux yeux de millions de Russes. Enfin un leader qui ne s’excusait pas, qui ne courbait pas l’éChine, qui parlait comme un homme et non comme un diplomate.
La popularité de Poutine explosa. En quelques mois, cet inconnu devint l’homme le plus populaire de Russie. Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine démissionna dans un discours larmoyant où il demanda pardon à son peuple. Il passa le pouvoir à Poutine, qui devint président par intérim.
En mars 2000, Poutine fut élu président avec 53% des voix. Il avait 47 ans. Il resterait au pouvoir pendant les vingt-cinq années suivantes – et probablement jusqu’à sa mort.
Les leçons que Poutine tira des années 90

Pour comprendre ce que Poutine a fait ensuite, il faut comprendre ce que les années 90 lui ont appris. Et ces leçons expliquent presque tout.
Première leçon : l’Occident ne respecte que la force. Pendant toutes les années 90, la Russie avait essayé de coopérer, de s’intégrer, de jouer selon les règles occidentales. Et qu’avait-elle obtenu en retour ? L’élargissement de l’OTAN, le bombardement de la Serbie, des leçons de morale constantes et une aide économique qui avait surtout enrichi les consultants de Harvard. La faiblesse n’apportait que le mépris.
Deuxième leçon : la démocratie libérale mène au chaos. Les années Eltsine, avec leur liberté de presse, leurs élections compétitives et leur économie de marché, avaient été une catastrophe absolue. Le pays s’était effondré, le peuple avait souffert, la Russie était devenue la risée du monde. La démocratie à l’occidentale n’était pas une solution – c’était le problème.
Troisième leçon : les oligarques doivent être contrôlés. Ces hommes qui avaient pillé le pays pendant qu’Eltsine buvait devaient être mis au pas. Non pas éliminés – ils étaient trop utiles – mais subordonnés au pouvoir politique. L’argent devait servir l’État, pas le contraire.
Quatrième leçon : la stabilité vaut tous les sacrifices. Le peuple russe avait vécu dix ans de chaos, d’incertitude, de peur constante du lendemain. Ce qu’il voulait, ce n’était pas la liberté abstraite des philosophes occidentaux. C’était la sécurité, la prévisibilité, un salaire payé à temps, une pension garantie, un avenir pour ses enfants.
Cinquième leçon : les promesses occidentales ne valent rien. « Pas un pouce vers l’Est », avait dit James Baker. Et pourtant. Les Russes avaient cru aux promesses d’intégration, de partenariat, de respect mutuel. Ils avaient été naïfs. Ils ne le seraient plus.
La vengeance silencieuse
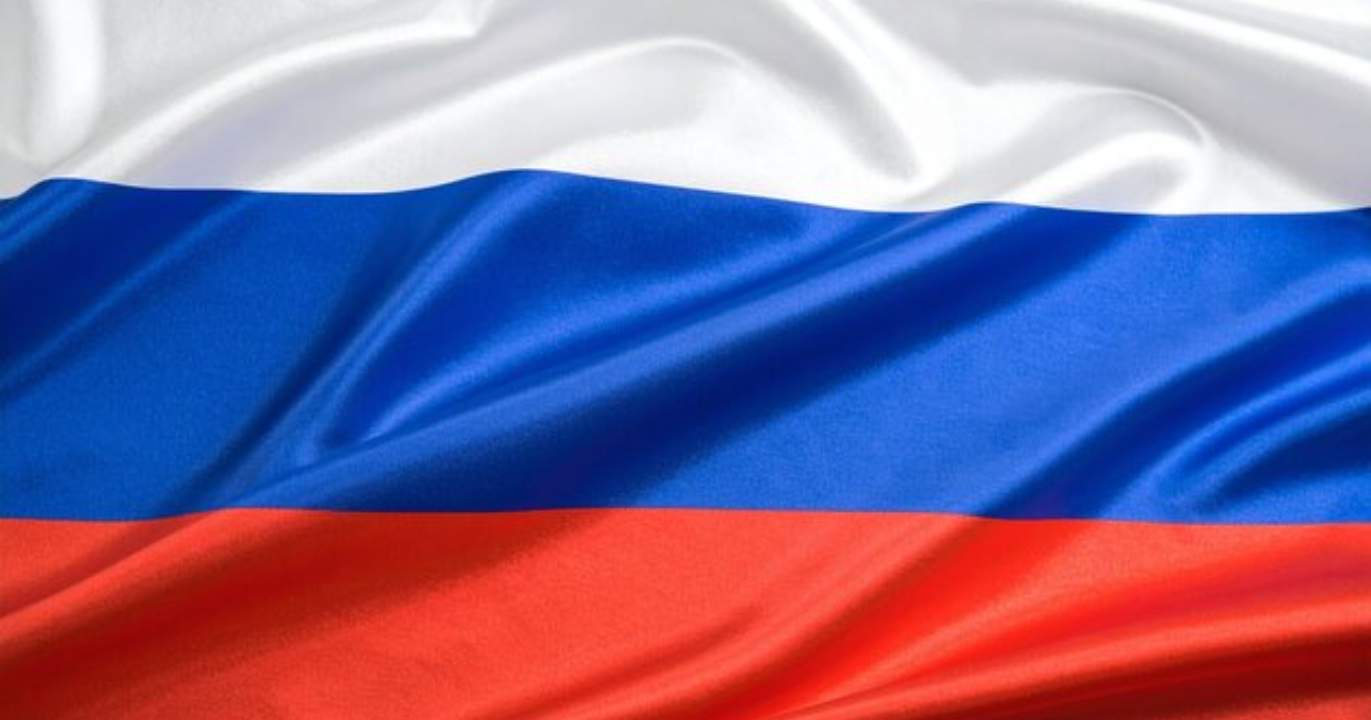
Les vingt années suivantes de politique russe ne furent, à bien des égards, qu’une longue revanche sur les années 90.
Poutine domestiqua les oligarques – ceux qui résistèrent, comme Khodorkovski, finirent en prison ou en exil. Il recentralisa le pouvoir, éliminant les gouverneurs élus et les médias indépendants. Il reconstruisit l’armée, la modernisa, lui rendit sa fierté. Il remboursa la dette extérieure et accumula des réserves de change colossales. Il utilisa le pétrole et le gaz comme armes géopolitiques.
Quand les Américains installèrent un bouclier antimissile en Europe de l’Est, il modernisa l’arsenal nucléaire russe. Quand l’Occident soutint les « révolutions colorées » en Géorgie et en Ukraine, il soutint les séparatistes et intervint militairement. Quand l’Occident imposa des sanctions après la Crimée, il se tourna vers la Chine.
À chaque étape, Poutine agissait selon la logique des années 90 : ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais faire confiance à l’Occident, toujours négocier en position de force.
Pourquoi cela nous concerne
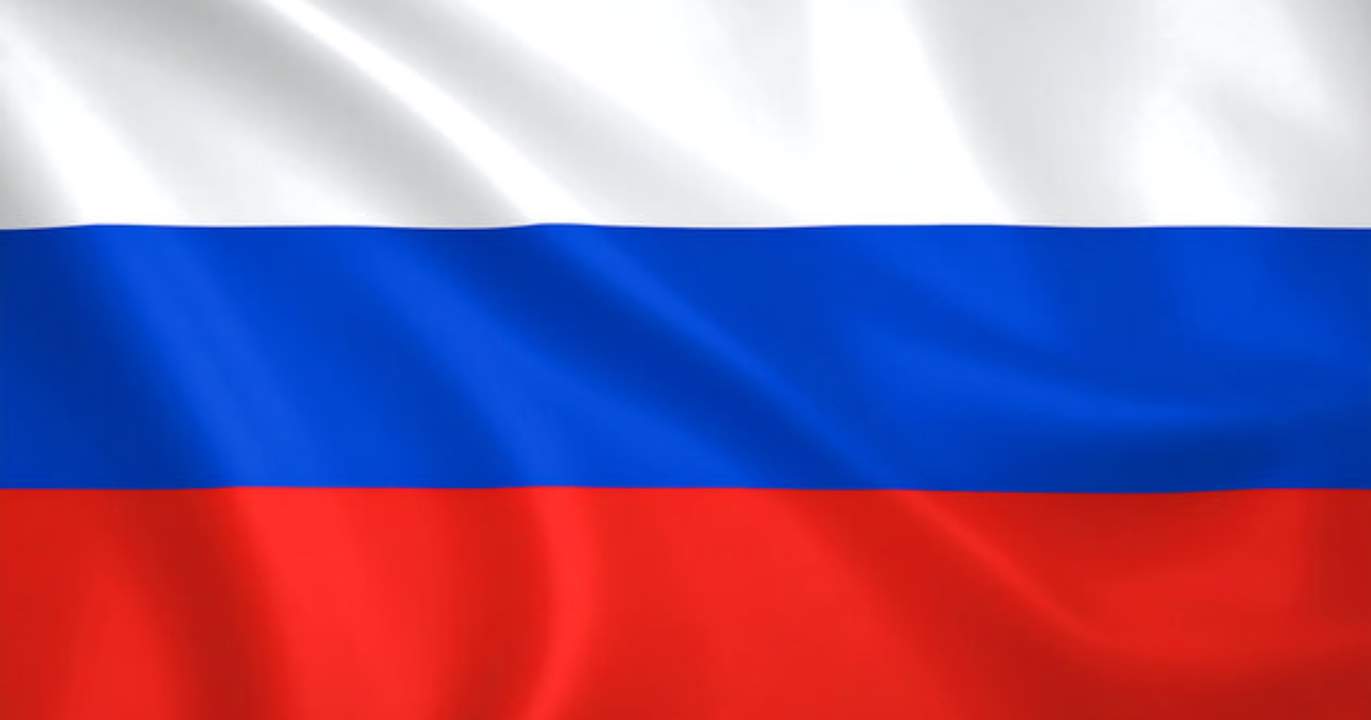
On peut condamner Poutine – et il y a beaucoup à condamner. L’écrasement de la liberté de presse, l’empoisonnement des opposants, la brutalité en Tchétchénie, l’invasion de l’Ukraine. Ces actes sont inexcusables et aucune explication historique ne les justifie.
Mais comprendre n’est pas excuser. Et si l’on veut un jour sortir de cette confrontation, il faut comprendre comment on en est arrivé là.
Les années 90 ne sont pas seulement l’histoire de la Russie. Elles sont aussi l’histoire de l’Occident – de son arrogance, de son triomphalisme, de son incapacité à voir dans l’ancien ennemi un partenaire potentiel plutôt qu’un vaincu à humilier.
Quand un pays de 145 millions d’habitants, doté de 6 000 têtes nucléaires et d’une histoire millénaire, se sent humilié pendant une décennie, les conséquences ne s’effacent pas en une génération. La Russie de 2024 est le produit direct de la Russie de 1999. Et la Russie de 1999 est le produit de tout ce que l’Occident a fait – ou n’a pas fait – pendant les années 90.
Il était une fois un empire qui s’effondra. Les vainqueurs auraient pu l’aider à se relever. Ils préférèrent le regarder tomber et rire de ses blessures. Trente ans plus tard, le monde en paie le prix.
La morale de cette histoire ? Il n’y en a pas de simple. Peut-être simplement ceci : l’humiliation est une dette qui finit toujours par se payer. Et quand c’est un pays entier qui a été humilié, c’est le monde entier qui paie les intérêts.
Cette analyse fait partie d’une série cherchant à comprendre la perspective russe sans la justifier. Comprendre son adversaire n’est pas l’approuver – c’est la première étape pour éviter le prochain conflit.
Sources
Foreign Affairs – « Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault »
The Guardian – « The Devastation of Russian Society in the 1990s »
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.