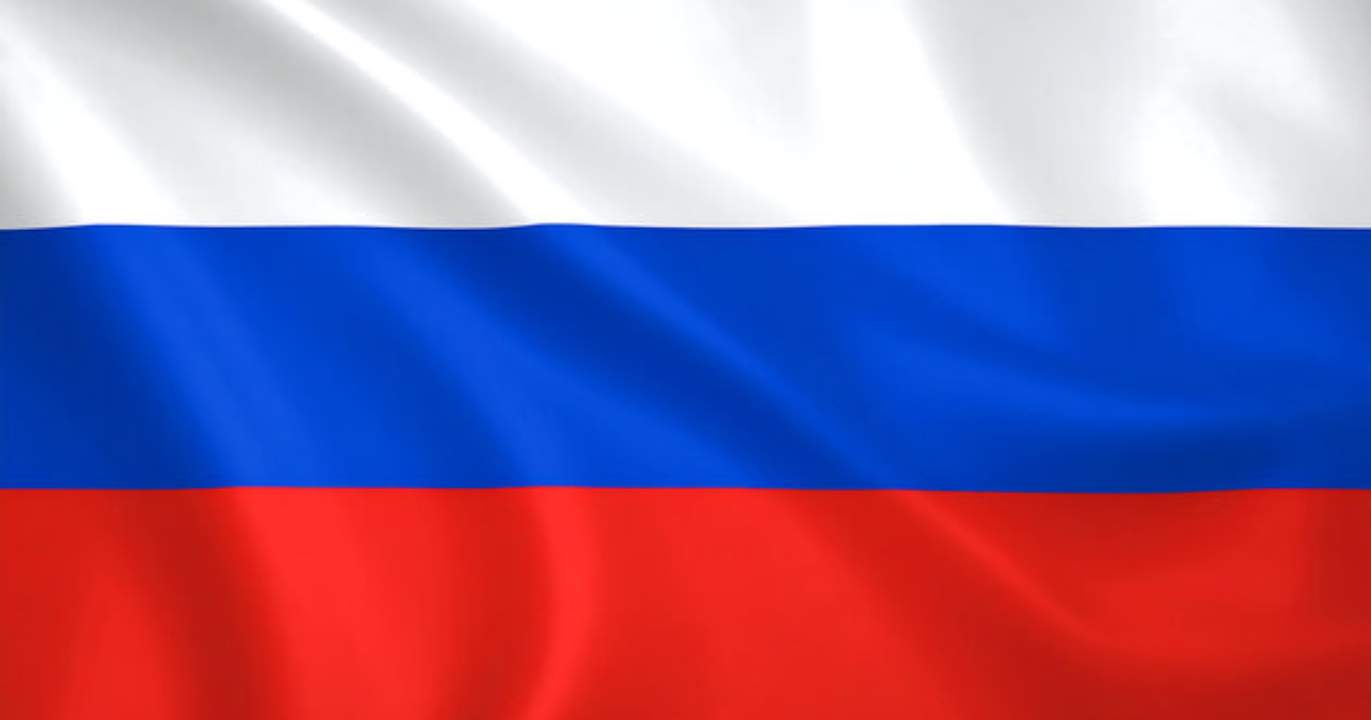
La Russie est le plus grand pays du monde par sa superficie, mais c’est aussi l’un des plus vulnérables géographiquement. Cela peut sembler paradoxal, mais l’histoire l’explique.
Regardez une carte topographique de l’Europe de l’Est. Entre Berlin et Moscou, il n’y a rien. Pas de montagnes, pas de grands fleuves, rien qui puisse arrêter une armée en marche. C’est la Grande Plaine Européenne – un corridor d’invasion qui s’étend des Ardennes à l’Oural.
Par ce corridor sont passés les chevaliers teutoniques au XIIIe siècle, les Polonais au XVIIe, les Suédois au XVIIIe, Napoléon au XIXe, et Hitler au XXe. À chaque fois, la Russie a été envahie. À chaque fois, des millions de Russes sont morts. La Grande Guerre patriotique (1941-1945) a coûté 27 millions de vies soviétiques – un chiffre tellement astronomique qu’il défie l’imagination.
Cette histoire forge une obsession sécuritaire que les Occidentaux peinent à comprendre. Pour un Américain protégé par deux océans, la sécurité est un acquis naturel. Pour un Russe dont les arrière-grands-parents ont survécu au siège de Leningrad, elle est une conquête fragile, toujours menacée.
C’est pourquoi, depuis des siècles, la stratégie russe poursuit un objectif constant : créer de la profondeur stratégique. Repousser les frontières le plus loin possible. Créer des États-tampons entre le cœur de la Russie et ses ennemis potentiels. Contrôler les points d’étranglement. Ne jamais, jamais laisser un ennemi s’approcher assez pour frapper.
Les promesses rompues
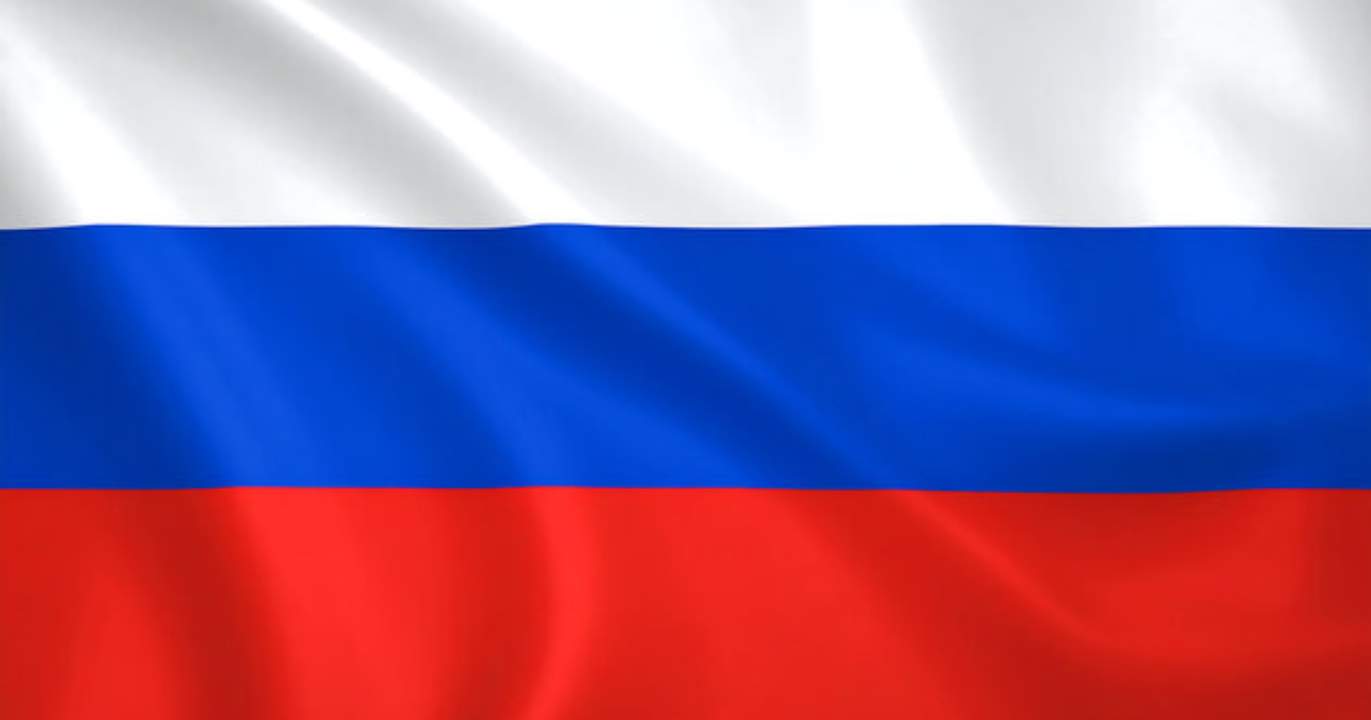
Quand l’Union soviétique s’effondra, la Russie accepta ce qui semblait être un accord historique. Elle retirerait ses troupes d’Europe de l’Est, elle laisserait l’Allemagne se réunifier, elle dissoudrait le Pacte de Varsovie. En échange, l’OTAN ne s’étendrait pas vers l’Est.
Cette promesse fut-elle vraiment faite ? Le débat fait rage depuis trente ans. Les Américains affirment qu’aucun engagement formel n’a été pris. Les Russes citent les déclarations de James Baker, secrétaire d’État américain, qui aurait promis à Gorbatchev que l’OTAN ne s’étendrait « pas d’un pouce vers l’Est ».
La vérité est probablement entre les deux. Il y eut des assurances verbales, des engagements implicites, des « gentleman’s agreements » qui n’ont jamais été formalisés dans un traité. Quand vint le temps de les honorer, l’Occident décida qu’ils n’avaient jamais existé.
En 1999, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque rejoignirent l’OTAN. En 2004, ce fut le tour de sept pays supplémentaires, dont les trois États baltes – d’anciennes républiques soviétiques où la Russie avait encore des minorités importantes. À chaque élargissement, Moscou protesta. À chaque fois, ses protestations furent ignorées.
Pour l’Occident, ces élargissements étaient légitimes : des nations souveraines exerçant leur droit de choisir leurs alliances. Pour la Russie, c’était une trahison, la preuve que les promesses américaines ne valaient rien et que l’OTAN n’avait qu’un seul objectif : affaiblir et encercler la Russie.
Le bouclier antimissile : protection ou provocation ?
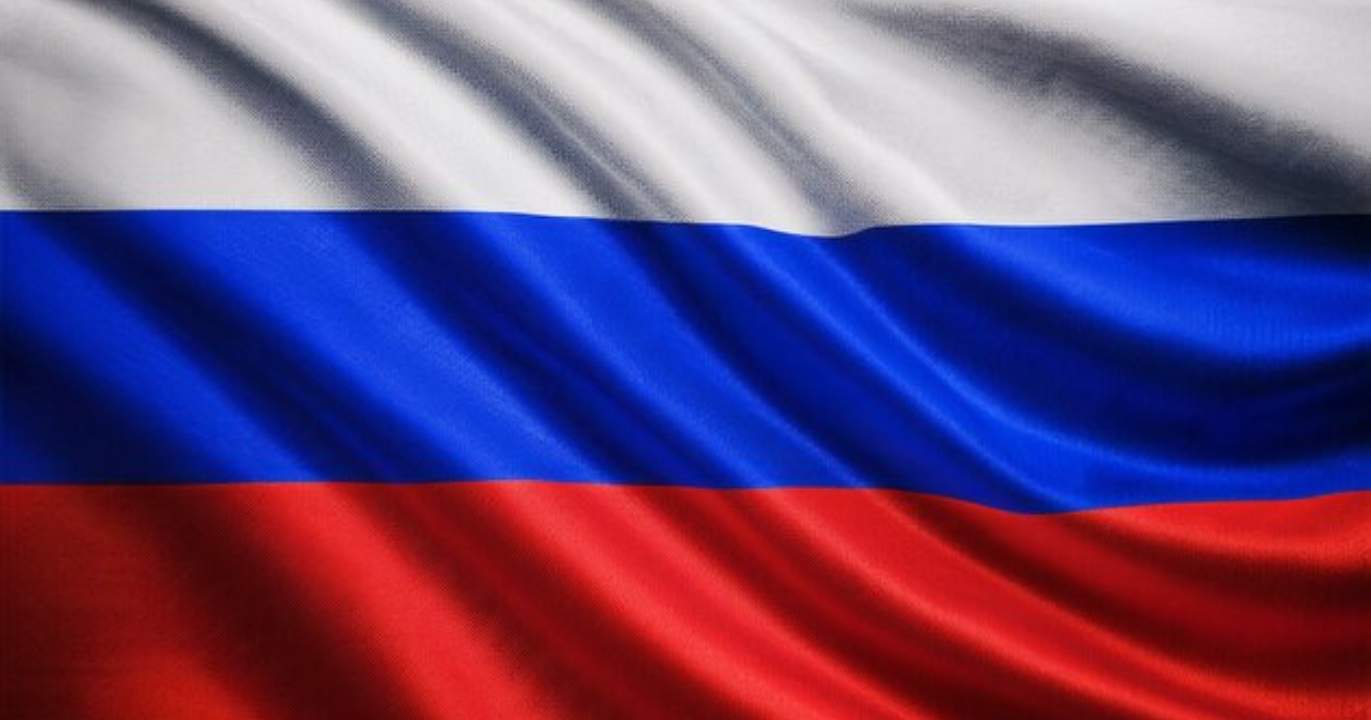
En 2007, l’administration Bush annonça son intention de déployer un système de défense antimissile en Europe de l’Est – des intercepteurs en Pologne et un radar en République tchèque. L’objectif officiel était de protéger l’Europe contre les missiles iraniens.
La Russie n’y crut pas une seconde.
Du point de vue russe, ce bouclier était dirigé contre elle, pas contre l’Iran. Les sites choisis étaient parfaitement positionnés pour intercepter des missiles russes traversant l’espace polonais. Et même si le système initial était modeste, rien n’empêchait de l’étendre et de le perfectionner jusqu’à neutraliser la dissuasion nucléaire russe.
La dissuasion nucléaire est la garantie ultime de sécurité de la Russie. Sans elle, la Russie est vulnérable – un grand pays avec une économie moyenne et une armée conventionnelle qui, malgré les réformes, reste inférieure à celle de l’OTAN. Le bouclier antimissile, même partiel, menaçait cette garantie.
L’administration Obama modifia le projet mais ne l’abandonna pas. Des systèmes Aegis Ashore furent installés en Roumanie (2016) puis en Pologne (2022). Pour Washington, c’était de la défense pure. Pour Moscou, c’était une menace existentielle qui s’installait aux frontières.
L'OTAN aux portes

Mais la vraie ligne rouge, celle que Poutine avait tracée dès 2008, concernait l’Ukraine et la Géorgie.
Au sommet de l’OTAN à Bucarest en avril 2008, les États-Unis poussèrent pour offrir à l’Ukraine et à la Géorgie le « Membership Action Plan » (MAP), première étape vers l’adhésion. L’Allemagne et la France s’y opposèrent, conscientes des risques. Le compromis fut une déclaration ambiguë : « L’Ukraine et la Géorgie deviendront membres de l’OTAN« , sans calendrier ni MAP.
Pour Washington, c’était une façon de satisfaire les nouveaux amis de l’Europe de l’Est sans trop provoquer Moscou. Pour Moscou, c’était une déclaration de guerre à retardement. L’Ukraine dans l’OTAN, cela signifiait des bases américaines à 450 kilomètres de Moscou. Des missiles à cinq minutes de vol de la capitale russe. Une armée hostile sur la plus longue frontière occidentale de la Russie.
Quatre mois plus tard, la Russie envahissait la Géorgie. La guerre fut brève – cinq jours – mais le message était clair. Poutine avait tracé une ligne. L’Occident ferait bien de ne pas la franchir.
Le coup d'État qui n'en était pas un (ou peut-être que si)

En novembre 2013, le président ukrainien Viktor Ianoukovitch refusa de signer un accord d’association avec l’Union européenne, préférant un arrangement financier avec la Russie. Des manifestations éclatèrent à Kiev, sur la place Maïdan. En février 2014, après des semaines de protestations et des violences qui firent une centaine de morts, Ianoukovitch s’enfuit en Russie.
Pour l’Occident, c’était une révolution populaire – le peuple ukrainien rejetant un président corrompu et pro-russe pour choisir la voie européenne. Pour Moscou, c’était un coup d’État orchestré par les services américains, avec le soutien de néo-nazis ukrainiens.
La vérité est complexe. Les manifestations étaient authentiquement populaires, mais les États-Unis et l’UE ne cachaient pas leur soutien aux manifestants. Victoria Nuland, secrétaire d’État adjointe américaine, fut enregistrée en train de discuter de qui devrait diriger l’Ukraine post-Ianoukovitch (son fameux « Fuck the EU » devint viral). Des nationalistes radicaux, certains arborant des symboles nazis, jouèrent un rôle visible dans les affrontements.
Peu importe qui a raison dans ce débat. Ce qui compte, c’est que Moscou interpréta les événements comme une opération de changement de régime, une tentative de faire basculer l’Ukraine dans le camp occidental par la force. Et si cela pouvait arriver à Kiev, cela pouvait arriver à Moscou.
La réponse de Poutine fut l’annexion de la Crimée et le soutien aux séparatistes du Donbass. L’Occident imposa des sanctions. L’escalade avait commencé.
Voir le monde comme Moscou le voit

Pour comprendre la perception russe de l’encerclement, il faut faire un exercice d’imagination. Inversez les rôles.
Imaginez que le Pacte de Varsovie ait gagné la guerre froide. Imaginez que le Canada et le Mexique rejoignent une alliance militaire dirigée par Moscou. Imaginez des missiles russes au Québec, des bases navales à Veracruz, des troupes russes en rotation permanente à Toronto.
Imaginez maintenant que, chaque fois que les États-Unis protestent, on leur réponde que le Canada a le droit souverain de choisir ses alliances, que ces déploiements sont purement défensifs, et que leurs inquiétudes sont de la paranoïa.
Comment réagiraient les États-Unis ?
On connaît la réponse : la crise des missiles de Cuba en 1962 montra exactement comment l’Amérique réagit quand un adversaire installe des armes offensives à ses frontières. Kennedy menaça de guerre nucléaire. Les missiles soviétiques furent retirés.
La différence, c’est que la Russie n’a pas le pouvoir d’exiger un retrait de l’OTAN. Elle ne peut qu’accepter l’encerclement ou résister par d’autres moyens.
Les lignes rouges ignorées
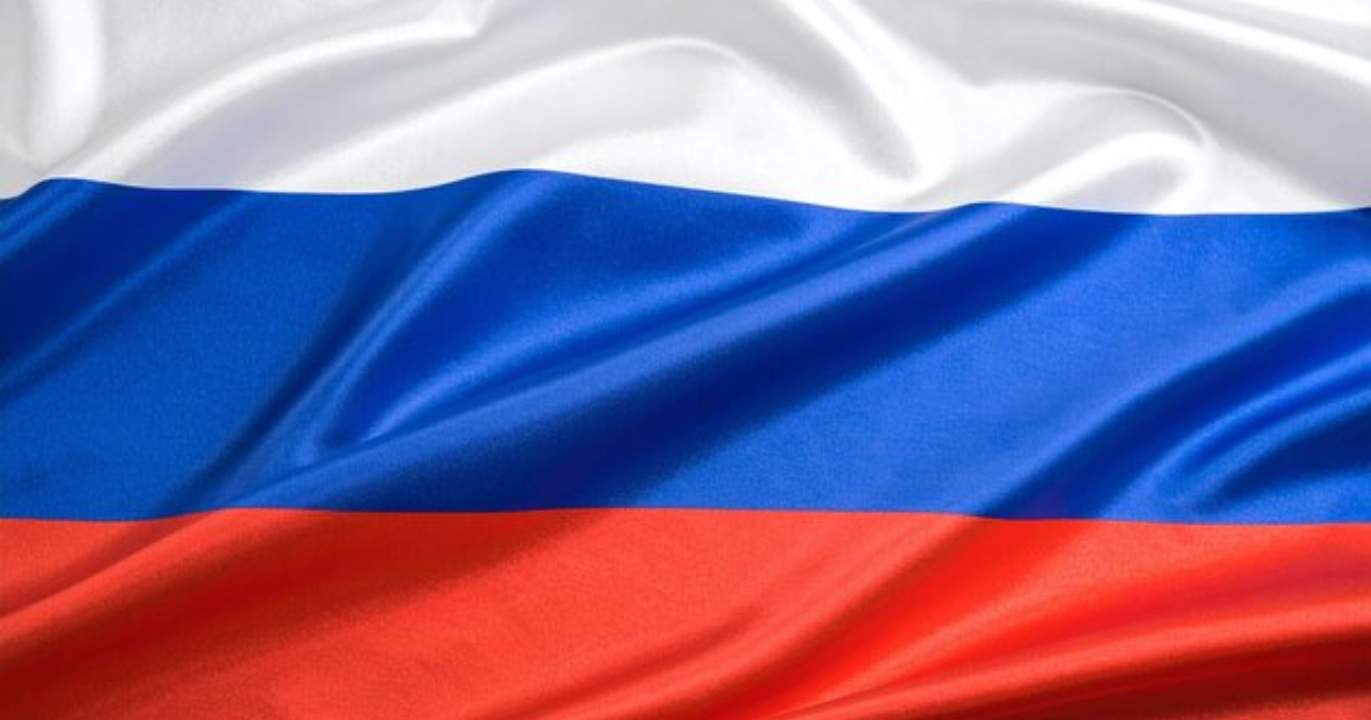
Pendant vingt ans, la Russie a multiplié les avertissements. Le discours de Poutine à Munich en 2007. Les guerres en Géorgie et en Ukraine. Les déclarations répétées sur le caractère inacceptable de l’adhésion ukrainienne à l’OTAN.
L’Occident a choisi de ne pas écouter. Pourquoi ?
Partiellement par arrogance. Après la guerre froide, beaucoup en Occident considéraient que l’histoire était finie, que la démocratie libérale avait gagné, que la Russie finirait par s’intégrer au système occidental ou deviendrait insignifiante. Les préoccupations sécuritaires russes étaient traitées comme des reliques du passé, pas comme des facteurs stratégiques sérieux.
Partiellement par idéologie. Le droit des nations à choisir leurs alliances est un principe fondamental de l’ordre libéral international. Reconnaître des « sphères d’influence » russes semblait revenir en arrière, aux accords de Yalta, à la division de l’Europe en zones. C’était moralement inacceptable.
Partiellement par calcul politique. Les nouveaux membres de l’OTAN – Pologne, Roumanie, pays baltes – avaient une peur viscérale et compréhensible de la Russie. Ignorer leurs demandes d’adhésion aurait été politiquement impossible et stratégiquement imprudent.
Mais le résultat fut que la Russie se sentit de plus en plus acculée, sans options diplomatiques, forcée de choisir entre la soumission et l’escalade.
L'encerclement est-il réel ?

Soyons honnêtes : l’encerclement russe est partiellement une construction rhétorique. L’OTAN n’a jamais eu l’intention d’envahir la Russie. Les déploiements en Europe de l’Est sont insignifiants par rapport à l’armée russe. Et la Russie possède des milliers d’armes nucléaires qui rendent toute agression directe suicidaire.
Mais les perceptions comptent autant que la réalité en politique internationale. Et du point de vue russe, l’histoire justifie la méfiance.
L’OTAN est née pour contenir l’URSS. Son premier secrétaire général décrivit son objectif : « Garder les Russes dehors, les Américains dedans, et les Allemands en bas. » Cette mission originelle n’a jamais été formellement abandonnée.
Les élargissements successifs ont rapproché l’OTAN des frontières russes, même si chaque élargissement était justifié par le droit des petits pays à la sécurité. Vue de Moscou, l’intention ne change rien au résultat : l’alliance militaire la plus puissante du monde est désormais aux portes de la Russie.
Et les interventions occidentales – Kosovo, Irak, Libye – ont montré que l’OTAN pouvait agir offensivement, renverser des régimes, ignorer le droit international quand cela l’arrangeait. Pourquoi la Russie devrait-elle croire que ce ne serait jamais son tour ?
Le piège de la prophétie auto-réalisatrice

Le plus tragique dans cette histoire est son caractère auto-réalisateur.
La Russie se sentait menacée par l’OTAN, donc elle a agi de façon agressive. Cette agressivité a poussé ses voisins à chercher la protection de l’OTAN. Ce qui a renforcé le sentiment d’encerclement russe. Ce qui a provoqué plus d’agressivité.
L’invasion de l’Ukraine en 2022 a produit exactement ce que Poutine voulait éviter : une OTAN plus unie, plus militarisée, plus proche des frontières russes que jamais. La Finlande et la Suède ont rejoint l’alliance. L’Allemagne s’est réarmée. Des troupes américaines supplémentaires sont stationnées en Pologne et dans les pays baltes.
Du point de vue de la sécurité russe, l’invasion a été un désastre. Mais du point de vue de Poutine, c’était peut-être un pari calculé : mieux valait l’instabilité que l’absorption progressive de l’Ukraine dans l’orbite occidentale.
Que faire de cette perception ?

Reconnaître que la Russie se sent encerclée ne signifie pas lui donner raison. Les petits pays d’Europe de l’Est ont des raisons légitimes de craindre leur ancien oppresseur soviétique. Leur droit à la sécurité ne peut pas être sacrifié pour apaiser les angoisses russes.
Mais refuser de comprendre cette perception, la balayer comme de la paranoïa ou de la propagande, c’est se condamner à ne jamais sortir du cycle de l’escalade.
La question n’est pas de savoir qui a raison. La question est de savoir comment on construit un ordre européen qui prenne en compte les intérêts de sécurité de tous – y compris ceux de la Russie – sans sacrifier la souveraineté des plus petits.
Pendant trente ans, cette question a été ignorée. L’Occident a cru qu’il pouvait étendre indéfiniment son système sans conséquences. La Russie a cru qu’elle pouvait imposer ses lignes rouges par la force. Les deux avaient tort.
La cage et l'ours
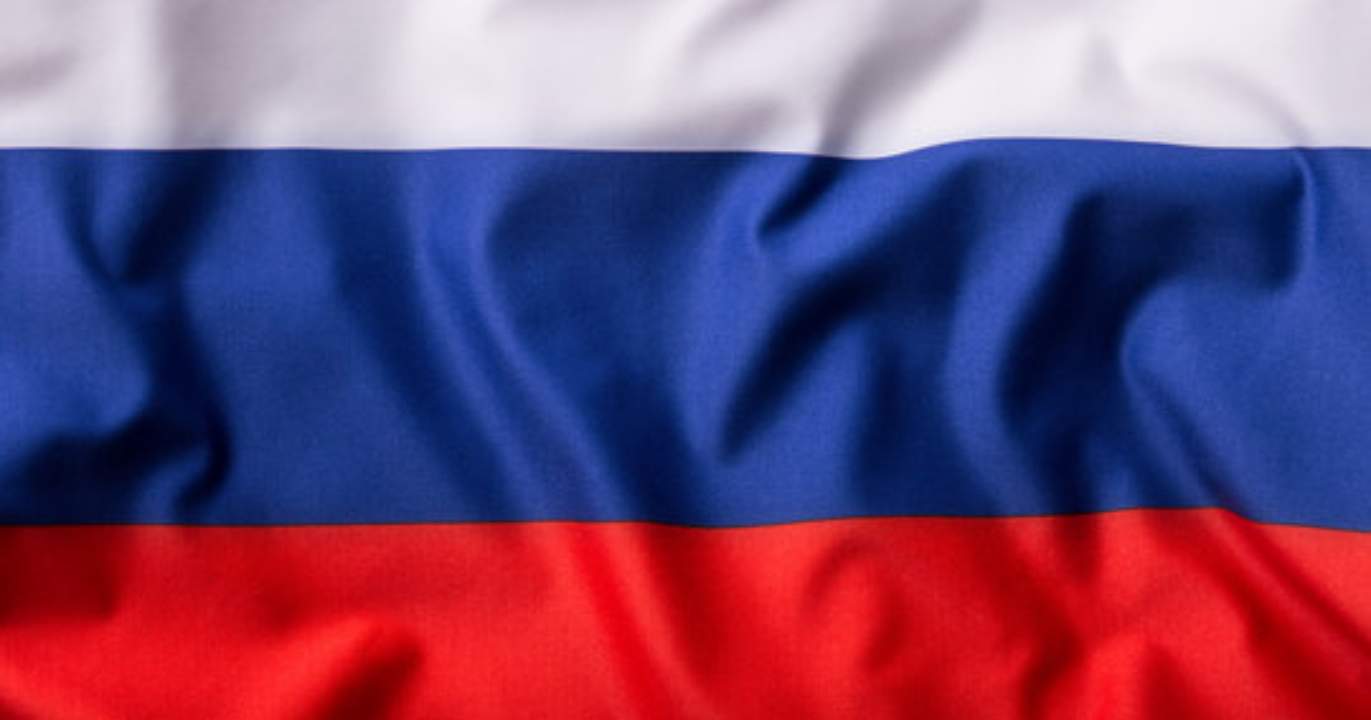
Il était une fois un grand ours qui vivait dans une forêt immense. Les chasseurs des villages voisins avaient peur de lui, alors ils construisirent une clôture autour de la forêt. L’ours protesta, mais personne ne l’écouta. Les chasseurs ajoutèrent des pièges, puis des tours de guet, puis des chiens. « C’est pour notre protection », disaient-ils.
Un jour, l’ours décida qu’il ne pouvait plus attendre que la cage se referme. Il bondit sur la clôture, griffant et mordant. Les chasseurs furent choqués : « Tu vois ? On avait raison d’avoir peur ! »
Mais qui avait commencé ? L’ours qui finit par attaquer, ou les chasseurs qui avaient passé des années à l’encercler ?
La morale de cette histoire n’est pas que l’ours avait raison d’attaquer. C’est que parfois, à force de traiter quelqu’un comme un ennemi, on finit par en faire un.
Cette analyse fait partie d’une série cherchant à comprendre la perspective russe sans la justifier. Comprendre son adversaire n’est pas l’approuver – c’est la première étape pour éviter le prochain conflit.
Sources
Foreign Affairs – « Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault » by John Mearsheimer
National Security Archive – « NATO Expansion: What Gorbachev Heard »
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.