
2014 : le vol de la Crimée sous les yeux du monde
Pour mesurer l’épaisseur de l’hypocrisie russe, il faut remonter à 2014. L’Ukraine venait de vivre la révolution de Maïdan, une insurrection populaire massive qui avait chassé du pouvoir le président pro-russe Viktor Ianoukovitch. Les Ukrainiens voulaient l’Europe, la démocratie, la liberté. La réponse de Poutine fut immédiate et brutale. Des soldats sans insignes, les fameux « petits hommes verts », ont envahi la Crimée. Pas de déclaration de guerre. Pas d’ultimatum. Juste des hommes armés qui prennent le contrôle d’une péninsule souveraine comme on vole un portefeuille dans le métro. Puis un « référendum » organisé sous la menace des armes, que l’Ukraine et l’intégralité de la communauté internationale ont rejeté comme illégal. La Crimée fut annexée. Le monde a protesté. Des sanctions ont été imposées. Et puis la vie a continué. Le sang n’avait pas encore suffisamment coulé pour que l’Occident se réveille vraiment. Ce vol en plein jour, cette annexion d’un territoire souverain au mépris total du droit international, c’est le premier acte de l’agression russe contre l’Ukraine. Et aujourd’hui, en 2026, Poutine exige que ce vol soit reconnu comme légitime dans n’importe quel accord de paix. L’agresseur veut que sa victime signe un papier disant que le vol était justifié.
Simultanément, en 2014, la Russie a alimenté une guerre séparatiste dans le Donbass, dans les régions de Donetsk et Louhansk. Des armes russes, des soldats russes déguisés en « volontaires », des chars russes. Le vol MH17 de Malaysia Airlines, abattu par un missile Bouk russe le 17 juillet 2014, tuant 298 personnes innocentes dont 80 enfants, est la preuve sanglante de cette implication. La Russie a nié. Comme toujours. Elle nie les corps dans les rues de Boutcha, elle nie les bombes sur le théâtre de Marioupol, elle nie le missile sur le vol MH17. Nier est le verbe favori du Kremlin.
Quand un pays envahit son voisin une première fois et que le monde se contente de sanctions molles, faut-il s’étonner qu’il recommence huit ans plus tard avec dix fois plus de violence ? L’histoire de l’Ukraine depuis 2014 est l’histoire d’une complaisance occidentale dont nous payons tous le prix aujourd’hui.
24 février 2022 : le jour où le monde a basculé
Le 24 février 2022 restera gravé dans l’histoire comme le jour où Vladimir Poutine a décidé de faire basculer l’Europe dans son pire cauchemar depuis la Seconde Guerre mondiale. À cinq heures du matin, les premiers missiles ont frappé Kyïv, Kharkiv, Odessa, Marioupol. Des colonnes de blindés longues de soixante kilomètres se sont dirigées vers la capitale ukrainienne. L’objectif était clair : prendre Kyïv en trois jours, renverser le gouvernement de Volodymyr Zelensky, installer un régime fantoche. La Russie appelait ça une « opération militaire spéciale ». Les Ukrainiens appelaient ça ce que c’était : une invasion. Une guerre d’agression. Un crime contre l’humanité. Le bruit des explosions à cinq heures du matin, les vitres qui tremblent, les enfants qui hurlent dans les abris souterrains du métro de Kyïv, les familles qui fuient avec un sac plastique contenant toute leur vie. Quatorze millions de personnes ont été déplacées. 7,8 millions ont fui le pays, provoquant la plus grande crise de réfugiés du XXIe siècle. Et c’est ce pays, cette Russie-là, qui aujourd’hui se présente à Miami pour parler de paix.
Les chiffres sont des gouffres de souffrance humaine. Au mois de décembre 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme avait vérifié 14 775 morts civils, dont 755 enfants. Ce sont les chiffres vérifiés. Les chiffres réels sont probablement trois à cinq fois supérieurs. Derrière chaque chiffre, un visage. Liza, quatre ans, tuée dans sa poussette lors d’une frappe de missile sur Vinnytsia en juillet 2022. Sa mère, Iryna, a perdu ses deux jambes dans la même attaque. L’image de la poussette rose renversée sur l’asphalte ensanglanté a fait le tour du monde. Puis le monde a oublié. Comme il oublie toujours.
Boutcha : le visage nu de la barbarie russe

458 corps dans les rues d’une ville de banlieue
Si la Russie veut parler de paix, parlons d’abord de Boutcha. Cette ville de banlieue de 37 000 habitants, à quelques kilomètres de Kyïv, est devenue le symbole de la barbarie russe. Les forces russes ont occupé Boutcha pendant 33 jours, du 27 février au 31 mars 2022. Quand les soldats ukrainiens ont repris la ville le 29 mars, ils ont découvert l’horreur. Des corps jonchaient les rues. Des hommes avec les mains liées dans le dos, une balle dans la tête. Des femmes violées puis exécutées. Des fosses communes dans les jardins des maisons. 561 civils tués, dont 12 enfants. L’enquête des Nations Unies a documenté 73 exécutions sommaires confirmées : 54 hommes, 16 femmes, 2 garçons et 1 fille. Human Rights Watch a trouvé des preuves extensives d’exécutions sommaires, de disparitions forcées et de torture. Amnesty International a confirmé 22 cas distincts de meurtres par les forces russes dans la seule ville de Boutcha. Les troupes impliquées appartenaient au 234e régiment d’assaut aéroporté, les parachutistes de Pskov. Des images de vidéosurveillance les montrent en train de piller des bâtiments et de vandaliser des propriétés la veille des tueries. Ce ne sont pas des allégations vagues. Ce sont des preuves forensiques. Des images satellites. Des témoignages sous serment.
La réponse de la Russie ? Nier. Tout nier. Moscou a demandé une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ce qu’elle a appelé une « provocation odieuse de radicaux ukrainiens », affirmant que les images des corps étaient mises en scène. Les images satellites ont prouvé que les corps étaient là pendant l’occupation russe. Mais Moscou continue de nier. Et maintenant, Moscou veut parler de paix. Combien de Boutcha faudra-t-il pour que le monde comprenne que la Russie de Poutine ne connaît qu’un seul langage, celui de la destruction ? Comment peut-on s’asseoir à une table de négociation avec un régime qui nie les massacres que le monde entier a vus de ses propres yeux ?
Je pense souvent à cet homme de Boutcha, les mains liées, une balle dans la nuque, couché sur le trottoir devant sa propre maison. Son nom, je ne le connais pas. Personne ne le connaîtra jamais peut-être. Mais chaque fois que Dmitriev sourit devant les caméras à Miami, c’est sur le cadavre de cet homme qu’il marche.
Marioupol : le mot « enfants » écrit en lettres géantes n’a pas suffi
Et puis il y a Marioupol. Le 16 mars 2022, un peu après dix heures du matin, un avion de chasse russe a largué deux bombes de 500 kilogrammes sur le théâtre dramatique académique régional de Donetsk, en plein centre de Marioupol. Ce théâtre servait de refuge à des centaines de civils qui fuyaient les bombardements. C’était un point de distribution de médicaments, de nourriture et d’eau. Sur le parvis, de part et d’autre du bâtiment, les habitants avaient peint en lettres cyrilliques géantes le mot « ДЕТИ », « ENFANTS » en russe. Ces lettres étaient visibles depuis le ciel. Elles étaient visibles sur les images satellites. Les pilotes russes les ont vues. Ils ont bombardé quand même. Le conseil municipal de Marioupol a estimé qu’environ 300 personnes avaient été tuées. Une enquête de l’Associated Press a porté ce nombre à 600 morts. Six cents personnes. Dans un théâtre. Avec le mot « ENFANTS » peint au sol. Amnesty International a conclu que cette frappe était un crime de guerre. Le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains a estimé qu’il pouvait s’agir d’un crime contre l’humanité. Et la Russie ? La Russie a accusé le régiment Azov d’avoir fait sauter le théâtre lui-même. Les survivants, les preuves, les images : tout contredit cette version. Mais Moscou n’a pas besoin de vérité. Moscou a besoin de déni.
Et le comble de l’obscénité : en 2025, les autorités d’occupation russes ont organisé une cérémonie tape-à-l’œil pour célébrer la « réouverture » du théâtre de Marioupol. Le même théâtre qu’ils ont bombardé. Le même théâtre où 600 personnes sont mortes. Ils l’ont reconstruit partiellement, l’entrée, la salle, la scène, pour les caméras. Mais aucun spectacle n’y est programmé. C’est un décor de propagande. Un Potemkine de béton et de mensonge bâti sur des ossements.
16 000 enfants volés : le crime qui a mis Poutine sous mandat d'arrêt

La déportation systématique des enfants ukrainiens
Le 17 mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine. Pas contre un général. Pas contre un ministre. Contre le président de la Fédération de Russie en personne. Le chef de ce mandat : la déportation illégale et le transfert illégal d’enfants ukrainiens depuis les territoires occupés vers la Russie. C’est la première fois dans l’histoire qu’un mandat d’arrêt de la CPI vise le dirigeant d’un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maria Lvova-Belova, la commissaire aux droits de l’enfant du Kremlin, fait également l’objet d’un mandat. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur plus de 16 000 cas suspectés de déportation forcée de mineurs. La CPI a identifié « au moins des centaines d’enfants » arrachés à des orphelinats et des foyers de soins, dont beaucoup ont depuis été donnés en adoption à des familles russes. En mai 2022, Poutine a signé un décret simplifiant l’octroi de la citoyenneté russe aux orphelins ukrainiens. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères l’a dit clairement : Poutine a légalisé le kidnapping d’enfants.
Pensez-y une seconde. Seize mille enfants. Arrachés à leurs familles, à leur pays, à leur langue, à leur identité. Placés dans des familles russes. Soumis à la russification, à l’endoctrinement idéologique, à la militarisation. L’initiative « Bring Kids Back » rapporte que plus de 1,6 million d’enfants ukrainiens restent sous contrôle russe, dans les territoires occupés ou après déportation. Au 17 mars 2025, seuls 1 243 enfants avaient été rapatriés. Mille deux cent quarante-trois sur seize mille. Et cet homme, ce Poutine sous mandat d’arrêt international pour kidnapping d’enfants, cet homme envoie son émissaire à Miami pour parler de paix. Vous voulez rire ou vous voulez pleurer ? Moi, je veux hurler.
Il existe un mot pour ce que la Russie fait aux enfants ukrainiens. Ce mot, c’est génocide culturel. Vous prenez un enfant, vous lui enlevez sa langue, son histoire, ses parents, son drapeau, et vous le transformez en petit Russe. C’est un crime si profond, si intime, que même les tribunaux internationaux peinent à trouver les mots justes pour le qualifier.
L’isolement diplomatique d’un criminel de guerre
Les 125 États membres de la CPI ont l’obligation légale d’arrêter Poutine s’il met le pied sur leur territoire. C’est pourquoi Poutine n’a pas assisté au sommet du G20 au Brésil. C’est pourquoi il ne voyage pratiquement plus qu’en Russie, en Chine, en Corée du Nord ou dans quelques États complices. Le 24 juin 2024, la CPI a émis deux mandats supplémentaires contre Sergueï Choïgou, ancien ministre de la Défense, et Valeri Guerassimov, chef de l’état-major, pour des crimes internationaux commis entre octobre 2022 et mars 2023. En tout, six responsables russes sont sous le coup de mandats d’arrêt de la CPI. Et ce régime, cette clique de criminels de guerre recherchés, veut nous faire croire qu’il « cherche la paix ». L’Assemblée générale des Nations Unies a suspendu la Russie du Conseil des droits de l’homme en raison des crimes de guerre commis en Ukraine. En 2016, la Russie avait déjà retiré sa signature du Statut de Rome de la CPI quand la Cour avait commencé à enquêter sur l’annexion de la Crimée. Fuir la justice n’est pas le comportement d’un pays qui cherche la paix. C’est le comportement d’un accusé qui sait qu’il est coupable.
Le 25 octobre 2024, l’Ukraine a ratifié le Statut de Rome, entré en vigueur le 1er janvier 2025. La victime embrasse la justice internationale. L’agresseur la fuit. Si vous cherchez un résumé de toute cette guerre en une seule phrase, c’est celui-là.
L'arithmétique obscène des "conditions de paix" russes

Ce que Moscou exige pour arrêter de tuer
Regardons froidement ce que la Russie appelle des « conditions de paix ». Premièrement : l’Ukraine doit reconnaître la Crimée comme territoire russe. Deuxièmement : l’Ukraine doit céder les quatre régions annexées illégalement par la Russie en 2022, soit Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Troisièmement : l’Ukraine doit renoncer à toute adhésion à l’OTAN. Quatrièmement : l’Ukraine doit maintenir un statut non nucléaire. Cinquièmement : l’Ukraine doit réduire drastiquement ses forces armées. Sixièmement : l’Ukraine doit garantir les droits de la population russophone. En résumé, la Russie demande à l’Ukraine de renoncer à environ 20 % de son territoire, de se désarmer, de renoncer à toute alliance défensive, et de se mettre à genoux en remerciant son bourreau. C’est ce que Moscou appelle la « paix ». Appelez-moi vieux jeu, mais dans mon dictionnaire, ça s’appelle une capitulation imposée par la force. Ça s’appelle un diktat. Ça s’appelle ce que les nazis ont fait à la France en 1940 avec l’armistice de Rethondes.
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio l’a admis lui-même : sur les questions territoriales, « c’est un pont que nous n’avons pas encore traversé », ajoutant qu’« il y a un travail actif pour voir si les positions des deux côtés peuvent être réconciliées ». Réconciliées. Comment réconcilier la position d’un pays qui veut récupérer son territoire volé et celle d’un pays qui refuse de rendre ce qu’il a volé ? Comment « réconcilier » le droit international avec sa violation flagrante ? C’est comme demander à un juge de « réconcilier » les positions d’un cambrioleur et de sa victime en suggérant que le voleur garde la moitié du butin. Le président Zelensky, après des discussions avec Trump fin décembre 2025, a déclaré que 90 % d’un accord potentiel avaient été convenus. Mais les 10 % restants, le territoire, c’est tout. C’est la souveraineté d’une nation. Ce n’est pas un détail technique. C’est le cœur de tout.
Les « conditions de paix » russes ne sont pas des conditions de paix. Ce sont les termes d’une reddition. Et le plus terrifiant, c’est qu’une partie du monde semble prête à les accepter, parce que la fatigue de la guerre est plus forte que le sens de la justice.
Abu Dhabi, la prochaine étape de la mascarade
Les négociations se poursuivent. Après Miami, c’est Abu Dhabi qui accueillera les prochains pourparlers trilatéraux. Les 23 et 24 janvier 2026, un premier format trilatéral incluant la Russie, l’Ukraine et les États-Unis a eu lieu, décrit par toutes les parties comme « très constructif ». Ce mot encore. Constructif. On construit quoi exactement ? Un accord qui récompense l’agression ? Un précédent qui dit au monde entier que si vous êtes assez puissant et assez brutal, vous pouvez envahir votre voisin, tuer ses enfants, voler son territoire, et repartir avec un accord « constructif » ? Quel message envoie-t-on à la Chine qui observe Taïwan ? Quel message envoie-t-on à tous les dictateurs en herbe qui rêvent de redessiner les frontières à coups de missile ? Le message est simple et dévastateur : la force prime le droit. Et si tel est le cas, alors tout le système international construit depuis 1945 s’effondre.
Le Kremlin avait d’abord nié que des pourparlers trilatéraux fussent même envisagés. Ouchakov avait déclaré que « personne n’a sérieusement discuté de cette initiative ». Puis la Russie s’est retrouvée à la table. Parce que Moscou ment. Constamment. Systématiquement. Sur tout. Sur les négociations, sur les massacres, sur les objectifs de guerre, sur les pertes, sur les déportations d’enfants. Le mensonge est la politique étrangère de la Russie. Et nous continuons de nous asseoir en face d’eux comme si leurs mots avaient une valeur quelconque.
Le bureau du procureur ukrainien : 39 347 crimes de guerre documentés
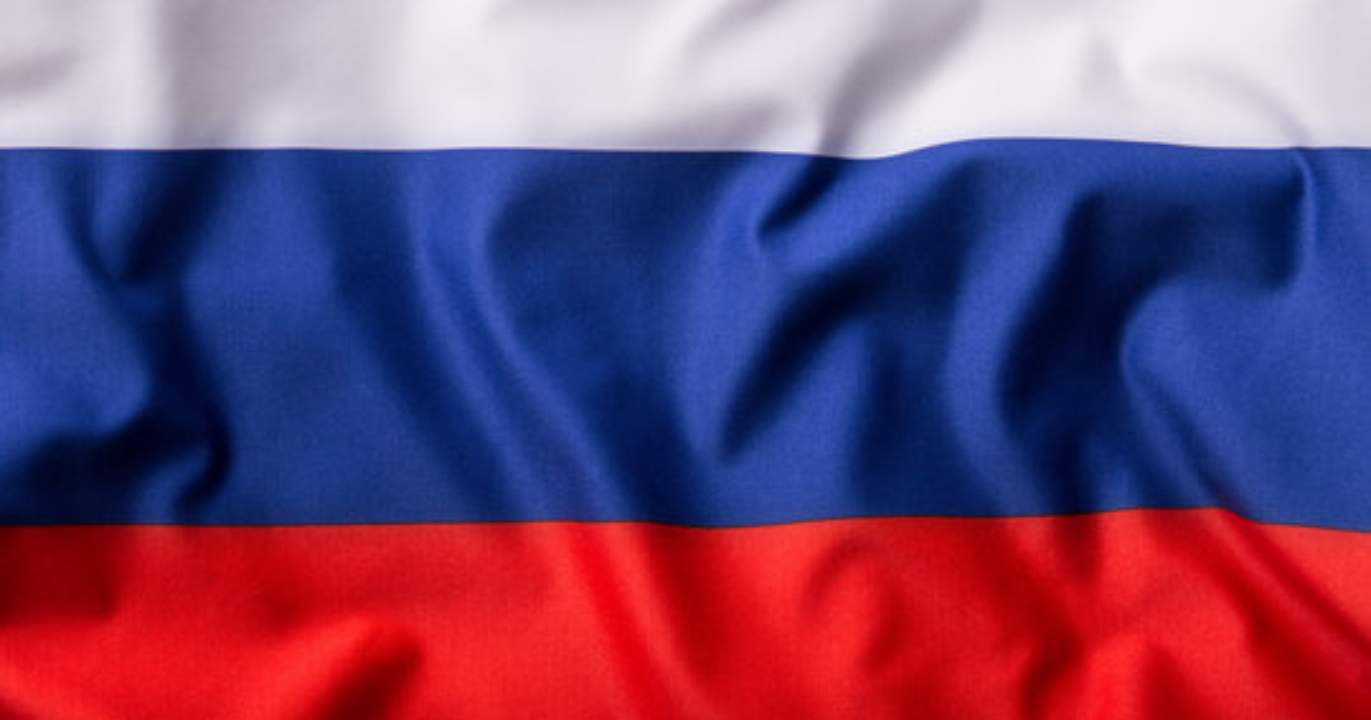
Une montagne de preuves que le monde choisit d’ignorer
Les chiffres sont accablants et ils grandissent chaque jour. Dès octobre 2022, le bureau du procureur ukrainien avait documenté 39 347 crimes de guerre présumés commis par les forces russes. Plus de 600 suspects avaient été identifiés. Des procédures avaient été engagées contre environ 80 d’entre eux. Depuis, ces chiffres ont explosé. Chaque ville libérée révèle de nouvelles horreurs. Chaque sous-sol, chaque fosse commune, chaque salle de torture improvisée dans un commissariat ou un garage raconte la même histoire : celle d’une armée qui ne fait pas la guerre à un État, mais à un peuple. Amnesty International l’a dit clairement : il ne peut y avoir de justice pour les Ukrainiens sans une pleine responsabilité pour tous les crimes commis par la Russie depuis son intervention militaire de 2014. Il n’y a pas de prescription pour les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité. Le processus de responsabilisation prendra des années, peut-être des décennies. Mais il aura lieu. Et quand il aura lieu, les images de Dmitriev souriant à Miami seront versées au dossier comme preuve de l’impudence absolue d’un régime criminel.
Pensez à Izioum, où 447 corps ont été exhumés d’une fosse commune après la libération de la ville en septembre 2022. Des corps portant des traces de torture : des cordes autour des poignets, des ongles arrachés, des os brisés. Pensez à Irpin, ville sœur de Boutcha, où des civils ont été abattus en essayant de fuir par un corridor humanitaire. Pensez aux frappes quotidiennes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes chaque hiver, plongeant des millions de personnes dans le froid et l’obscurité. La Russie ne fait pas la guerre à l’armée ukrainienne. La Russie fait la guerre à chaque grand-mère qui allume un radiateur à Kharkiv, à chaque bébé qui a besoin d’un incubateur à Kherson, à chaque écolier qui essaie de suivre ses cours en ligne pendant les coupures de courant. C’est ça, la « paix » version Kremlin.
Trente-neuf mille trois cent quarante-sept crimes documentés. Et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Chaque numéro dans cette statistique est une scène que personne ne devrait jamais avoir à vivre, à voir, à raconter. Mais la Russie, elle, veut qu’on passe à autre chose. Qu’on « construise la paix ». Sur des charniers.
Les preuves que même le déni ne peut effacer
La technologie moderne a rendu le déni russe plus difficile que jamais, sans le rendre impossible dans l’esprit du Kremlin. Les images satellites de Maxar Technologies ont prouvé que les corps dans les rues de Boutcha étaient présents pendant l’occupation russe, démolissant la thèse de la « mise en scène ». Les enquêtes open source de Bellingcat et d’autres organisations ont retracé les trajectoires des missiles, identifié les unités militaires responsables, documenté les mouvements de troupes. Les témoignages de survivants, recueillis par des dizaines d’organisations internationales, forment un corpus de preuves d’une solidité accablante. Les enregistrements téléphoniques interceptés de soldats russes racontant à leurs proches les atrocités commises sont peut-être le détail le plus glaçant de tous. Ces hommes ne parlaient pas avec la voix de soldats traumatisés. Certains riaient. Certains se vantaient. L’un d’eux a dit à sa compagne qu’il lui rapporterait les bijoux volés sur les cadavres. Un autre a décrit comment son unité avait torturé des prisonniers « pour s’amuser ». Ce sont les soldats de l’armée qui veut « œuvrer pour la paix ».
Les drones ukrainiens, les caméras de surveillance, les téléphones portables des civils : tout a été capturé, stocké, archivé. Le procureur de la CPI Karim Khan a qualifié l’Ukraine de « scène de crime » à ciel ouvert. Une scène de crime de la taille d’un pays. Et le suspect principal se balade en limousine à Miami.
Le mot "paix" dans la bouche de Moscou : un exercice de novlangue orwellienne

Quand les mots perdent leur sens
George Orwell l’avait prédit dans 1984 : « La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force. » La Russie de Poutine a transformé cette dystopie en politique étrangère. Quand Moscou dit « paix », il faut entendre « soumission ». Quand Moscou dit « négociation », il faut entendre « acceptez nos conditions ou nous continuons à vous bombarder ». Quand Moscou dit « opération militaire spéciale », il faut entendre « guerre d’agression totale ». Quand Moscou dit « protection des populations russophones », il faut entendre « prétexte pour l’invasion ». Quand Moscou dit « dénazification », il faut entendre « destruction d’un État souverain ». La Russie ne parle pas la même langue que le reste du monde. Elle utilise les mêmes mots, mais ils signifient exactement le contraire. C’est une forme de violence linguistique qui précède et accompagne la violence physique. On détruit le sens des mots avant de détruire les villes. On assassine la vérité avant d’assassiner les gens.
Et le monde joue le jeu. Les communiqués diplomatiques parlent de « discussions constructives » avec la Russie. Les journalistes reprennent les « déclarations » du Kremlin sans guillemets critiques. Les analystes débattent des « positions » de chaque « partie » comme si c’était un match de tennis où les deux joueurs ont des arguments équivalents. Mais ce n’est pas un match de tennis. C’est un crime. Il y a un agresseur et une victime. Il y a un pays qui a envahi un autre et un pays qui se défend. Les présenter comme des « parties » équivalentes dans une « négociation » est déjà une victoire pour la propagande russe. Chaque fois qu’un titre de journal dit « La Russie et l’Ukraine négocient », il normalise l’idée que l’agresseur et la victime sont sur un pied d’égalité. Ils ne le sont pas. Ils ne le seront jamais.
Nous vivons dans un monde où un pays peut envahir son voisin, massacrer ses citoyens, voler ses enfants, détruire ses villes, puis demander la « paix » — et être invité à s’asseoir à une table de négociation avec du café et des croissants. Si ce n’est pas la définition de la folie collective, je ne sais pas ce que c’est.
Le précédent catastrophique
Ce qui se joue à Miami et bientôt à Abu Dhabi dépasse largement l’Ukraine. C’est l’architecture du monde de demain qui se dessine. Si la Russie obtient ce qu’elle veut, si elle conserve les territoires conquis par la force, si l’agresseur est récompensé, alors nous entrons dans une ère où la loi de la jungle remplace le droit international. La Chine observe. L’Iran observe. La Corée du Nord observe. Chaque dictateur de la planète observe Miami avec une attention fiévreuse. Si Poutine s’en sort, tout est permis. Taïwan est menacé. Les pays baltes sont menacés. La Moldavie est menacée. La Géorgie, déjà partiellement occupée depuis 2008, est menacée. Le message serait dévastateur : envahissez, tuez, détruisez, puis asseyez-vous à la table et gardez ce que vous avez pris. Le monde ne vous arrêtera pas. Il vous proposera du café.
Les accords de Munich de 1938, quand Chamberlain et Daladier ont cédé les Sudètes à Hitler en échange d’une « paix pour notre temps », restent la référence historique incontournable. Churchill avait prévenu : « Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. » Sommes-nous en train de revivre Munich à Miami ? L’histoire ne se répète pas exactement, mais elle bégaie. Et là, elle bégaie très fort.
Les morts ne négocient pas : l'obscénité du "dialogue"
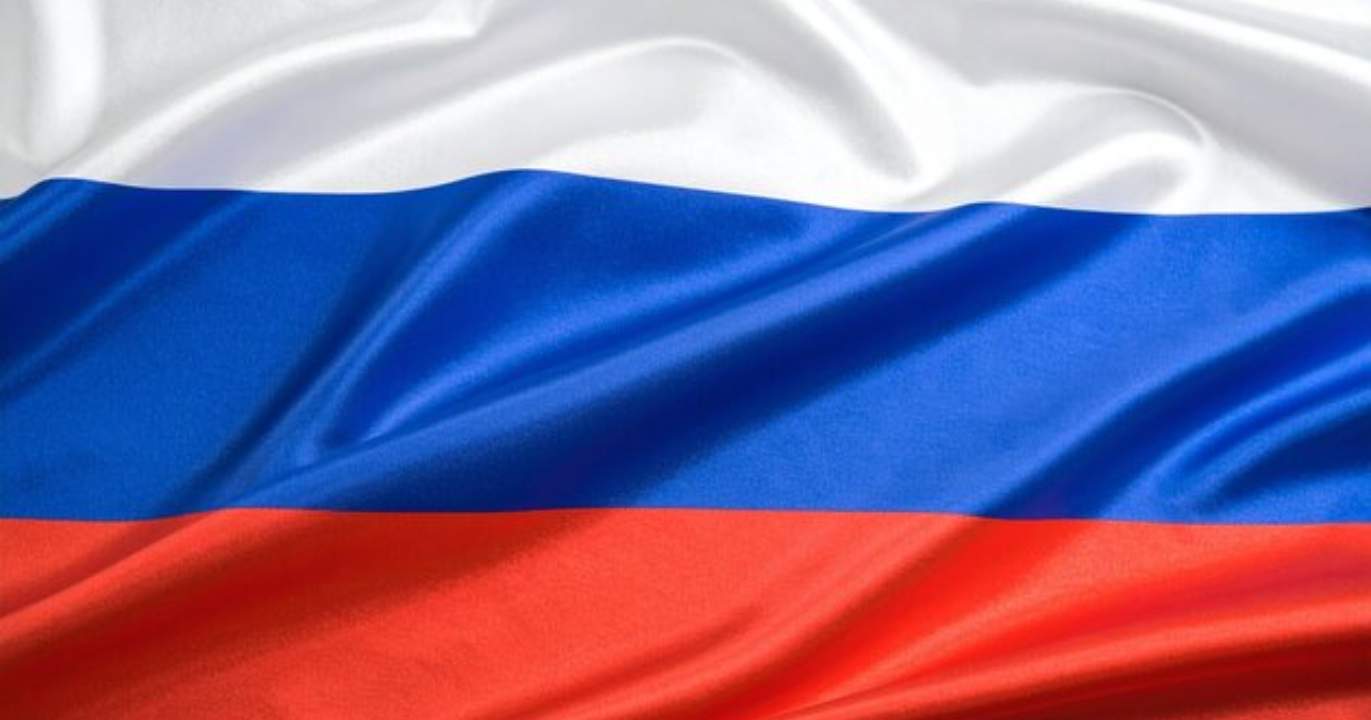
Parler avec un meurtrier comme s’il était un voisin
Il y a quelque chose de profondément obscène dans l’idée même de « négocier » avec la Russie dans les conditions actuelles. Imaginez une scène de crime. Un homme a tué votre famille, brûlé votre maison, kidnappé vos enfants. Et on vous dit : « Asseyez-vous avec lui. Discutez. Trouvez un compromis. » C’est exactement ce qu’on demande à l’Ukraine. Le compromis signifierait accepter que des milliers de kilomètres carrés de territoire ukrainien restent sous occupation russe. Que des millions de citoyens ukrainiens vivent sous un régime qui les opprime. Que les enfants déportés ne reviennent peut-être jamais. Que les crimes de guerre restent impunis. Que la Crimée soit définitivement perdue. On appelle ça un « compromis ». Moi, j’appelle ça une trahison. Une trahison de l’Ukraine. Une trahison du droit international. Une trahison de tous ceux qui sont morts en défendant leur pays, leur maison, leur liberté.
Pensez à Olena, 34 ans, infirmière à Marioupol, qui a passé deux mois dans les sous-sols de l’usine Azovstal avec son fils de six ans, buvant de l’eau de pluie recueillie dans des seaux, mangeant du pain moisi, écoutant les bombes tomber au-dessus de sa tête vingt heures par jour. Pensez à Dmytro, 72 ans, ancien professeur d’histoire à Kherson, qui a été arrêté par les forces d’occupation parce qu’il portait un ruban jaune et bleu sous son manteau, enfermé dans un sous-sol pendant trois semaines, battu chaque jour avec un tuyau en caoutchouc. Pensez à Nastia, neuf ans, déportée en Russie depuis un orphelinat de Donetsk, dont la mère, une soldats des forces armées, n’a plus aucune nouvelle depuis deux ans. Ce sont ces gens que la « paix » négociée à Miami est censée aider. Mais les aide-t-on en récompensant leur bourreau ?
Les morts de Boutcha n’ont pas de siège à la table de Miami. Les enfants déportés n’ont pas de microphone à Abu Dhabi. Les femmes violées d’Izioum n’ont pas de porte-parole dans ces « négociations constructives ». La paix qui s’écrit sans la voix des victimes n’est pas la paix. C’est l’arrangement des puissants sur le dos des faibles.
La mémoire comme arme de résistance
Ce que le Kremlin espère par-dessus tout, c’est que le monde oublie. Que le flux d’information noie les images de Boutcha sous des millions de notifications. Que la lassitude remplace l’indignation. Que le pragmatisme l’emporte sur la morale. Et c’est exactement ce qui est en train de se passer. L’aide occidentale s’essouffle. Les débats budgétaires remplacent les élans de solidarité. Les populistes, de Washington à Budapest, parlent de « mettre fin à la guerre » comme si c’était une facture qu’on pouvait simplement classer. Mais on ne « met pas fin » à un crime. On le punit. Ou on le récompense. Il n’y a pas de troisième option. Chaque dollar d’aide militaire non envoyé à l’Ukraine est un cadeau à Poutine. Chaque silence diplomatique est un encouragement au Kremlin. Chaque fois qu’un dirigeant occidental dit « il faut trouver une sortie diplomatique » sans ajouter « qui respecte la souveraineté ukrainienne », il fait le jeu de l’agresseur.
La mémoire est la seule arme que le Kremlin ne peut pas détruire. Se souvenir de Boutcha. Se souvenir de Marioupol. Se souvenir des enfants déportés. Se souvenir que ce pays qui parle de « paix » à Miami est le même qui a bombardé un théâtre où le mot « ENFANTS » était peint en lettres géantes. Se souvenir, c’est résister. Oublier, c’est complice.
Le syndrome de Stockholm géopolitique

Quand la victime doit remercier son bourreau
Il existe un phénomène psychologique bien documenté : le syndrome de Stockholm, où la victime finit par s’identifier à son agresseur. Ce qui se passe dans les négociations actuelles ressemble à une version géopolitique de ce syndrome. La communauté internationale pousse lentement mais sûrement l’Ukraine à accepter des « compromis » qui reviennent à récompenser son agresseur. On dit à l’Ukraine : « Soyez réalistes ». « Acceptez ce que vous pouvez obtenir ». « La paix vaut des sacrifices ». Mais personne ne dit à la Russie : « Retirez-vous de chaque centimètre carré de territoire ukrainien ». Personne ne dit : « Rendez les enfants ». Personne ne dit : « Payez des réparations pour chaque maison détruite, chaque vie volée, chaque famille brisée ». Non. C’est à la victime qu’on demande des concessions. C’est l’Ukraine qui doit « faire des compromis ». Le monde est malade. Et la maladie s’appelle lâcheté.
Le président Zelensky a déclaré après ses entretiens avec Trump à Davos que les termes des garanties de sécurité avaient été finalisés et qu’un accord était presque prêt sur la reconstruction économique après la guerre. Le 6 janvier 2026, les pays de la « Coalition des volontaires » se sont réunis, avec une délégation américaine, pour consolider un système de garanties politiques et juridiquement contraignantes qui seraient activées dès l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu. Des garanties. Comme si les garanties avaient une valeur quand l’une des parties signataires est la Russie. Le mémorandum de Budapest de 1994, par lequel la Russie garantissait l’intégrité territoriale de l’Ukraine en échange du désarmement nucléaire de cette dernière, vaut aujourd’hui le papier sur lequel il est écrit. C’est-à-dire rien. La Russie a signé ce mémorandum. La Russie l’a violé. Pourquoi une nouvelle « garantie » russe vaudrait-elle davantage ?
On demande à l’Ukraine de faire confiance au pays qui l’a envahie deux fois, qui a violé chaque accord signé, qui a massacré ses citoyens et volé ses enfants. Si ce n’est pas du syndrome de Stockholm géopolitique, qu’est-ce que c’est ?
Les leçons que personne ne veut entendre
L’histoire regorge d’exemples de paix qui n’étaient que des pauses entre deux guerres. Le traité de Versailles n’a pas empêché la Seconde Guerre mondiale, il l’a rendue inévitable. Les accords de Munich n’ont pas arrêté Hitler, ils l’ont encouragé. Les accords de Minsk de 2014 et 2015, censés résoudre le conflit dans le Donbass, n’ont été qu’une pause permettant à la Russie de se réarmer pour l’invasion de 2022. L’ancienne chancelière Angela Merkel l’a elle-même admis : les accords de Minsk avaient pour but de donner du temps à l’Ukraine pour se préparer. Mais ils ont aussi donné du temps à la Russie. Et la Russie l’a mieux utilisé. Si un accord est signé demain qui laisse à la Russie les territoires conquis, sans mécanisme d’application crédible, sans conséquences réelles en cas de violation, alors ce ne sera pas la paix. Ce sera un armistice. Une pause. Le temps que la Russie se réarme, reconstitue ses forces, et recommence. Dans cinq ans. Dans dix ans. Mais elle recommencera. Parce que c’est ce que font les empires quand on ne les arrête pas.
Vous voulez la paix ? La vraie paix ? Il n’y a qu’un seul chemin : la défaite de l’agression russe. Pas un « compromis ». Pas un « accord ». Une défaite. Le retrait complet des forces russes du territoire ukrainien. La restitution des enfants déportés. Des réparations pour les destructions. La responsabilisation des criminels de guerre. Tout le reste n’est que du maquillage sur une plaie ouverte.
Le silence complice de ceux qui regardent ailleurs
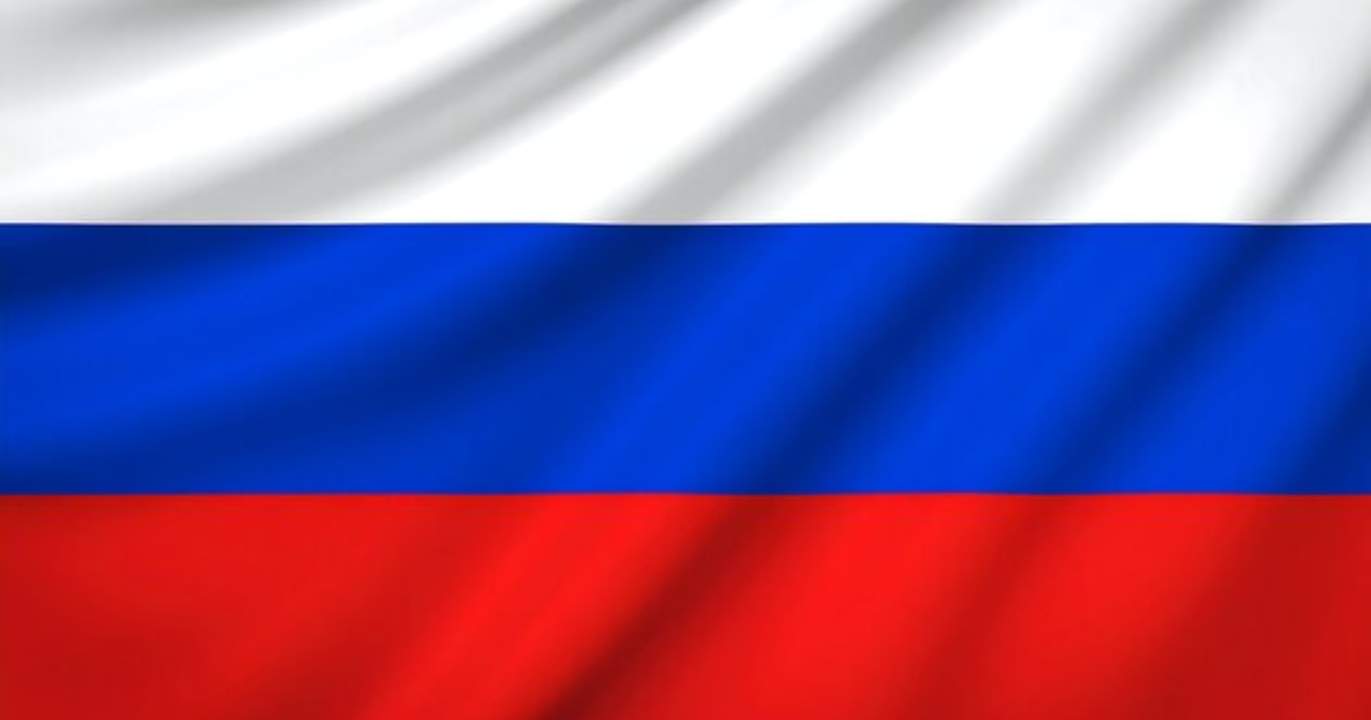
L’Occident fatigué, le Kremlin jubilant
La plus grande victoire de Poutine n’est pas sur le champ de bataille. C’est la fatigue de l’Occident. Quatre ans de guerre, quatre ans de reportages, quatre ans de chiffres et d’horreurs, et l’opinion publique occidentale commence à décrocher. Les sondages montrent un soutien en baisse pour l’aide à l’Ukraine dans plusieurs pays européens et aux États-Unis. La crise du coût de la vie, l’inflation, les problèmes intérieurs prennent le dessus. C’est humain. C’est compréhensible. Et c’est exactement ce que Poutine attendait. Sa stratégie n’a jamais été de gagner la guerre militairement. Sa stratégie a toujours été de durer. D’attendre que l’Occident se lasse. D’attendre que les démocraties, avec leurs cycles électoraux et leurs changements de gouvernement, perdent leur détermination. Et ça marche. L’arrivée de Trump à la Maison-Blanche, avec son approche transactionnelle de la politique étrangère, est un cadeau pour le Kremlin. Un président américain qui veut un « deal » rapide, qui mesure le succès en accords signés plutôt qu’en principes défendus, c’est le partenaire idéal pour une Russie qui veut légitimer ses conquêtes.
Et pendant ce temps, en Ukraine, les alarmes continuent de retentir. Les missiles continuent de tomber. Les soldats continuent de mourir dans les tranchées du Donbass, dans un paysage lunaire de boue, de cratères et de barbelés qui rappelle la Somme en 1916. L’odeur de cordite et de terre retournée. Le bruit sourd des explosions qui fait trembler les murs à des kilomètres. Le silence glacial qui suit, rompu seulement par les cris des blessés. C’est la réalité de la guerre que la Russie a lancée. Et c’est cette même Russie qui parle de paix dans les salons dorés de Floride.
La fatigue de l’Occident est l’oxygène du Kremlin. Chaque fois que nous détournons le regard, Poutine gagne un mètre de terrain. Pas en Ukraine. Dans nos consciences.
Le rôle ambigu de Washington
Le rôle des États-Unis dans ces négociations mérite un examen sans complaisance. Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré Poutine au Kremlin le 2 décembre 2025 pendant cinq heures. Cinq heures avec un homme sous mandat d’arrêt international. Cinq heures avec un homme accusé de kidnapping d’enfants par la CPI. Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI, certes. Mais quel message envoie-t-on quand la première puissance mondiale traite un criminel de guerre recherché comme un partenaire de négociation respectable ? Le plan de paix initial américain, décrit comme « fortement incliné en faveur de la Russie » par l’Ukraine et ses alliés, a été révisé de 28 à 19 points. Mais même dans sa version révisée, il semble accorder à la Russie bien plus que ce que le droit international ne permet. Le rôle de Washington n’est plus celui de défenseur de l’ordre international. C’est celui de courtier en immobilier géopolitique qui cherche à conclure une transaction, peu importe si le vendeur a volé la maison qu’il vend.
La question qui hante chaque Ukrainien ce soir est simple : sommes-nous en train d’être vendus ? Sommes-nous le prix que l’Amérique est prête à payer pour un accord avec Moscou ? Après Budapest 1994, où l’Ukraine a abandonné ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité qui se sont révélées creuses, les Ukrainiens ont toutes les raisons d’être méfiants. Ils ont fait confiance. Ils ont été trahis. On leur demande de faire confiance encore.
Le théâtre de l'absurde diplomatique
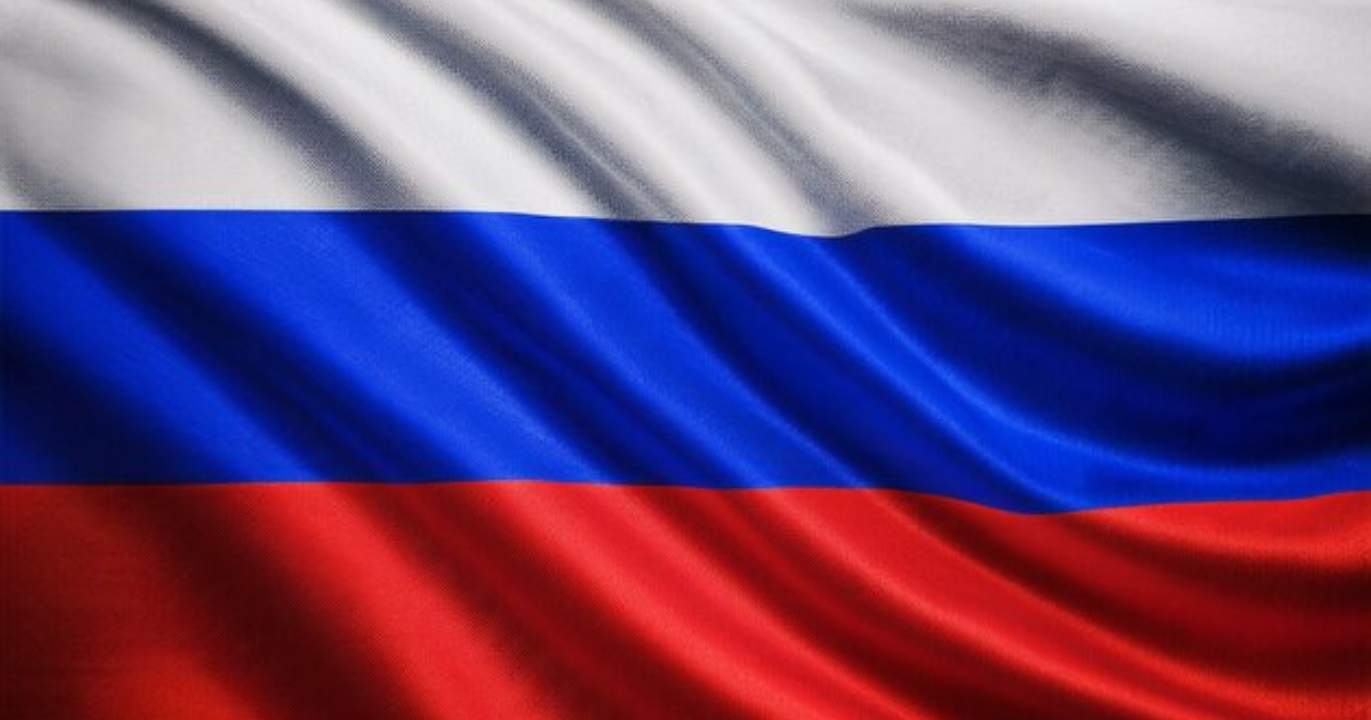
L’agresseur qui fixe les règles du jeu
Le comble de l’absurdité est atteint quand c’est l’agresseur qui fixe les conditions du cessez-le-feu. La Russie ne demande pas la paix. La Russie dicte les termes d’une reddition qu’elle maquille en accord diplomatique. Et la communauté internationale, au lieu de rejeter ces conditions avec le dégoût qu’elles méritent, les « examine », les « discute », les « négocie ». On négocie avec un voleur le prix de ce qu’il vous a pris. On discute avec un meurtrier les conditions de son impunité. C’est un théâtre de l’absurde dont Ionesco lui-même n’aurait pas osé écrire le scénario. Peskov déclare que les propositions ukrainiennes sont « non constructives ». L’Ukraine propose quoi exactement ? Que la Russie respecte ses frontières internationalement reconnues. Que la Russie rende les enfants volés. Que la Russie cesse de bombarder des civils. Ce sont des demandes « non constructives » pour Moscou. Que quelqu’un m’explique dans quel univers parallèle demander à un pays de cesser de commettre des crimes de guerre est considéré comme « non constructif ».
La Russie a durci sa position au fil des négociations, pas adouci. Plus elle négocie, plus elle exige. Plus le monde montre de la flexibilité, plus Moscou pousse ses pions. C’est la logique implacable de tout prédateur face à une proie qui recule. Chaque concession n’apaise pas la Russie. Chaque concession lui prouve que la pression fonctionne. Que le chantage nucléaire fonctionne. Que la menace fonctionne. Que la brutalité, en fin de compte, paie.
On ne négocie pas avec un incendiaire les conditions sous lesquelles il acceptera d’arrêter de mettre le feu. On éteint l’incendie. Et on arrête l’incendiaire. Tout le reste est de la complicité déguisée en diplomatie.
Le piège de la « neutralité » médiatique
Les médias portent une responsabilité immense dans la normalisation de cette absurdité. Quand un titre annonce « La Russie cherche à œuvrer pour la paix en Ukraine », sans contexte, sans rappel des invasions, des massacres, des déportations, il participe à la réécriture de l’histoire en temps réel. Le journalisme qui traite l’agresseur et la victime avec la même « neutralité » n’est pas neutre. Il est complice. Dire « les deux parties » quand il y a un envahisseur et un envahi n’est pas de l’objectivité. C’est de l’obscurantisme moral. La « neutralité » face à l’injustice n’est pas une vertu. C’est une lâcheté. Desmond Tutu l’a dit mieux que quiconque : « Si vous êtes neutres dans des situations d’injustice, vous avez choisi le côté de l’oppresseur. » Chaque article, chaque reportage, chaque tweet qui présente les « négociations » comme un processus normal entre partenaires égaux participe à l’effacement des crimes russes. Et l’effacement est le premier pas vers l’impunité.
La journaliste russe Maria Ponomarenko a été condamnée à six ans de prison pour avoir publié des informations sur la frappe sur le théâtre de Marioupol. Six ans pour avoir dit la vérité. En Russie, la vérité est un crime. Et c’est ce pays qui veut « œuvrer pour la paix ».
Le verdict de l'histoire est déjà écrit
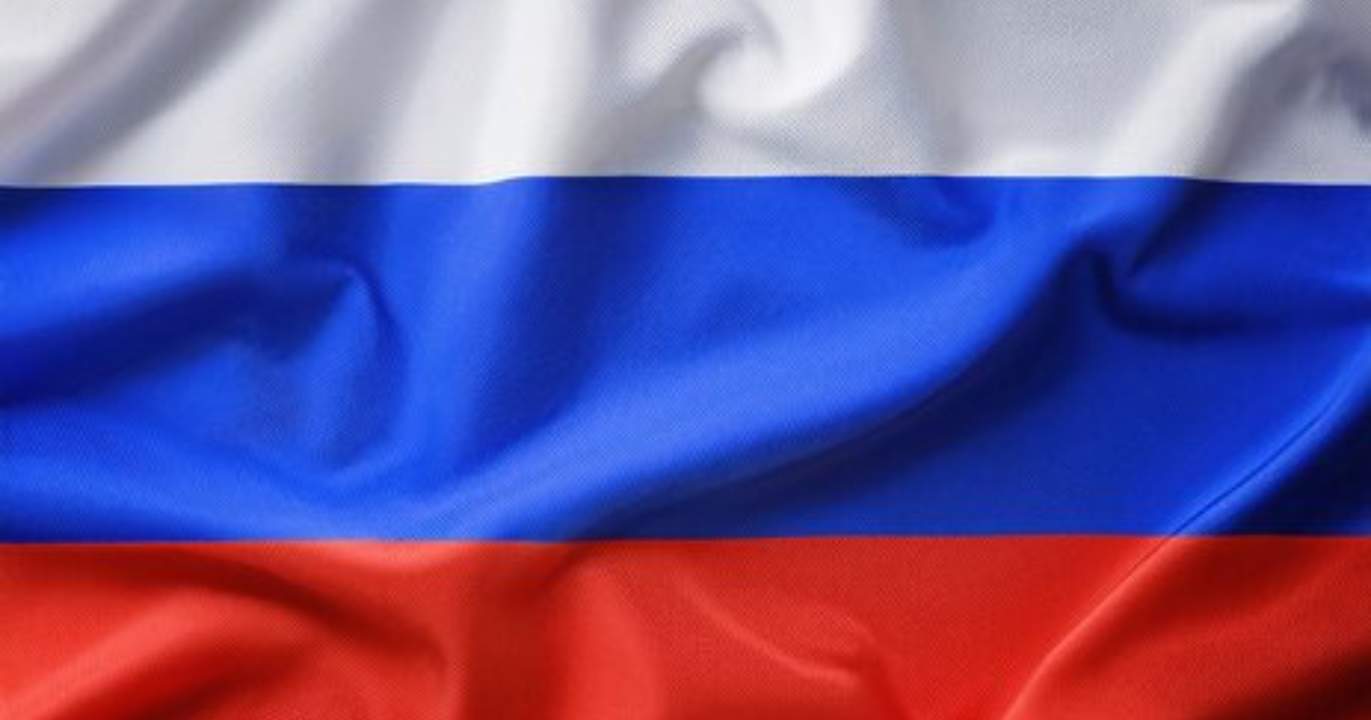
Ce que diront les livres dans cinquante ans
Dans cinquante ans, les historiens regarderont cette période avec un mélange de stupéfaction et d’horreur. Ils raconteront comment un pays a envahi son voisin au XXIe siècle, commis des atrocités documentées par des satellites et des drones, déporté des milliers d’enfants, et comment ce même pays a été invité à négocier la paix comme s’il était un partenaire respectable. Ils raconteront comment Kirill Dmitriev arrivait à Miami en jet privé, postait des selfies sur Instagram, et repartait après des « discussions constructives ». Ils raconteront comment le monde a hésité, tergiversé, « négocié », pendant que les bombes continuaient de tomber sur Kharkiv, Odessa, Zaporijjia. Ils se demanderont : comment avons-nous pu ? Comment avons-nous pu laisser faire ? Comment avons-nous pu traiter un régime criminel comme un interlocuteur légitime ? Et ils n’auront pas de réponse satisfaisante. Parce qu’il n’y en a pas.
Le verdict de l’histoire est toujours le même pour ceux qui agressent et ceux qui regardent faire. L’agresseur est condamné. Le complice silencieux est méprisé. Seuls ceux qui ont résisté sont honorés. L’Ukraine résiste. L’Ukraine sera honorée. Mais nous, les spectateurs, les « négociateurs », les « pragmatiques », que diront-ils de nous ? Que nous avons choisi le confort contre la justice. La facilité contre le courage. Le « deal » contre le droit. Et ce verdict, quand il tombera, sera sans appel.
L’histoire ne pardonne pas aux lâches. Elle ne pardonne pas à ceux qui savaient et qui n’ont rien fait. Elle ne pardonne pas à ceux qui ont serré la main du bourreau en appelant ça de la « diplomatie ». Et l’histoire, contrairement aux diplomates de Miami, ne négocie pas.
Le dernier mot aux Ukrainiens
Le dernier mot ne devrait pas appartenir à Dmitriev, ni à Witkoff, ni à Kushner, ni à aucun des hommes en costume qui sirotent de l’eau gazeuse dans les hôtels climatisés de Floride. Le dernier mot devrait appartenir à cette femme de Boutcha qui a retrouvé son mari dans une fosse commune, les mains liées, une balle dans la tête. Le dernier mot devrait appartenir à cette mère de Marioupol qui n’a jamais retrouvé le corps de son enfant sous les décombres du théâtre. Le dernier mot devrait appartenir à ce père dont l’enfant de sept ans a été déporté en Sibérie et qui ne sait même pas si son fils est encore vivant. Le dernier mot devrait appartenir aux 14 775 civils tués, aux 755 enfants morts, aux 14 millions de déplacés, aux 7,8 millions de réfugiés. Leur voix collective forme un rugissement que toutes les « négociations constructives » du monde ne pourront jamais couvrir.
La Russie ne cherche pas la paix. La Russie cherche la victoire sous un autre nom.
Signé Maxime Marquette
Encadré de transparence du chroniqueur

Cet article est une chronique d’opinion. Il reflète le point de vue personnel de son auteur, Maxime Marquette, et non une position éditoriale institutionnelle. Les faits rapportés s’appuient sur des sources vérifiables citées en fin d’article. L’analyse, les interprétations et le ton engagé relèvent de la liberté d’expression du chroniqueur. Le lecteur est invité à consulter les sources primaires pour se forger sa propre opinion.
Sources primaires
Al Jazeera — US says talks with Russia, Ukraine in Miami constructive, productive
Cour pénale internationale — Mandats d’arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova
Human Rights Watch — Ukraine: Russian Forces Trail of Death in Bucha
Amnesty International — Deadly Mariupol theatre strike a clear war crime
Sources secondaires
OSW Centre for Eastern Studies — No breakthrough: Russia-US and Ukraine-US talks in Miami
The Moscow Times — Miami Talks on Ukraine War End With No Sign of Diplomatic Breakthrough
OHCHR — UN report details summary executions of civilians by Russian troops in northern Ukraine
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.