
Imaginez recevoir votre lettre de licenciement pendant que des sirènes d’alerte aérienne hurlent au-dessus de votre tête et que vous manquez d’électricité pour recharger votre téléphone.
Lizzie Johnson n’est pas n’importe quelle journaliste. Son parcours professionnel témoigne d’un engagement exceptionnel envers le journalisme de terrain et le récit des catastrophes humaines. Avant de couvrir la guerre en Ukraine pour le Washington Post, elle s’était distinguée pendant six années au San Francisco Chronicle par sa couverture remarquable des incendies dévastateurs en Californie, récoltant une reconnaissance unanime pour son travail rigoureux et profondément humain. Elle a couvert quinze des incendies les plus meurtriers, les plus importants et les plus destructeurs de l’histoire moderne de la Californie, suivant plus de trente communautés impactées par les flammes.
Son livre « Paradise : One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire », publié en 2021 par Crown, raconte la tragédie du Camp Fire qui a ravagé la ville de Paradise en novembre 2018, tuant quatre-vingt-cinq personnes et détruisant une communauté entière en moins de deux heures. Cet ouvrage magistral a été salué par la critique comme un exemple de journalisme narratif de haut niveau, remportant la médaille d’or de la catégorie non-fiction aux California Book Awards en 2022. Le livre a même été adapté en film par Apple, avec Matthew McConaughey et America Ferrera dans les rôles principaux. Pour écrire ce livre, Johnson a vécu partiellement à Paradise et a même suivi une formation professionnelle de pompier pour mieux comprendre la réalité du terrain.
Diplômée de la prestigieuse Missouri School of Journalism avec un double cursus en journalisme et en sciences politiques, Johnson a forgé son expertise dans plusieurs rédactions respectées : The Dallas Morning News, The Omaha World-Herald, The Chicago Tribune, et même El Sol de San Telmo à Buenos Aires. Originaire du Nebraska, elle a toujours montré une attirance particulière pour les histoires difficiles, celles qui exigent courage et persévérance. Elle a rejoint le Washington Post en 2022, d’abord au sein de l’équipe « narrative accountability », puis comme correspondante en Ukraine à partir de juin 2025, précisément pour couvrir ce qui était devenu le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Son parcours exemplaire lui a valu quatre nominations aux prestigieux Livingston Awards, dont la plus récente pour son travail en Ukraine où elle rapporte depuis 2023. La California News Publishers Association l’a récompensée pour la meilleure écriture, le meilleur profil, la meilleure enquête, le meilleur reportage et le meilleur article sur les incendies. En 2021, elle a remporté la première place en écriture de long format dans le concours Best of the West. Ce CV impressionnant aurait dû lui valoir le respect et la considération de sa hiérarchie. Au lieu de cela, elle a reçu un message impersonnel, probablement rédigé par un service des ressources humaines qui ignorait tout de sa situation sur le terrain et des conditions extrêmes dans lesquelles elle travaillait.
Quelques heures avant d’apprendre son licenciement, Lizzie Johnson avait publié sur les réseaux sociaux un message décrivant les conditions difficiles dans lesquelles elle travaillait en Ukraine : sans électricité, sans chauffage, sans eau courante, dans l’hiver le plus rude depuis le début de l’invasion russe à grande échelle. Malgré ces conditions épouvantables, elle restait engagée envers son travail, déterminée à continuer d’informer le monde sur la réalité de la guerre. Et voilà qu’en plein milieu de ce travail héroïque, alors qu’elle risquait sa vie pour informer le public américain et mondial de ce qui se passe réellement sur le terrain ukrainien, quelqu’un au siège du Washington Post a décidé que son poste devait être supprimé. Pas plus tard. Maintenant. Sans même lui laisser le temps de quitter la zone de combat.
Le bain de sang au Washington Post : les chiffres de la honte
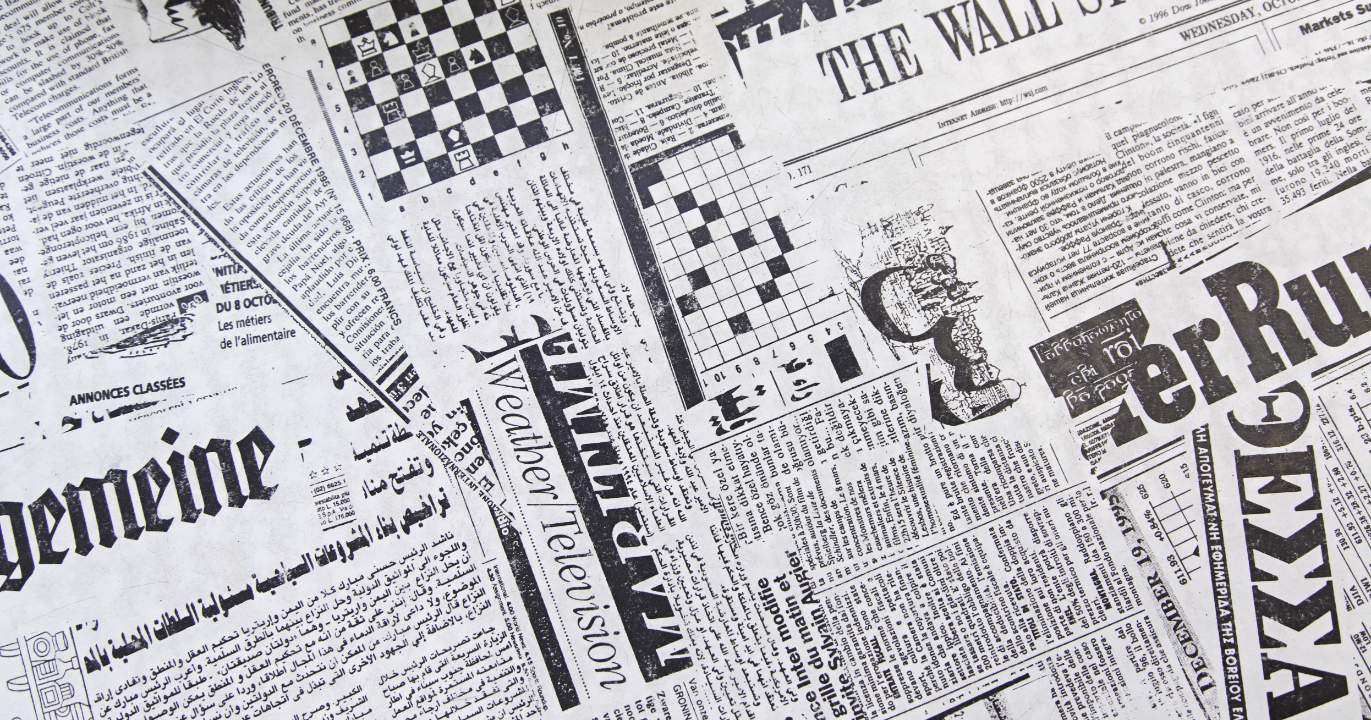
Quand la démocratie meurt dans l’obscurité, ce sont d’abord les journalistes qui éteignent les lumières malgré eux, poussés vers la sortie par des comptables sans âme.
Le licenciement de Lizzie Johnson n’est que la partie émergée d’un iceberg qui vient de percuter de plein fouet l’un des journaux les plus prestigieux du monde. Le Washington Post, propriété de Jeff Bezos depuis 2013, vient d’annoncer la suppression d’environ un tiers de ses effectifs, soit plus de trois cents journalistes sur les quelque huit cents que comptait la rédaction. Un porte-parole du journal a qualifié pudiquement cette opération de « réinitialisation stratégique significative ». Les observateurs du secteur parlent plutôt d’un « bain de sang absolu », une expression qui traduit l’ampleur et la violence de ces coupes sans précédent dans l’histoire récente du journal.
Les chiffres sont vertigineux et dessinent le portrait d’une rédaction en train d’être méthodiquement démantelée. Le bureau de Kiev? Fermé complètement, alors que la guerre fait rage depuis maintenant quatre ans et que l’Ukraine traverse son hiver le plus difficile depuis le début du conflit. La cheffe du bureau ukrainien, Siobhán O’Grady, qui avait qualifié ce poste comme « l’honneur de sa vie », a été licenciée en même temps que Lizzie Johnson. Quelques semaines auparavant, O’Grady avait lancé un appel public à Jeff Bezos sur les réseaux sociaux : « Nous n’oublierons jamais votre soutien pour notre travail essentiel documentant la guerre en Ukraine, qui fait toujours rage. Nous risquons nos vies pour les histoires que nos lecteurs demandent. S’il vous plaît, croyez en nous et sauvez le Post. » Cet appel désespéré est resté sans réponse.
L’équipe entière de correspondants au Moyen-Orient? Décimée intégralement, au moment même où cette région traverse l’une des périodes les plus turbulentes de son histoire récente, avec le conflit israélo-palestinien qui a connu une escalade tragique depuis octobre 2023. La section sports? Pratiquement éliminée dans sa forme actuelle, sacrifiant des décennies d’expertise et de relations avec les acteurs du sport américain. La section livres? Fermée définitivement. Le podcast quotidien phare « Post Reports »? Suspendu. La section métropolitaine de Washington? Réduite de plus de quarante personnes à environ une douzaine, une amputation massive qui affectera profondément la couverture locale de la capitale américaine.
Parmi les journalistes licenciés figurent des noms qui ont marqué le journalisme international : Ishaan Tharoor, chroniqueur respecté spécialisé dans les affaires mondiales; Eva Dou, correspondante en Chine; Jesus Rodriguez; Dino Grandoni; Nilo Tabrizy, récemment félicité par le Columbia Journalism Review pour sa couverture de l’Iran; et Caroline O’Donovan, la journaliste qui couvrait… Amazon, l’entreprise de Jeff Bezos. L’ironie de ce dernier licenciement n’échappera à personne : la journaliste chargée de surveiller les pratiques de l’empire économique du propriétaire se retrouve sans emploi.
Le rédacteur en chef exécutif Matt Murray a qualifié ces mesures de « douloureuses mais nécessaires » pour mettre le journal sur des bases plus solides face aux changements technologiques et aux habitudes évolutives des utilisateurs. Dans son mémo aux employés, Murray a expliqué : « Nous avons conclu que la structure de l’entreprise est trop enracinée dans une ère différente, quand nous étions un produit imprimé local dominant. Cette restructuration aidera à sécuriser notre avenir au service de notre mission journalistique. » Il a également évoqué le déclin des plateformes de recherche comme Google, qui ont façonné l’ère précédente du journalisme numérique : « Notre trafic organique de recherche a chuté de près de moitié au cours des trois dernières années. Et nous sommes encore aux premiers jours du contenu généré par l’intelligence artificielle, qui remodèle drastiquement les expériences et les attentes des utilisateurs. »
Jeff Bezos : le milliardaire qui voulait sauver le journalisme américain

Il y a une décennie, l’achat du Washington Post par Bezos était présenté comme un sauvetage héroïque. Aujourd’hui, on dirait plutôt une prise d’otages suivie d’un abandon calculé.
Rappelons-nous 2013. Jeff Bezos achète le Washington Post pour deux cent cinquante millions de dollars, une somme dérisoire pour l’homme le plus riche du monde, à peine l’équivalent de ce qu’il gagne en quelques heures grâce à la croissance de ses actions Amazon. L’industrie de la presse, alors en pleine crise existentielle face à l’effondrement des revenus publicitaires et à la migration des lecteurs vers le numérique, respire : un milliardaire de la technologie va injecter de l’argent frais, apporter l’innovation numérique, sauver l’un des fleurons du journalisme américain. C’était l’époque où l’on croyait encore que les géants de la technologie pouvaient être les sauveurs de la presse traditionnelle plutôt que ses fossoyeurs.
Les premières années semblent donner raison aux optimistes. Les effectifs augmentent significativement, passant de quelques centaines à plus de mille journalistes. Le journal se modernise, adoptant les dernières technologies pour sa diffusion numérique. Les abonnements numériques décollent, faisant du Post l’un des journaux en ligne les plus lus au monde. Bezos promet de laisser la rédaction travailler en toute indépendance, de ne jamais interférer dans les choix éditoriaux. Pendant quelques années, cette promesse semble tenue et le modèle Bezos est cité en exemple dans toutes les écoles de journalisme.
Mais les temps ont changé, et la lune de miel entre Bezos et le Post semble bel et bien terminée. Le Washington Post aurait perdu cent soixante-dix-sept millions de dollars sur deux ans selon les chiffres rapportés par le directeur de publication Will Lewis en juin 2024. Le trafic du journal a chuté de 1,36 milliard de visiteurs uniques en 2023 à 1,15 milliard en 2025, une baisse significative qui témoigne des difficultés croissantes du journal à maintenir son audience dans un paysage médiatique fragmenté. Les revenus publicitaires, qui constituaient jadis l’essentiel des ressources de la presse, continuent de s’effondrer, captés par les plateformes numériques comme Google et Meta.
Mais surtout, un événement particulier a précipité la chute du journal : la décision de Jeff Bezos d’annuler l’endorsement présidentiel que le comité éditorial avait préparé en faveur de Kamala Harris, à seulement onze jours de l’élection présidentielle d’octobre 2024. Cette décision, que Bezos a assumée personnellement, a provoqué une hémorragie d’abonnés sans précédent. Plus de deux cent cinquante mille lecteurs ont annulé leur abonnement dans les jours suivants, soit environ dix pour cent des 2,5 millions d’abonnés que comptait le journal. Entre cette décision et le jour de l’élection, plus de trois cent mille abonnés avaient quitté le navire, représentant plus de douze pour cent des abonnés numériques.
L’ancien rédacteur en chef exécutif Marty Baron, qui a dirigé le journal pendant huit ans jusqu’en 2021 et qui l’avait mené à son apogée avec la couverture du scandale Watergate de l’administration Nixon, a réagi avec une amertume palpable : « Ceci figure parmi les jours les plus sombres de l’histoire de l’une des plus grandes organisations d’information au monde. » Baron a pointé du doigt les « décisions mal conçues qui venaient du plus haut niveau », notamment « un ordre lâche de tuer un endorsement présidentiel onze jours avant l’élection de 2024 » et « une refonte de la page éditoriale qui ne se distingue plus que par son infirmité morale ». Il a rappelé que lorsqu’il dirigeait la rédaction, Bezos « déclarait souvent que le succès du Post serait parmi les accomplissements les plus fiers de sa vie. J’aimerais détecter le même esprit aujourd’hui. Il n’y en a aucun signe. »
L'Ukraine abandonnée : quand l'information devient un luxe inaccessible

Fermer le bureau de Kiev, c’est accepter que le monde occidental détourne le regard de l’une des crises les plus importantes de notre époque, précisément au moment où l’attention internationale faiblit dangereusement.
La fermeture du bureau du Washington Post à Kiev n’est pas qu’une décision économique parmi d’autres. C’est un choix éditorial aux conséquences géopolitiques majeures, qui dépasse largement le cadre d’une simple réorganisation interne. Le Kyiv Independent, journal ukrainien anglophone qui fait un travail remarquable malgré des moyens limités, a souligné l’ironie tragique de voir le journal américain abandonner son bureau ukrainien « au milieu de l’hiver le plus rude depuis le début de l’invasion russe à grande échelle ». Depuis février 2022, la guerre en Ukraine a redessiné les contours du monde tel que nous le connaissions. Elle a posé des questions fondamentales sur la démocratie, la souveraineté des nations, les limites de l’impérialisme russe, le rôle de l’Occident dans la défense des valeurs démocratiques.
Les correspondants de guerre qui ont couvert l’Ukraine ces quatre dernières années ont pris des risques immenses pour rapporter la vérité du terrain. Ils ont documenté les atrocités de Boutcha, les bombardements de Marioupol, la résistance héroïque des Ukrainiens face à un envahisseur bien plus puissant militairement. Sans leur travail, le monde aurait une vision bien plus floue, bien plus manipulable, de ce qui se passe réellement dans cette guerre. Leur présence sur place a été essentielle pour contrer la désinformation russe massive et pour maintenir l’attention internationale sur ce conflit qui pourrait autrement sombrer dans l’oubli médiatique.
Le syndicat des journalistes du Washington Post, le Post Guild, a vivement réagi à ces licenciements : « Ces licenciements ne sont pas inévitables. Une rédaction ne peut pas être évidée sans conséquences pour sa crédibilité, sa portée et son avenir. » Le syndicat a également interpellé directement Bezos : « Si Jeff Bezos n’est plus disposé à investir dans la mission qui a défini ce journal pendant des générations et à servir les millions de personnes qui dépendent du journalisme du Post, alors le Post mérite un gardien qui le fera. » Le syndicat a rappelé que le journal a réduit ses effectifs d’environ quatre cents personnes au cours des trois dernières années, une saignée continue qui affaiblit progressivement l’institution.
Car soyons clairs : la guerre en Ukraine n’est pas terminée, contrairement à ce que voudraient nous faire croire ceux qui souffrent de fatigue informationnelle. Les combats continuent quotidiennement, les civils meurent sous les bombes russes, les fronts bougent dans un sens comme dans l’autre. L’hiver 2025-2026 est le plus difficile depuis le début du conflit, avec des coupures d’électricité généralisées, des infrastructures énergétiques systématiquement ciblées par les frappes russes, une population qui lutte pour survivre dans le froid. La fatigue informationnelle de l’Occident, compréhensible après quatre années de conflit, ne change rien à la réalité sur le terrain. Et pourtant, les grands médias, l’un après l’autre, réduisent leur présence en Ukraine, comme s’il s’agissait d’une histoire terminée. Comme si la guerre était passée de mode.
Le cynisme institutionnel : licencier d'abord, réfléchir jamais

Il y a quelque chose de profondément pourri dans un système qui considère les correspondants de guerre comme des lignes de dépenses interchangeables sur un tableur Excel.
Ce qui me révolte le plus dans cette affaire, ce n’est même pas la décision de licencier des journalistes en tant que telle. Les restructurations existent dans toutes les industries, les entreprises traversent des crises financières, des choix difficiles doivent parfois être faits pour assurer la survie d’une organisation. Je comprends ces réalités économiques, même si je les déplore dans le contexte d’un journal appartenant à l’un des hommes les plus riches de la planète. Non, ce qui me révolte profondément, viscéralement, c’est la manière dont ces licenciements ont été exécutés. C’est le timing choisi. C’est l’absence totale d’humanité dans l’exécution de ces décisions administratives.
Licencier quelqu’un qui se trouve physiquement dans une zone de guerre active, c’est lui dire de la façon la plus brutale possible que sa sécurité, sa santé mentale, sa dignité ne comptent pas. C’est lui demander de gérer simultanément le choc professionnel dévastateur du licenciement et le stress existentiel permanent de se trouver dans un environnement où des missiles peuvent tomber à tout moment. C’est faire preuve d’une indifférence qui confine à la cruauté pure et simple, une cruauté qu’on n’oserait infliger à personne dans des circonstances normales. Matt Murray a déclaré que ces décisions « ne reflétaient pas la qualité du travail » des journalistes licenciés. Si tel est le cas, pourquoi les traiter avec si peu de considération pour leur situation personnelle?
On aurait pu attendre quelques jours, quelques semaines. On aurait pu la rapatrier d’abord dans un environnement sécurisé, lui annoncer la nouvelle dans un cadre où elle aurait pu être entourée, soutenue, accompagnée. On aurait pu lui offrir un accompagnement psychologique digne de ce nom, reconnaissant le traumatisme que représentent des années de couverture de guerre ajouté au choc d’un licenciement brutal. Mais non. L’efficacité des processus de ressources humaines a primé sur tout le reste. Le tableau Excel devait être mis à jour aujourd’hui, pas demain. Que Lizzie Johnson soit au milieu des missiles russes, sans électricité ni chauffage, ou dans un bureau climatisé de Washington, quelle différence cela fait-il pour les gestionnaires de portefeuille qui ont pris cette décision depuis le confort de leurs bureaux?
Cette attitude révèle une déconnexion totale entre ceux qui dirigent les médias et ceux qui font le journalisme sur le terrain. Les managers qui ont pris cette décision n’ont probablement jamais mis les pieds dans une zone de guerre, n’ont jamais ressenti la peur d’une explosion proche, n’ont jamais dû se cacher dans un abri en attendant que le danger passe. Pour eux, un correspondant de guerre n’est qu’un numéro sur une feuille de calcul, un coût à optimiser comme n’importe quel autre, une variable d’ajustement dans un plan de restructuration approuvé par des consultants en management qui ne connaissent rien au journalisme.
Le Moyen-Orient aussi passe à la trappe médiatique

Après l’Ukraine, c’est toute une région en flammes qui se retrouve sans les yeux et les oreilles du Washington Post, précisément quand ces témoins seraient les plus nécessaires.
Il ne faudrait pas croire que l’Ukraine est un cas isolé dans cette vague de licenciements. Le bureau du Washington Post au Moyen-Orient a également été vidé de ses correspondants permanents, au moment même où cette région traverse une période de tensions extrêmes. Dans une région où les conflits se multiplient, où le conflit israélo-palestinien a connu une escalade tragique depuis octobre 2023 avec des conséquences humanitaires dramatiques qui continuent de faire des milliers de victimes, où l’Iran joue un rôle de plus en plus déterminant dans l’équilibre des forces régionales, le journal de Bezos a décidé que cette couverture n’était plus prioritaire. Tous les correspondants et éditeurs couvrant le Moyen-Orient ont été licenciés, une décision qui laisse un trou béant dans la couverture internationale du journal.
Nilo Tabrizy, récemment félicité par le Columbia Journalism Review pour son travail exceptionnel sur l’Iran, fait partie des journalistes licenciés. À un moment où les tensions entre les États-Unis et l’Iran atteignent des sommets, où le programme nucléaire iranien fait l’objet d’intenses négociations diplomatiques, où les proxies iraniens jouent un rôle majeur dans plusieurs conflits régionaux, le Washington Post choisit de se priver de l’une des voix les plus informées sur ce pays crucial. La logique comptable derrière cette décision est peut-être irréprochable du point de vue strict de la gestion financière. Mais la logique journalistique, elle, est complètement absente de ce raisonnement purement financier.
Le Moyen-Orient est depuis des décennies l’une des régions les plus importantes pour la politique étrangère américaine. Les États-Unis y maintiennent une présence militaire massive, y ont des alliés stratégiques, y interviennent régulièrement diplomatiquement et parfois militairement. Comment le public américain peut-il comprendre les choix de ses dirigeants en matière de politique étrangère si les médias qu’il consulte n’ont plus de journalistes sur place pour lui expliquer la complexité de la situation? Comment peut-il exercer son rôle de citoyen éclairé dans une démocratie si l’information de qualité sur ces sujets cruciaux disparaît progressivement?
Matt Murray a indiqué que le journal maintiendrait « une présence stratégique outre-mer dans près d’une douzaine de localisations avec un focus sur les questions de sécurité nationale ». Mais cette formulation vague cache mal la réalité d’une couverture internationale drastiquement réduite. Le journalisme de bureau, le journalisme de reprises de dépêches d’agences, le journalisme qui commente depuis Washington ce qui se passe à des milliers de kilomètres sans jamais y avoir mis les pieds, ce n’est tout simplement pas du journalisme digne de ce nom. C’est de l’analyse plus ou moins informée, de l’opinion plus ou moins fondée, parfois de la spéculation pure et simple. Mais ce n’est pas ce travail de terrain irremplaçable qui permet de comprendre vraiment ce qui se passe et d’en rendre compte fidèlement au public.
La mort lente du journalisme international américain

Ce qui arrive au Washington Post n’est que le symptôme le plus visible d’une maladie qui ronge toute la presse américaine depuis des années, une maladie dont les symptômes s’aggravent inexorablement.
Il serait tentant et facile de pointer du doigt Jeff Bezos et le Washington Post comme des cas particuliers, des anomalies dans un paysage médiatique autrement sain et florissant. Ce serait se voiler la face et ignorer une tendance de fond qui affecte l’ensemble de l’industrie médiatique américaine. La vérité, bien plus dérangeante, c’est que les bureaux internationaux des médias américains ferment les uns après les autres depuis maintenant deux décennies. Les effectifs de correspondants permanents à l’étranger ont été divisés par trois, voire par quatre dans certains cas, en l’espace de vingt ans. Les budgets alloués aux voyages et aux reportages internationaux ont été sabrés impitoyablement. Le journalisme international de qualité est devenu un luxe que la plupart des rédactions ne peuvent plus se permettre, ou ne veulent plus s’offrir.
Les conséquences de cet appauvrissement sont déjà clairement visibles pour quiconque y prête attention. L’Amérique, première puissance mondiale dont les décisions affectent la planète entière, comprend de moins en moins bien le monde complexe dans lequel elle évolue et sur lequel elle exerce une influence considérable. Les décisions de politique étrangère, qui engagent parfois des vies humaines et des milliards de dollars, sont débattues dans un quasi-vide informationnel. Les citoyens américains forment leurs opinions sur des sujets vitaux à partir d’images décontextualisées circulant sur les réseaux sociaux, de tweets incendiaires de personnalités publiques, de clips vidéo de quelques secondes incapables de rendre compte de la moindre complexité.
L’ancien rédacteur en chef Glenn Kessler, qui dirigeait l’équipe de fact-checking du Post, a écrit dans une tribune : « Bezos n’essaie pas de sauver le Washington Post. Il essaie de survivre à Donald Trump. » Cette analyse cynique mais perspicace suggère que les décisions éditoriales du journal sont désormais guidées moins par des considérations journalistiques que par des calculs politiques et économiques liés aux intérêts personnels de son propriétaire. Et quand un événement majeur survient de façon inattendue, comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les rédactions se retrouvent à improviser dans l’urgence, envoyant des journalistes qui ne connaissent pas le terrain, qui ne parlent pas les langues locales, qui n’ont pas les contacts nécessaires pour accéder aux sources fiables.
Le sport aussi meurt : la destruction méthodique d'une rédaction

Quand même la section sports, traditionnel pilier de tout journal américain depuis plus d’un siècle, est sacrifiée sur l’autel des économies, on mesure l’ampleur véritable du désastre.
Les licenciements au Washington Post ne se limitent pas aux bureaux internationaux, aussi choquante que soit leur fermeture. La section sports du journal, l’une des plus respectées du pays avec une histoire remontant à plus d’un siècle, a également été décimée dans cette vague de coupes. Matt Murray a indiqué que le département sports serait fermé « dans sa forme actuelle », avec seulement quelques reporters retenus pour des articles de fond. Pour comprendre ce que cela signifie vraiment, il faut se rappeler que le sport est traditionnellement l’un des piliers absolus de la presse américaine depuis ses origines. C’est historiquement la section la plus lue par une grande partie du lectorat, celle qui attire les abonnements des fans passionnés, celle qui génère un trafic régulier et fidèle.
De même, la section livres du journal a été fermée définitivement. Dans une époque où la lecture est déjà menacée par la concurrence des écrans et des réseaux sociaux, le Washington Post choisit d’abandonner sa mission de promotion de la culture littéraire. Les critiques littéraires qui ont guidé des générations de lecteurs vers des œuvres remarquables se retrouvent sans emploi, leur expertise accumulée au fil des décennies soudainement considérée comme superflue. Murray a indiqué que le journal se recentrerait sur « la politique et la sécurité nationale », abandonnant la mission plus large d’un journal généraliste « pour et sur Washington » qui couvrait tous les aspects de la vie de la capitale américaine.
Mais au-delà des considérations économiques à court terme, c’est un pan entier de la culture journalistique américaine qui disparaît avec ces licenciements. Les grandes plumes sportives du Post, ceux qui ont couvert des décennies de Super Bowls mémorables, de World Series palpitantes, de tournois NCAA Final Four, ceux qui connaissaient intimement les franchises locales de Washington et leurs histoires, se retrouvent sur le carreau du jour au lendemain. Leur expertise unique, accumulée au fil de carrières entières, leur connaissance intime des équipes, des joueurs, des entraîneurs de la région, leurs sources cultivées patiemment pendant des années voire des décennies, tout cela disparaît d’un seul coup.
Et pour quoi, au final? Pour économiser quelques millions de dollars, peut-être une dizaine de millions au maximum, dans un journal appartenant à l’un des hommes les plus riches de toute l’histoire de l’humanité dont la fortune personnelle dépasse les deux cents milliards de dollars? La disproportion absolue entre les moyens théoriquement disponibles et les choix effectivement réalisés donne le vertige. Jeff Bezos pourrait financer le Washington Post pendant des siècles avec sa seule fortune personnelle sans même s’en apercevoir. S’il choisit de le laisser mourir à petit feu, c’est qu’il en a fait le choix délibéré, pas qu’il y est contraint par les circonstances économiques.
La question politique : Bezos et Trump, une relation trouble
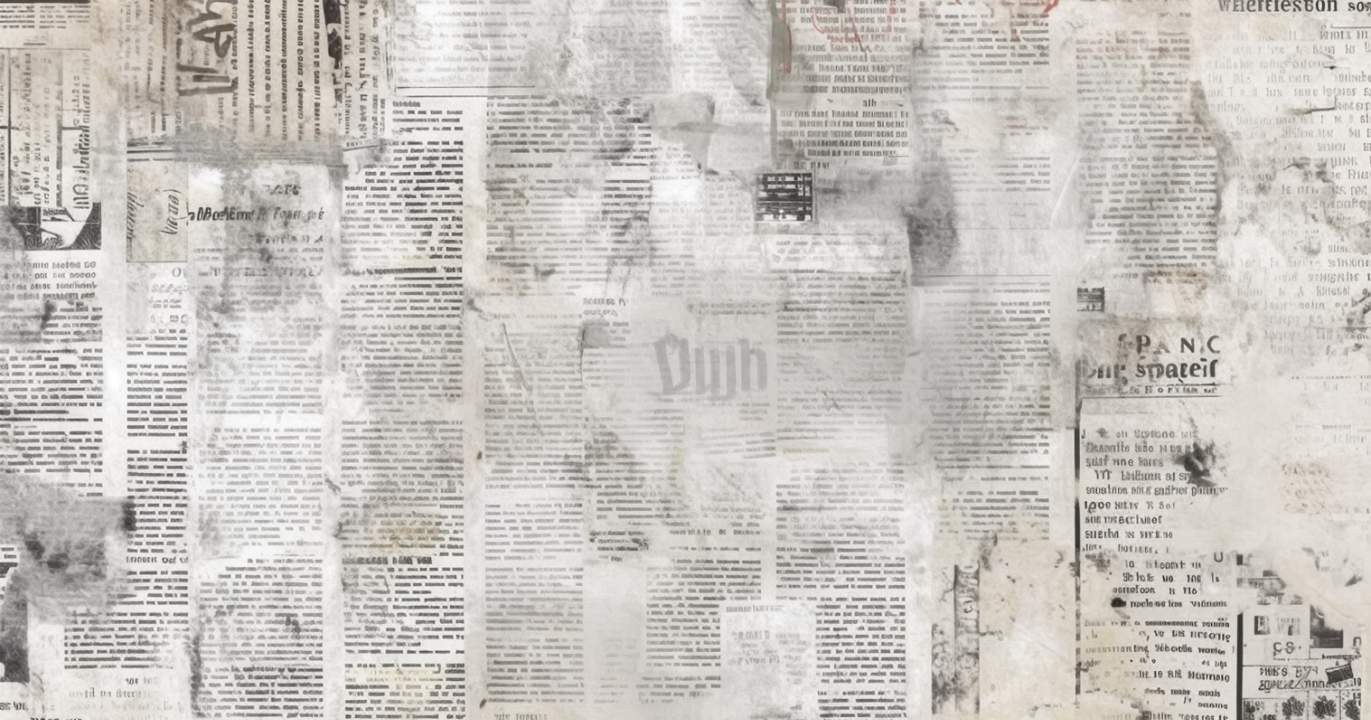
Peut-on vraiment croire que les coupes au Post n’ont absolument rien à voir avec les relations entre son propriétaire milliardaire et le pouvoir politique en place à la Maison-Blanche?
Il y a un éléphant dans la pièce dont personne dans les cercles médiatiques officiels ne veut vraiment parler ouvertement, mais que tout le monde voit. Jeff Bezos a des intérêts économiques absolument colossaux qui dépendent largement des bonnes grâces du gouvernement fédéral américain. Amazon, sa principale source de richesse personnelle et l’empire sur lequel repose sa fortune, possède des contrats massifs avec le gouvernement américain, notamment dans le domaine stratégique du cloud computing avec des agences aussi sensibles que la CIA et le Pentagone. Blue Origin, son entreprise spatiale qu’il considère comme son héritage le plus important pour l’humanité, dépend très largement des commandes de la NASA et de contrats militaires.
Donald Trump, revenu à la Maison-Blanche pour un second mandat en janvier 2025, n’a jamais caché ni dissimulé son hostilité envers le Washington Post et envers Bezos personnellement. Il les a ciblés régulièrement dans ses attaques publiques pendant des années. Il a multiplié les déclarations contre le journal, qu’il qualifie inlassablement de « fake news » et d’ennemi du peuple américain. Il a évoqué à plusieurs reprises, et pas toujours de façon voilée, la possibilité de représailles économiques contre Amazon, que ce soit en matière de contrats fédéraux ou de réglementation antitrust. Dans ce contexte politique tendu, peut-on vraiment croire naïvement que les décisions éditoriales du Post sont prises en toute indépendance de ces considérations extérieures?
L’accusation lancée par l’ancienne rédactrice en chef Sally Buzbee sur les « efforts écœurants pour se faire bien voir » auprès de Trump prend ici tout son sens et mérite d’être prise au sérieux. Le directeur de publication Will Lewis, venu de News Corp, l’empire médiatique de Rupert Murdoch connu pour ses positions pro-républicaines, a été critiqué en interne pour des initiatives considérées comme des échecs, notamment WP Ventures et WP Incubator, dont l’efficacité a été questionnée par le personnel. Sabrer dans les équipes qui couvrent la politique étrangère, l’Ukraine où Poutine est l’allié objectif de Trump, le Moyen-Orient où les choix américains sont contestés, c’est peut-être aussi une façon de réduire stratégiquement les sources de friction potentielles avec une administration qui n’apprécie guère la surveillance journalistique.
Matt Murray a défendu Will Lewis dans une interview, affirmant que ce dernier « travaille à créer des sources alternatives de revenus » et « travaille à développer différentes sortes de technologies d’intelligence artificielle et de produits ». Mais ces justifications techniques ne dissipent pas les soupçons d’interférence politique. Quand le propriétaire d’un journal a des milliards de dollars en jeu dans ses relations avec le gouvernement, et que ce gouvernement est hostile au journal, les décisions de restructuration prennent inévitablement une dimension politique, qu’elle soit intentionnelle ou non.
Les réactions du milieu journalistique : entre stupeur et colère froide

Dans les rédactions du monde entier, le choc est palpable et durable. La solidarité professionnelle entre journalistes aussi, face à l’adversité commune.
La nouvelle des licenciements massifs au Washington Post a provoqué une véritable onde de choc dans le monde du journalisme international. Marty Baron, l’ancien rédacteur en chef qui avait porté le journal à son apogée, a été particulièrement virulent dans sa condamnation. Au-delà de qualifier ce jour comme « parmi les plus sombres de l’histoire » du journal, Baron a déclaré : « Les ambitions du Washington Post seront fortement diminuées, son personnel talentueux et courageux sera encore plus réduit, et le public sera privé du reportage de terrain, factuel, dans nos communautés et à travers le monde, qui est plus nécessaire que jamais. » Il a également rappelé les erreurs stratégiques de Bezos : « Il ne peut nier que ces problèmes financiers aigus ont été rendus infiniment pires par des décisions mal conçues qui venaient du plus haut niveau. »
De nombreux confrères et consœurs, aux États-Unis mais aussi partout dans le monde, ont exprimé publiquement leur solidarité avec les journalistes licenciés, particulièrement avec Lizzie Johnson dont le cas particulier symbolise de façon frappante toute l’inhumanité de la situation. Siobhán O’Grady, la cheffe du bureau de Kiev également licenciée, a posté un message poignant qualifiant son travail de « l’honneur de ma vie » tout en déplorant cette fin abrupte. Sur les réseaux sociaux, des journalistes de tous horizons, de toutes générations, de tous médias, ont partagé leurs propres expériences de précarité croissante, de licenciements brutaux et humiliants, de rédactions jadis florissantes désormais décimées.
Le syndicat des journalistes du Washington Post, le Post Guild, a publié un communiqué particulièrement cinglant : « Continuer à éliminer des travailleurs ne peut que affaiblir le journal, éloigner les lecteurs et saper la mission du Post. » Le syndicat a également interpellé directement le propriétaire, suggérant que si Bezos n’est plus disposé à investir dans la mission historique du journal, alors « le Post mérite un gardien qui le fera ». Mais dans un contexte américain où le droit syndical est constamment affaibli par des législations hostiles et des jurisprudences défavorables, ces protestations même vigoureuses risquent malheureusement de rester lettre morte. Les rapports de force sont trop déséquilibrés pour permettre une véritable résistance efficace.
Plus largement, cette affaire remet sur la table le débat fondamental sur le modèle économique de la presse et sur le rôle ambigu des propriétaires milliardaires dans les médias. Quand des hommes comme Bezos avec le Washington Post, Elon Musk avec Twitter devenu X, Rupert Murdoch avec son empire News Corp, Patrick Drahi avec divers médias européens, contrôlent une part significative et croissante des médias mondiaux, la question de l’indépendance éditoriale réelle se pose avec une acuité nouvelle. Ces hommes ne sont pas des philanthropes désintéressés : ils ont des agendas politiques, des intérêts économiques, des ego à satisfaire. Peuvent-ils vraiment laisser leurs journaux travailler librement quand ces derniers enquêtent sur des sujets qui les concernent directement?
Que reste-t-il de la devise du Post?

« Democracy Dies in Darkness » proclame fièrement le Washington Post. Mais qui éteint les lumières, au final, sinon ceux qui prétendent les protéger?
Depuis 2017, le Washington Post affiche en bandeau permanent de son site web et de son journal papier une devise qui se voulait un manifeste de résistance démocratique : « Democracy Dies in Darkness » – La démocratie meurt dans l’obscurité. Cette phrase percutante, adoptée à l’aube de la première présidence Trump dans un contexte de tensions entre le pouvoir politique et la presse, était une promesse solennelle faite aux lecteurs et aux citoyens. Une promesse que le journal serait toujours là pour éclairer les zones d’ombre, pour surveiller les puissants, pour informer honnêtement le public. Pour empêcher que l’obscurité ne s’installe durablement sur la vie démocratique américaine.
Aujourd’hui, après l’annonce de ces licenciements massifs, cette devise sonne comme une amère ironie dont la cruauté n’échappe à personne. Car ce sont désormais les propres décisions du journal et de son propriétaire milliardaire qui éteindront les lumières en Ukraine, au Moyen-Orient, dans toutes ces régions du monde où la démocratie est menacée par des autocrates, où des guerres font rage dans l’indifférence croissante, où l’information de qualité serait plus nécessaire que jamais. Le journal qui prétendait défendre la démocratie contre l’obscurité choisit lui-même de plonger des régions entières dans le noir.
La démocratie meurt dans l’obscurité, proclame le Post. Mais quand le Post lui-même choisit délibérément de plonger des régions entières dans le noir en retirant ses correspondants, quand il abandonne la couverture de terrain au profit d’économies de bouts de chandelle, qui peut encore croire sincèrement à cette devise? Elle devient un slogan marketing creux, une marque déposée vidée de toute substance, un héritage prestigieux dont on se réclame sans jamais l’honorer dans les faits. Les mots ne valent que par les actes qui les accompagnent, et les actes du Washington Post contredisent aujourd’hui cruellement ses belles paroles.
Il y a quelque chose de profondément tragique à voir un journal qui a contribué à révéler le scandale du Watergate et à faire tomber un président corrompu se transformer progressivement en ombre de lui-même. Le Washington Post de Ben Bradlee, de Katharine Graham, de Bob Woodward et Carl Bernstein, ce journal qui incarnait le meilleur du journalisme d’investigation américain, existe-t-il encore vraiment? Ou n’en reste-t-il qu’une coquille vide, un nom prestigieux exploité par un milliardaire pour des raisons qui n’ont plus rien à voir avec le journalisme?
L'avenir sombre du journalisme de terrain dans le monde contemporain

Si même les géants peuvent tomber de si haut, si rapidement et si brutalement, que reste-t-il d’espoir pour tous les autres?
Ce qui arrive au Washington Post devrait inquiéter profondément quiconque se soucie de l’avenir de l’information et de la démocratie. Si un journal disposant de ressources théoriquement illimitées, adossé à la fortune personnelle de l’un des hommes les plus riches de l’histoire humaine, choisit malgré tout d’abandonner le journalisme de terrain international, que peuvent faire les autres? Les journaux régionaux américains qui luttent déjà quotidiennement pour leur simple survie face à l’effondrement des revenus publicitaires? Les médias indépendants qui fonctionnent avec des budgets dérisoires et dépendent de la générosité de donateurs? Les médias européens qui font face aux mêmes pressions économiques dans un marché plus restreint?
Le message envoyé par ces licenciements est profondément dévastateur pour toute une profession : le journalisme international de qualité, le journalisme de guerre qui documente les horreurs et les héroïsmes humains, le journalisme qui coûte cher à produire et rapporte peu en termes de clics immédiats et de revenus publicitaires, ce journalisme-là n’a plus sa place dans le modèle économique actuel des médias. Les algorithmes des réseaux sociaux préfèrent le sensationnel local facile au reportage de terrain lointain et nuancé. Les annonceurs fuient systématiquement les contenus qu’ils jugent « déprimants » ou « controversés ». Les lecteurs, bombardés en permanence de contenus gratuits de qualité variable, rechignent de plus en plus à payer pour de l’information de qualité.
Dans ce contexte économique hostile, des journalistes comme Lizzie Johnson, ces reporters courageux qui vont là où personne ne veut aller, qui risquent leur vie pour documenter la vérité, qui développent une expertise irremplaçable au fil des années, deviennent des espèces en voie de disparition dans l’écosystème médiatique. Leur courage exceptionnel, leur expertise durement acquise, leur engagement total envers la vérité deviennent des fardeaux économiques plutôt que des atouts valorisés. Et le monde, progressivement privé de leurs yeux témoins et de leurs oreilles attentives, devient un peu plus opaque chaque jour, un peu plus incompréhensible, un peu plus dangereux pour les démocraties qui ont besoin de citoyens informés pour fonctionner.
Je termine cette chronique avec un sentiment mélangé de colère et d’impuissance qui me colle à la peau depuis l’annonce de ces licenciements. Colère profonde contre un système économique qui traite les journalistes comme des marchandises jetables qu’on peut licencier par email au milieu d’une zone de guerre. Colère contre un milliardaire qui possède l’un des plus grands journaux du monde sans sembler comprendre ni respecter ce que le journalisme représente réellement pour une société démocratique. Impuissance face à des forces économiques et politiques qui dépassent de loin le pouvoir de la plume et les protestations individuelles.
Mais aussi, quelque part au fond de moi, un espoir têtu qui refuse de mourir complètement. Car l’histoire longue du journalisme est aussi une histoire de résilience face à l’adversité. Une histoire de journaux qui renaissent de leurs cendres après des crises qui semblaient fatales. De journalistes qui continuent d’informer le public malgré tous les obstacles dressés sur leur route. De lecteurs qui finissent par comprendre que l’information de qualité a un prix, et que ce prix vaut la peine d’être payé pour préserver la démocratie.
À Lizzie Johnson, où qu’elle soit en ce moment, dans ce monde devenu un peu plus sombre depuis son licenciement brutal, je voudrais dire ceci : votre travail compte énormément. Votre courage exceptionnel compte. Votre engagement envers la vérité compte. Et même si le Washington Post vous a tourné le dos de façon si brutale et inhumaine, le monde a besoin de journalistes comme vous. Maintenant plus que jamais dans cette période troublée où la désinformation prolifère et où les autocrates gagnent du terrain. Ne baissez pas les bras. L’histoire du journalisme n’est pas terminée. Elle s’écrit chaque jour, par des gens comme vous qui refusent de céder à la facilité et au cynisme.
Signé Maxime Marquette
Encadré de transparence du chroniqueur
Cette chronique exprime l’opinion personnelle de son auteur sur un sujet d’actualité médiatique majeur. Elle ne prétend pas à l’objectivité journalistique au sens classique du terme mais assume pleinement sa subjectivité et sa prise de position éditoriale. Les informations factuelles présentées dans ce texte proviennent de sources publiques réputées fiables, citées en fin d’article avec leurs liens complets. L’auteur n’a aucun lien personnel, professionnel ou financier avec les personnes ou institutions mentionnées dans ce texte. Cette chronique a été rédigée dans un élan de solidarité avec les journalistes licenciés du Washington Post et avec l’intention déclarée de contribuer au débat public sur l’avenir du journalisme à l’ère des milliardaires de la technologie. Les opinions exprimées n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la position de la publication qui l’héberge.
Sources
NDTV – Fired In Middle Of War Zone: Washington Post’s Ukraine Correspondent Lizzie Johnson Laid Off
Kyiv Independent – Kyiv bureau among those axed by Jeff Bezos’ Washington Post
Raw Story – Firestorm as Washington Post lays off reporter in the middle of a ‘frigid warzone’
Columbia Journalism Review – A Dismantling of the Washington Post
CBS News – Washington Post begins sweeping layoffs as it sharply scales back news coverage
NPR – Bezos orders layoffs at Washington Post
Global News – Washington Post layoffs include entire Ukraine, Middle East bureaus
NBC News – Washington Post lays off one-third of its newsroom
Axios – Washington Post announces sweeping layoffs amid financial distress
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.