
L’inventaire de la mort
Mais les 205 combats au sol ne sont que la moitié de l’histoire. Parce qu’il y a aussi le ciel. Et le ciel, lui, ne se repose jamais.
52 frappes aériennes. 170 bombes guidées. 4316 drones kamikazes. 2875 bombardements d’artillerie. En vingt-quatre heures. Pendant que les soldats se battaient au sol, le ciel déversait sa propre version de l’enfer. Un enfer méthodique. Calculé. Industriel.
Prenez juste les drones. 4316 drones kamikazes. Quatre mille trois cent seize. Divisez par 24 heures. Ça fait 179,8 drones par heure. Divisez par 60 minutes. Ça fait trois drones par minute. Un toutes les vingt secondes.
Vingt secondes.
Le sifflement qui ne s’arrête jamais
Fermez les yeux une seconde. Imaginez. Vous êtes dans une tranchée quelque part près de Pokrovsk. Il fait froid. Vous n’avez pas dormi depuis 36 heures. Vos mains tremblent, pas de peur mais d’épuisement pur. Et vous entendez le sifflement. Ce sifflement aigu, métallique, qui vient du ciel. Un drone.
Vous plongez. Par instinct de survie. Votre corps réagit avant votre cerveau. Vous vous écrasez au fond de la tranchée. Le drone explose. Peut-être sur votre position. Peut-être cinquante mètres plus loin. Vous ne savez pas. Vous êtes vivant. Pour l’instant.
Vous vous relevez. Vous reprenez votre souffle. Vingt secondes passent. Le sifflement recommence. Un autre drone. Vous plongez à nouveau. Explosion. Vous survivez. Encore.
Encore vingt secondes. Sifflement. Plongeon. Explosion. Survie.
Toujours vingt secondes. Sifflement. Plongeon. Explosion. Survie.
Pendant vingt-quatre heures.
4316 fois, quelqu’un a entendu ce sifflement. 4316 fois, quelqu’un a plongé. Combien ont survécu? Le rapport ne le dit pas. Il énumère juste: 4316 drones. Comme on dirait: il a plu 4316 gouttes. Neutre. Factuel. Insupportable.
Ce que les statistiques ne révèlent pas
Le rapport de l’État-major ukrainien est précis. Chirurgical. 52 frappes aériennes. 170 bombes guidées. 4316 drones kamikazes. 2875 bombardements d’artillerie. Chaque chiffre est vérifié. Documenté. Réel.
Mais le rapport ne précise pas combien de ces 4316 drones ont atteint leur cible. Il ne dit pas combien ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne. Il ne dit pas combien sont tombés dans des champs vides. Il ne dit pas combien ont visé des maisons où il y avait des gens.
Le rapport ne quantifie pas les secondes qui s’écoulent entre le moment où un soldat entend le sifflement et celui où il comprend s’il va vivre ou mourir. Il ne dépeint pas ce qui traverse l’esprit d’un homme pendant ces secondes-là. Il ne dit pas si on prie. Si on pense à sa mère. Si on pense à rien du tout.
Le rapport ne souligne pas que 4316 drones, c’est 4316 décisions prises par quelqu’un, quelque part en Russie, de programmer une machine pour qu’elle aille tuer des gens qu’il ne verra jamais. 4316 actes délibérés. 4316 fois où quelqu’un a appuyé sur un bouton en sachant exactement ce qui allait se passer.
La carte qui saigne

Onze noms, mille kilomètres
Pokrovsk. Lyman. Kramatorsk. Kupiansk. Sloviansk. Huliaipole. Orikhiv. Kostyantynivka. Oleksandrivka. Prydniprovske. Kursk.
Onze secteurs. Onze noms qui n’étaient que des points sur une carte avant février 2022. Des villes. Des villages. Des endroits où des gens vivaient des vies ordinaires. Où des enfants allaient à l’école. Où des couples se mariaient. Où des vieux s’asseyaient sur des bancs de parc pour nourrir les pigeons.
Aujourd’hui, ce ne sont plus des noms. Ce sont des verbes. On ne dit plus « Pokrovsk ». On dit « tenir Pokrovsk ». « Défendre Pokrovsk ». « Repousser à Pokrovsk ». Les lieux sont devenus des actions. La géographie s’est transformée en grammaire de la guerre.
Le front qui ne finit jamais
Prenez une carte de l’Ukraine. Tracez une ligne du nord au sud. De Kharkiv à Zaporizhzhia. Mille kilomètres. Mille kilomètres de front actif. Mille kilomètres où, à chaque instant, quelqu’un défend, quelqu’un attaque, quelqu’un meurt.
Mille kilomètres, c’est la distance entre Montréal et la Floride. Entre Paris et Rome. Entre Toronto et Thunder Bay. Essayez d’imaginer cette distance entièrement couverte de tranchées, de positions fortifiées, de champs de mines, de zones de combat. Essayez d’imaginer que sur chaque kilomètre de cette ligne, il y a des hommes. Des jeunes hommes, surtout. Vingt ans. Vingt-cinq ans. Trente ans. Des hommes qui devraient être en train de construire leur vie, pas de défendre une ligne sur une carte.
Et sur ces mille kilomètres, en une seule journée, il y a eu 205 combats. Ça fait un engagement tous les 4,9 kilomètres. Imaginez. Vous êtes sur cette ligne. Vous défendez votre bout de tranchée. Cinq kilomètres à votre gauche, vos camarades repoussent une offensive. Cinq kilomètres à votre droite, d’autres camarades font la même chose. Et vous savez que dans cinq minutes, dix minutes, une heure, ce sera peut-être votre tour.
Les villes qui sont devenues des champs de bataille
Pokrovsk. Avant la guerre: 60000 habitants. Une école secondaire. Un parc municipal avec des balançoires. Un cinéma qui passait les derniers films hollywoodiens. Un supermarché où les gens faisaient leurs courses le samedi. Une vie.
Pokrovsk aujourd’hui: 59 assauts en 24 heures. Cinquante-neuf fois où l’armée russe a essayé de prendre la ville. Cinquante-neuf fois où l’armée ukrainienne a dit non. Le cinéma est toujours là. Personne n’y va. Le supermarché subsiste. Les rayons sont vides. L’école demeure. Les enfants sont partis.
La ville existe encore. Mais elle n’est plus une ville. Elle est un symbole. Un point sur une carte militaire. Un objectif stratégique. Un lieu que des généraux regardent sur des écrans en disant: « Il faut tenir Pokrovsk. » Comme si Pokrovsk n’était qu’un mot. Pas un endroit où des gens vivaient.
Kramatorsk. Sloviansk. Kupiansk. Même trajectoire. Des agglomérations devenues des lignes de défense. Des maisons converties en positions fortifiées. Des rues transformées en zones de tir. La guerre ne détruit pas seulement les bâtiments. Elle détruit le sens des lieux.
Pokrovsk : l'épicentre

Cinquante-neuf fois
59 assauts en 24 heures. Dans un seul secteur. Cinquante-neuf fois où l’armée russe a lancé ses soldats contre les positions ukrainiennes. Cinquante-neuf fois où quelqu’un a donné l’ordre: « Attaquez. » Cinquante-neuf fois où quelqu’un d’autre a crié: « Tenez bon. »
Faisons le calcul encore. Parce qu’il faut le faire pour comprendre ce que ça représente. 59 assauts en 24 heures. Ça fait 2,45 assauts par heure. Un assaut toutes les 24 minutes et 24 secondes.
Vingt-quatre minutes. C’est le temps d’un épisode de série télé sans les publicités. Le temps de prendre une douche et de s’habiller. Le temps de préparer le souper. Des choses banales. Des choses quotidiques. Des choses ordinaires.
Mais à Pokrovsk, toutes les 24 minutes, ce n’est pas ordinaire. C’est un assaut. Des soldats russes qui avancent. Des soldats ukrainiens qui tirent. Des explosions. Des cris. Des morts. Puis le calme. Vingt-quatre minutes de calme. Puis ça recommence.
Dmytro
Appelons-le Dmytro. Il a 22 ans. Il est soldat dans l’armée ukrainienne depuis le début de la guerre. Enfin, « depuis le début » — ça fait 1461 jours. Quatre ans. Il avait 18 ans quand ça a commencé. Il était au cégep. Il voulait devenir ingénieur. Il ne sera jamais ingénieur.
Dmytro était à Pokrovsk hier. Il a participé à cinq des 59 assauts — cinq seulement, pas cinquante-neuf. Ça semble peu, non? Cinq assauts sur cinquante-neuf. Moins de 10%. Une minorité.
Après le premier assaut de la journée, les mains de Dmytro tremblaient — pas de peur, mais une adrénaline brute qui le traversait comme du courant électrique. Son corps entier vibrait comme une corde de guitare trop tendue. Il a essayé d’allumer une cigarette. Il a fallu trois allumettes. Ses doigts ne répondaient plus.
Le troisième assaut l’a vidé. Dmytro ne pouvait plus manger. Ses camarades avaient récupéré des rations. Du pain. Du fromage. Des trucs secs. Dmytro a essayé. Il a mâché. Mais son corps refusait d’avaler. Comme si son système digestif avait décidé que la nourriture n’était plus une priorité. Que la seule priorité était de survivre.
Au cinquième, Dmytro a perdu la sensation de ses jambes. Il marchait. Il bougeait. Mais il ne sentait rien. Comme si son cerveau avait coupé la connexion. Trop d’informations. Trop de douleur. Trop de tout. Alors le cerveau a fait ce qu’il fait quand il est submergé: il a éteint des parties non essentielles. Les jambes? Non essentielles. Tant qu’elles bougent, peu importe si on les sent.
Dmytro a survécu aux cinq assauts. Il est vivant. Pour l’instant. Mais il en reste 54 à compter. Cinquante-quatre autres assauts qui ont eu lieu hier à Pokrovsk. Cinquante-quatre fois où d’autres Dmytro ont tremblé, ont refusé de manger, ont perdu la sensation de leurs jambes. Cinquante-quatre fois où certains n’ont pas survécu.
Et pourtant — malgré cette accumulation inhumaine, Dmytro se lève chaque matin. Parce que la seule alternative est l’abandon. Et l’abandon signifierait que tout cela — chaque tremblement, chaque refus de manger, chaque perte de sensation — aurait été pour rien. Alors il se lève. Et il recommence.
Le silence entre deux assauts
Voici ce que le rapport ne dit pas: ce qui se passe entre les assauts. Dans ces 24 minutes entre le cinquième et le sixième assaut à Pokrovsk. Qu’est-ce qu’on fait pendant ces 24 minutes quand on sait que le prochain assaut arrive?
On ne dort pas. Impossible. Le corps est trop tendu. L’esprit trop alerte. On ne peut pas se permettre d’être pris au dépourvu.
On ne mange pas vraiment. Comme Dmytro. Le corps refuse.
On ne prie pas. Enfin, certains murmurent des paroles oubliées. Mais beaucoup ont dépassé le stade de la prière — non pas par perte de foi, mais par épuisement du recours. La prière, c’est pour quand on a encore de l’espoir. Après le cinquième assaut de la journée, l’espoir n’est plus le bon mot. Le bon mot, c’est détermination. Détermination de tenir. Pas parce qu’on croit qu’on va gagner. Mais parce qu’on refuse de perdre.
Alors qu’est-ce qu’on fait pendant ces 24 minutes? On attend. C’est tout. On attend. Et attendre, quand on sait ce qui vient, c’est peut-être pire que combattre. Parce que combattre, au moins, c’est actif. On fait quelque chose. On tire. On bouge. On crie. Mais attendre? Attendre, c’est passif. C’est subir le temps. Chaque seconde qui passe est une seconde de plus où on sait que ça va recommencer.
Vingt-quatre minutes d’attente. Mille quatre cent quarante secondes à compter. À écouter le silence. À guetter le bruit qui annonce le prochain assaut. Le bruit des moteurs. Le bruit des chenilles sur le sol gelé. Le bruit des explosions au loin qui se rapprochent.
Et puis ça recommence.
Les dix-sept villages
Le rapport de l’État-major liste les endroits précis où ont eu lieu les 59 assauts: Zatyshok, Rodynske, Myrnohrad, Pokrovsk, Kotlyne, Udachne, Novoserhiivka, Molodetske, Novomykolaivka, Dachne, Vilne, Bilytske, Nove Shakhove, Shevchenko, Novooleksandrivka, Serhiivka, Ivanivka.
Dix-sept noms sur une carte. Dix-sept villages et petites villes dans le secteur de Pokrovsk. Cinquante-neuf assauts répartis sur ces dix-sept endroits. Certains villages ont subi un seul assaut. D’autres cinq ou six. Le rapport ne précise pas la répartition. Il énumère juste les noms.
Mais derrière chaque nom, il y a une réalité. Zatyshok n’est pas juste un mot. C’est un endroit où des gens vivaient. Peut-être qu’ils vivent encore là. Peut-être qu’ils sont partis. Peut-être qu’ils sont morts. Le rapport ne le dit pas.
Chaque nom représente un choix. Le choix de rester ou de fuir. Le choix de défendre ou d’abandonner. Le choix de vivre dans une zone de guerre ou de tout laisser derrière et recommencer ailleurs. Des choix impossibles. Des choix que personne ne devrait avoir à faire.
Dix-sept noms. Cinquante-neuf assauts. Et derrière chaque assaut, des dizaines de soldats. Des centaines peut-être. Des milliers de balles tirées. Des centaines d’obus. Des dizaines d’explosions. Et au bout du compte, le rapport dit juste: « repoussés ». Repelled.
Les autres fronts

Le piège de la relativisation
Après avoir lu les chiffres de Pokrovsk — 59 assauts — les autres secteurs semblent presque… calmes. Kupiansk: 8 attaques. Lyman: 12 attaques. Kramatorsk: 3 attaques. Sloviansk: 11 attaques. Kostyantynivka: 13 attaques. Huliaipole: 19 attaques.
Huit attaques à Kupiansk. Après Pokrovsk, ça semble gérable. Presque tranquille. Trois attaques à Kramatorsk? C’est presque du repos.
Et c’est là que mon cerveau se fige. Parce que je viens de penser « seulement trois attaques ». Seulement. Comme si trois offensives militaires en une journée, c’était peu. Comme si c’était acceptable. Normal. Gérable.
Il y a quatre ans, trois attaques militaires sur une ville auraient fait les gros titres mondiaux. CNN aurait interrompu sa programmation. Le New York Times aurait sorti une édition spéciale. Les gens auraient été choqués. Horrifiés. Mobilisés.
Aujourd’hui, je lis « trois attaques » et je pense: « Pas si pire. » Et je me déteste pour avoir pensé ça. Parce que ça veut dire que j’ai banalisé. Que mon cerveau a accepté la guerre comme normale. Que je me suis habitué.
Les Dmytro invisibles
Huit attaques à Kupiansk. Ça ne veut pas dire huit soldats. Ça veut dire huit unités engagées. Chaque unité, c’est au minimum une vingtaine de combattants. Souvent plus. Disons 25 soldats par unité. Huit attaques fois 25 soldats. Ça fait 200 soldats minimum qui ont participé aux combats à Kupiansk hier.
Deux cents Dmytro. Deux cents jeunes hommes de 20, 22, 25 ans qui ont tremblé. Qui ont refusé de manger. Qui ont perdu la sensation de leurs jambes. Deux cents vies mises en danger. Deux cents familles qui attendaient un message. Un appel. N’importe quoi pour savoir s’ils étaient encore vivants.
Mais Kupiansk n’est pas Pokrovsk. Huit attaques, ce n’est pas 59. Alors on n’en parle pas. Alors ces 200 Dmytro tremblent dans le silence. Leurs familles attendent dans le silence. Et le monde continue de tourner sans savoir qu’ils existent.
C’est ça, la cruauté des statistiques. Elles créent une hiérarchie. Pokrovsk avec ses 59 assauts devient « l’épicentre ». Les autres secteurs deviennent « secondaires ». Mais pour les soldats qui y combattent, il n’y a rien de secondaire. Pour eux, leur combat est le seul qui compte. Le seul qui existe. Le seul qui pourrait les tuer.
L’addition qui dépasse tout
Mais voici ce que les titres ne disent pas. Voici ce qui se cache dans les détails du rapport. Additionnons les « autres » secteurs:
Kupiansk: 8 attaques. Lyman: 12. Sloviansk: 11. Kramatorsk: 3. Kostyantynivka: 13. Huliaipole: 19. Orikhiv: 2. Oleksandrivka: 5. Prydniprovske: 1. Kursk: 7.
Total: 81 attaques.
Quatre-vingt-une. Plus que Pokrovsk. Pokrovsk a eu 59 assauts. Les autres secteurs combinés: 81. Mais personne ne le dit comme ça. Parce que 81 attaques dispersées sur dix secteurs, ça ne fait pas un titre. Ça ne crée pas d’image claire. Ça ne se résume pas en une phrase.
Alors on dit: « L’épicentre est à Pokrovsk. » Et les 81 autres attaques deviennent invisibles. Les soldats qui les ont repoussées deviennent invisibles. Leurs tremblements, leur épuisement, leur peur — invisibles.
Et pourtant — ces 81 attaques invisibles représentent une réalité peut-être plus importante que Pokrovsk. Elles montrent que la guerre n’est pas concentrée en un point. Elle est partout. Elle est diffuse. Elle est inévitable. Et elle est invisible. C’est peut-être pire que d’avoir un épicentre. Parce que si le feu est partout, où peut-on se cacher?
C’est peut-être ça, la pire chose que fait cette guerre. Elle nous force à trier. À décider qu’un secteur est plus important qu’un autre. Qu’un soldat compte plus qu’un autre. Pas parce qu’on est cruels. Mais parce qu’on ne peut pas tout voir. Tout comprendre. Tout ressentir. Alors on simplifie. On hiérarchise. On dit: « Pokrovsk, c’est l’épicentre. » Et on oublie le reste.
Sloviansk : la femme et l'enfant
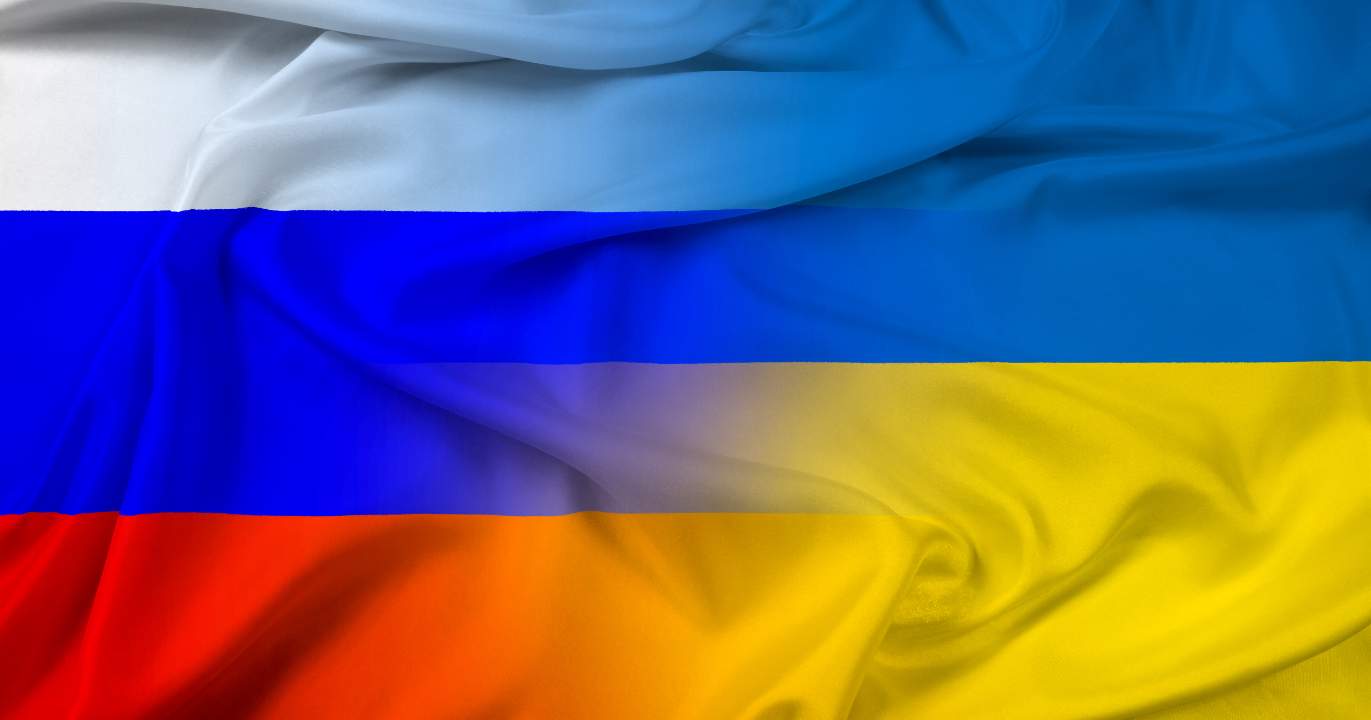
Une ligne qui pèse plus lourd que 205 combats
Au milieu du rapport militaire, entre les chiffres d’assauts et les listes de localités, il y a une ligne. Une seule ligne. Presque noyée dans le reste. Facile à manquer si on lit trop vite.
« Une femme et un enfant blessés à Sloviansk. »
Voilà. C’est tout. Pas de noms. Pas d’âges. Pas de détails. Juste: « une femme et un enfant ». Comme si c’étaient des catégories. Des statistiques. Des unités dans un tableau Excel.
Mais cette ligne. Cette ligne. Elle pèse plus lourd que les 205 combats. Plus lourd que les 4316 drones. Plus lourd que les 1250 soldats russes tués. Parce que cette ligne, c’est la preuve que malgré tous les efforts, malgré toute la défense, malgré tous les « repelled », la guerre trouve toujours un chemin vers les innocents.
Oksana et Mykola
On ne connaît pas leurs noms. Alors je vais leur en donner. Appelons la femme Oksana. C’est un nom ukrainien commun. Disons qu’elle a 34 ans. Qu’elle est mère de deux enfants. Qu’elle travaillait comme infirmière avant la guerre. Qu’elle a décidé de rester à Sloviansk parce que c’est chez elle. Parce que partir, c’est accepter que l’agresseur a gagné. Et elle refuse d’accepter ça.
L’enfant, appelons-le Mykola. Sept ans. Peut-être huit. Assez vieux pour comprendre qu’il y a une guerre. Assez jeune pour ne pas comprendre pourquoi. Il va à l’école quand l’école est ouverte. Il joue avec ses amis quand c’est possible. Il dessine des super-héros dans ses cahiers. Des super-héros qui arrêtent les missiles. Qui protègent les villes. Qui font que les guerres n’existent plus.
Hier, une frappe aérienne — ou un obus, ou un drone, peu importe — a atteint Oksana et Mykola. Le rapport ne précise pas les circonstances. Ce qui compte, c’est qu’ils ont été atteints. Qu’ils ont saigné. Qu’ils ont eu peur. Qu’ils ont peut-être cru qu’ils allaient mourir.
Oksana et Mykola n’existent peut-être pas exactement comme je les décris. Peut-être que la femme s’appelle Kateryna. Peut-être que l’enfant s’appelle Oleh. Peut-être qu’elle a 28 ans. Peut-être qu’il a 10 ans. Peu importe. Ce qui compte, c’est qu’une femme et un enfant existaient et que la guerre a changé qui ils sont.
La question sans réponse
Imaginez Mykola à l’hôpital. Ou dans une clinique. Ou chez lui si les blessures n’étaient pas assez graves pour nécessiter une hospitalisation. Il a mal. Il a peur. Il ne comprend pas ce qui s’est passé. Une minute, il était là, en train de faire quelque chose de normal — jouer, manger, regarder par la fenêtre. La minute suivante, il y a eu une explosion. Du bruit. De la douleur. Du sang.
Et Mykola demande: « Pourquoi? »
C’est la question que tous les enfants posent. Pourquoi? Pourquoi ça m’est arrivé? Pourquoi quelqu’un a voulu me faire mal? Pourquoi il y a une guerre?
Et Oksana, malgré ses propres blessures qui la brûlent, doit répondre avec une voix qu’elle ne reconnaît pas — celle d’une mère qui doit transformer l’horreur en mots qu’un enfant peut supporter. Elle doit trouver des mots pour expliquer l’inexplicable. « Parce qu’il y a une guerre, mon chéri. » Mais ça ne suffit pas. Mykola insiste: « Mais pourquoi il y a une guerre? »
Et là, Oksana se retrouve face à l’impossibilité. Comment expliquer à un enfant de sept ans que des hommes qu’il ne connaîtra jamais, dans un pays qu’il n’a jamais visité, ont décidé d’envahir son pays? Comment expliquer les concepts de territoire, de pouvoir, d’impérialisme? Comment expliquer que certains humains sont capables de décider que d’autres humains — des femmes, des enfants — sont des dommages collatéraux acceptables?
Il n’y a pas de réponse qu’un enfant de sept ans puisse comprendre. Parce qu’il n’y a pas de réponse qui ait du sens. Même pour les adultes. Même pour moi, à 40 ans, en train d’écrire ce texte à Montréal, à des milliers de kilomètres de Sloviansk. Je ne comprends pas. Je peux analyser. Je peux contextualiser. Je peux expliquer les mécanismes géopolitiques. Mais comprendre? Non. Parce que comprendre impliquerait que ça ait un sens. Et ça n’en a pas.
La cicatrice permanente
Le rapport dit « blessés ». Pas « tués ». Alors Oksana et Mykola ont survécu. Ils sont vivants. Et c’est une bonne nouvelle, non? Ils ne sont pas morts. Ils vont guérir. Ils vont continuer leur vie.
Mais voici ce que « blessés » ne révèle pas. Mykola aura huit ans avec une cicatrice. Peut-être sur le bras. Peut-être sur la jambe. Peut-être sur le visage. Une marque physique qui restera. Chaque fois qu’il se regardera dans un miroir, il verra cette cicatrice. Et il se souviendra.
Il aura neuf ans avec un souvenir. Le souvenir de l’explosion. Du bruit. De la douleur. De la peur. De sa mère qui saignait. Des cris. Des larmes. Ce souvenir ne partira jamais. Il s’estompera peut-être. Mais il ne partira jamais.
Il aura dix ans avec une question. Pourquoi? Cette interrogation le suivra toute sa vie. À dix ans. À vingt ans. À quarante ans. Pourquoi est-ce que ça m’est arrivé? Pourquoi est-ce que quelqu’un a voulu me faire mal? Pourquoi est-ce que le monde permet ça?
Il portera toute une vie la conscience que le monde n’est pas sûr. Que le ciel peut exploser à tout moment. Que les adultes ne peuvent pas toujours protéger. Que même chez soi, dans sa propre ville, on n’est pas à l’abri. Cette conscience changera qui il est. Elle influencera chaque décision qu’il prendra. Chaque relation qu’il construira. Chaque moment de bonheur sera teinté par cette prise de conscience.
Alors oui, Mykola a survécu. Mais « survivre » et « vivre » ne sont pas la même chose. Et le rapport qui dit simplement « blessés » ne capture pas ça. Ne peut pas capturer ça.
Je pense à Mykola. À cet enfant que je ne connais pas. Qui a peut-être un autre nom. Un autre âge. Mais qui existe. Quelque part à Sloviansk, il y a un enfant qui a été atteint hier. Et je sais qu’il va grandir avec cette blessure. Pas juste la blessure physique. La blessure existentielle. La blessure de savoir que le monde peut te faire mal sans raison. Sans que tu aies fait quoi que ce soit de mal. Juste parce que tu existes. Juste parce que tu es né au mauvais endroit au mauvais moment. Et je me demande: quand il aura mon âge, quand il regardera en arrière sur sa vie, qu’est-ce qu’il pensera de nous? De moi? De tous ceux qui savaient et qui n’ont pas pu — ou pas voulu — arrêter ça?
Zaporizhzhia : la multiplication des Oksana

Six civils atteints
À Sloviansk: une femme et un enfant atteints. À Zaporizhzhia: six civils atteints. Six. Le chiffre a doublé. Puis triplé. Six vies touchées. Six personnes qui, hier matin, se sont réveillées en pensant que c’était une journée normale. Aussi normale qu’une journée peut l’être dans une zone de guerre. Et qui, hier soir, étaient à l’hôpital. Ou dans une clinique. Ou chez elles avec des bandages. Ou peut-être pires.
Six Oksana. Six Mykola. Six « pourquoi ». Six cicatrices. Six souvenirs qui ne partiront jamais. Six vies changées à jamais par quelques secondes de violence aveugle.
Le ratio impossible
Le rapport dit: 668 attaques sur la région de Zaporizhzhia en 24 heures. Six cent soixante-huit. C’est plus que le nombre total de combats sur l’ensemble du front (205). C’est treize fois plus que le nombre d’assauts à Pokrovsk (59). Six cent soixante-huit attaques sur une seule région.
Et six civils atteints. Seulement six.
Faisons le calcul. 668 attaques. 6 atteints. Ça fait un civil touché toutes les 111 attaques. Un ratio de 1:111. Sur le papier, ça semble… bon? Comme si la défense aérienne ukrainienne faisait un travail incroyable. Comme si les civils étaient bien protégés. 111 attaques pour un seul atteint. C’est presque miraculeux.
Mais ce n’est pas un miracle. C’est une statistique. Et les statistiques, c’est juste une façon de compter jusqu’à ce que les chiffres basculent. Aujourd’hui, c’est 1:111. Demain, ce sera peut-être 1:50. Ou 1:10. Ou 1:1. Les statistiques ne protègent personne. Elles décrivent juste ce qui s’est passé. Pas ce qui va se passer.
Et un jour — peut-être demain, peut-être dans une semaine — le ratio va basculer. Pas parce que la défense aérienne aura échoué. Mais parce que 668 attaques, c’est trop. Parce qu’on ne peut pas arrêter 668 missiles, 668 drones, 668 obus. Pas tous. Pas à chaque fois. Et quand on en rate un, ça suffit. Un seul suffit pour transformer une famille en statistique.
La géographie de la cible
Le rapport dit: « 668 attaques sur la région de Zaporizhzhia ». Pas sur des bases militaires. Pas sur des dépôts d’armes. Pas sur des positions fortifiées. Sur « la région ». Sur des zones peuplées. Sur des endroits où des gens vivent.
Zaporizhzhia, ce n’est pas un champ de bataille. C’est une ville. Une vraie ville avec des immeubles d’appartements, des écoles, des hôpitaux, des supermarchés, des parcs. Des gens y vivent. Des familles. Des enfants. Des vieux. Des gens ordinaires qui essaient de vivre des vies ordinaires dans des circonstances qui ne le sont pas.
Et sur cette ville, sur ces gens, il y a eu 668 attaques en 24 heures. Six cent soixante-huit fois où quelqu’un, quelque part en Russie, a appuyé sur un bouton, a programmé une coordonnée, a lancé un missile, sachant très bien que cette coordonnée correspondait à un endroit où des civils vivent. Sachant très bien que même si la cible était « militaire », les civils autour allaient souffrir.
Ce n’est pas de la guerre. C’est de la terreur. C’est l’utilisation systématique de la violence contre des populations civiles pour les forcer à se soumettre. Ça a un nom: terrorisme d’État. Mais on ne l’appelle pas comme ça. On dit « attaques ». « Frappes ». « Bombardements ». Des mots propres. Des mots techniques. Des mots qui cachent la réalité: des gens qui essaient de tuer d’autres gens pour leur faire peur.
Le silence des 662 autres
Six civils atteints à Zaporizhzhia. Le rapport le dit. C’est documenté. Vérifié. Réel.
Mais voici la question que le rapport ne pose pas: combien des 668 attaques ont raté leur cible? Combien de missiles sont tombés dans des champs vides? Combien dans des bâtiments abandonnés? Combien dans des maisons vides?
Et surtout: combien sont tombés dans des maisons qui n’étaient pas vides, mais où personne n’a survécu pour être compté?
Parce que « six civils atteints », ça compte les survivants. Ça ne compte pas les morts. Le rapport ne dit pas: « six civils atteints et X décédés ». Il dit juste: « six civils atteints ». Comme si c’était le total. Comme si c’était tout.
Mais nous savons tous — vraiment, nous savons tous — que ce n’est pas tout. Que derrière ces six atteints, il y a peut-être des décédés qu’on n’a pas encore comptés. Ou qu’on ne comptera jamais. Parce que certaines maisons s’effondrent complètement. Parce que certains corps ne sont jamais retrouvés. Parce que certaines familles disparaissent entièrement et il n’y a personne pour signaler leur absence.
Alors quand je lis « six civils atteints », je me demande: combien ne sont pas dans ce chiffre? Combien de morts invisibles? Combien de disparus? Combien de gens dont on ne saura jamais qu’ils ont existé?
Repelled : le mot qui résiste

Huit fois
Le mot apparaît huit fois dans le rapport. « Repelled ». Repoussé. Huit fois où l’État-major ukrainien dit: « Ils ont attaqué. On les a empêchés. » Huit fois où l’armée russe a essayé de prendre du terrain et a échoué. Huit petites victoires dans un océan de violence.
Kupiansk: repelled. Lyman: repelled. Sloviansk: repelled. Kramatorsk: repelled. Pokrovsk: repelled. Huliaipole: repelled. Orikhiv: repelled. Prydniprovske: repelled.
Huit fois le même mot. Répété comme un mantra. Comme une affirmation: « Nous tenons. »
Ce que « repelled » ne dit pas
« Repelled » ne veut pas dire « gagné ». Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de pertes. Ça ne veut pas dire que c’était facile. Ça ne veut pas dire qu’on peut recommencer demain sans conséquences.
« Repelled » veut dire: « Ils ont essayé de prendre. On les a empêchés. Pour aujourd’hui. »
Pour aujourd’hui. C’est ça, le mot clé. Pour aujourd’hui. Pas pour toujours. Pas définitivement. Juste pour aujourd’hui. Demain, ils reviendront. Et il faudra les repousser encore. Et après-demain. Et le jour suivant. Encore et encore et encore jusqu’à ce que… jusqu’à quoi? Jusqu’à ce qu’ils arrêtent d’attaquer? Jusqu’à ce qu’on n’ait plus la force de repousser? Personne ne sait.
« Repelled » est un mot militaire. Propre. Technique. Neutre. Il décrit un résultat sans décrire le processus. Il dit « on a repoussé » sans dire comment. Sans dire à quel prix. Sans dire ce que ça coûte, physiquement et psychologiquement, de repousser une offensive. Puis une autre. Puis une autre. Huit fois en une journée.
L’héroïsme comme routine
Quelque part dans ces huit « repelled », il y a Dmytro. Il ne sait pas qu’il est dans un rapport. Il ne sait pas qu’un chroniqueur à Montréal écrit sur lui. Il ne sait pas que son action — repousser une offensive — est devenue une ligne dans un document officiel. Il sait juste qu’ils ont essayé de passer. Et qu’ils n’ont pas passé. Et qu’ils reviendront.
Pour Dmytro, « repelled » n’est pas une victoire. C’est juste… ce qu’il fait. C’est son travail. Sa mission. Son quotidien. Repousser. Tenir. Survivre. Recommencer.
Et c’est peut-être ça, le plus tragique: que l’héroïsme quotidien se soit érodé en routine, chaque acte de bravoure perdant sa radiance sous le poids de la répétition. Que des actes qui mériteraient des médailles, des parades, des reconnaissances nationales soient réduits à un mot dans un rapport quotidien. « Repelled. » Comme on dirait « pluie » dans un bulletin météo. Factuel. Attendu. Banal.
Mais il n’y a rien de banal dans ce que Dmytro a fait. Rien de banal dans le fait de tenir une position sous le feu. Rien de banal dans le fait de voir l’ennemi avancer et de décider: « Non. Pas aujourd’hui. Pas ici. » Rien de banal dans le courage qu’il faut pour faire ça une fois. Encore moins pour le faire huit fois en une journée. Encore moins pour le faire jour après jour pendant 1461 jours.
Le poids du mot
Repelled. Six lettres. Un mot court. Simple. Direct.
Mais derrière ces six lettres, il y a des heures de combat. Des centaines de balles tirées. Des dizaines d’obus lancés. Des explosions. Des cris. De la fumée. Du sang. De la sueur. Des larmes. De la peur. De la détermination. Du refus de reculer même quand chaque fibre de ton corps te dit de courir.
Derrière ces six lettres, il y a la décision de ne pas abandonner. La décision de tenir même quand tenir semble impossible. La décision de dire « non » à l’agresseur. Encore et encore et encore.
Derrière ces six lettres, il y a l’essence même de ce que signifie défendre. Pas attaquer. Pas conquérir. Défendre. Protéger. Tenir. Parce que derrière cette ligne qu’on défend, il y a des gens. Des familles. Des villes. Un pays. Une vie.
Repelled. Six lettres pour dire: « Nous tenons. » Trois mots pour dire: « Vous ne passerez pas. » Une phrase pour dire: « Nous sommes encore là. »
Chaque fois que je lis « repelled » dans ce rapport, je sens quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la tristesse. Pas de la peur. Quelque chose de plus complexe. Un mélange d’admiration et de douleur. Admiration pour ces hommes qui tiennent. Douleur de savoir qu’ils doivent tenir. Qu’ils n’ont pas le choix. Que personne ne viendra les relever. Que demain, ils devront recommencer. Et qu’un jour, peut-être, « repelled » sera remplacé par un autre mot. Un mot qu’on ne veut pas lire. Alors je m’accroche à ces huit « repelled ». Je les compte comme des victoires. Parce que c’est tout ce qu’on a. Huit petites victoires dans un océan de violence. Huit preuves que la résistance existe encore. Huit raisons de ne pas abandonner l’espoir.
1250 : l'autre compteur
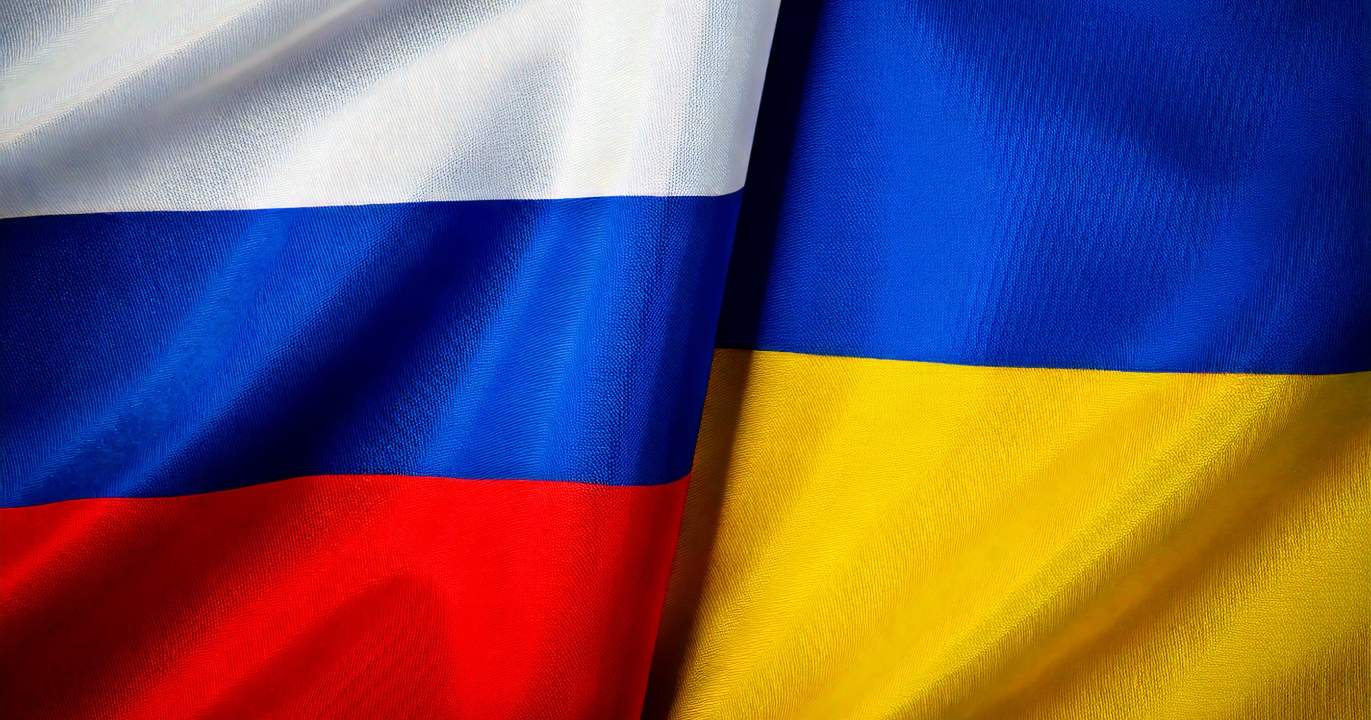
Le chiffre qui soulage et qui dérange
1250 soldats russes tués hier. Mille deux cent cinquante. En une seule journée. C’est le chiffre officiel publié par l’État-major ukrainien. Et quand je le lis, deux choses me traversent simultanément. Deux choses contradictoires. Deux choses qui ne devraient pas coexister mais qui coexistent quand même.
D’abord, un soulagement froid qui arrive comme une gifle — presque honteux dans son calcul — parce que chaque soldat russe mort, c’est un jour de plus où Dmytro pourrait survivre. 1250 soldats russes morts, c’est 1250 soldats qui n’attaqueront plus. 1250 soldats qui ne lanceront plus d’offensives. 1250 menaces en moins. 1250 raisons pour lesquelles Dmytro pourrait peut-être survivre un jour de plus. C’est cynique. C’est terrible. Mais c’est vrai.
Ensuite, un malaise. Profond. Viscéral. Parce que 1250, ce ne sont pas des numéros. Ce sont des hommes. Des humains. Des fils, des frères, des pères, des maris. 1250 familles russes qui vont recevoir — peut-être — une lettre. Ou peut-être pas. 1250 mères qui vont pleurer. Ou qui pleurent déjà sans savoir.
L’humanité de l’ennemi
Voici le problème avec la guerre: elle nous force à déshumaniser. Parce que si on humanise l’ennemi, si on le voit comme une personne avec une vie, une famille, des rêves, alors on ne peut plus le combattre. Alors on dit « l’ennemi ». « L’agresseur ». « L’envahisseur ». Des mots qui créent de la distance. Qui transforment des humains en concepts.
Mais 1250 soldats russes morts, ce sont 1250 hommes qui, il y a quelques années, étaient des adolescents. Qui allaient à l’école. Qui avaient des amis. Qui tombaient amoureux. Qui rêvaient d’avenir. Des hommes qui, pour beaucoup, n’ont pas choisi cette guerre. Qui ont été appelés. Enrôlés. Forcés. Ou convaincus par la propagande qu’ils défendaient leur pays.
Certains croyaient peut-être vraiment à la « mission ». Certains pensaient peut-être qu’ils libéraient l’Ukraine. Certains étaient peut-être des fanatiques. Mais d’autres — combien? — étaient juste des gamins qui voulaient survivre. Qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Qui appelaient leur mère en cachette pour lui dire qu’ils avaient peur.
Et maintenant, ils sont morts. 1250 en une journée. Et je ne sais pas comment me sentir par rapport à ça.
Le ratio moral
Le rapport ukrainien ne mentionne pas de pertes ukrainiennes. Pas de chiffre de soldats ukrainiens tués. Peut-être parce que c’est une information militaire sensible. Peut-être parce que le chiffre est trop douloureux à publier. Peut-être parce que les familles n’ont pas encore été informées.
Alors on a juste un côté de l’équation: 1250 soldats russes morts. Et on est censé voir ça comme une bonne nouvelle. Comme une victoire. Plus de pertes russes que de pertes ukrainiennes, ça veut dire que l’Ukraine gagne, non?
Mais gagner quoi? Gagner le droit de continuer à se battre demain? Gagner le droit de repousser encore 205 combats après-demain? Gagner le droit de compter encore 1250 morts russes le jour suivant?
Ce n’est pas une victoire. C’est une survie. Une survie qui se compte en cadavres. Une survie qui se mesure en combien de l’autre meurt avant que nous mourions. Et appeler ça une victoire, c’est accepter que la guerre soit devenue notre normalité. Notre façon de mesurer le succès.
La question interdite
Voici la question que personne ne veut poser: combien de morts russes avant que ça s’arrête?
1250 par jour. Multiplié par 1461 jours depuis le début de la guerre. Ça ferait 1,826,250 morts. Mais le rapport dit: 1,253,270 pertes russes totales depuis le début. Soit une différence de 573,000. Ce qui veut dire qu’il y a eu des jours avec moins de 1250 morts. Beaucoup de jours. Des jours où les Russes ont perdu 500 soldats. Ou 800. Ou 300.
Mais la tendance est claire: les pertes augmentent. Plus la guerre dure, plus elle tue. 1250 aujourd’hui. Combien demain? 1300? 1500? À quel chiffre l’armée russe dira: « C’est trop. On arrête »?
Parce que jusqu’à maintenant, aucun chiffre n’a été assez élevé. 1,253,270 morts, et ils continuent d’attaquer. 205 combats par jour, et ils continuent d’envoyer des soldats. 59 assauts repoussés à Pokrovsk, et ils recommenceront demain.
Alors combien? 1,500,000? 2,000,000? 3,000,000? À quel moment la mort devient-elle trop chère? À quel moment l’arithmétique de l’horreur devient-elle insoutenable même pour ceux qui la perpétuent?
Je n’ai pas de réponse. Personne n’en a. Et c’est peut-être ça, le plus terrifiant. Que nous soyons tous en train de regarder ce compteur monter — 1,253,270… 1,253,271… 1,253,272… — sans savoir où il s’arrêtera. Ou s’il s’arrêtera.
Le total : 1,253,270

Le nombre qui refuse d’exister
1,253,270. Un million deux cent cinquante-trois mille deux cent soixante-dix. Pertes militaires russes totales depuis le 24 février 2022. C’est le chiffre officiel. Documenté. Vérifié autant que possible dans le brouillard de la guerre.
Et mon cerveau refuse de le traiter. Refuse de l’accepter. Refuse de comprendre ce qu’il signifie. Parce qu’un million, c’est trop grand. C’est au-delà de l’échelle humaine. Au-delà de ce que notre cerveau peut vraiment saisir.
Essayons quand même. Essayons de donner un sens à ce nombre impossible.
Visualiser l’invisible
1,253,270 personnes. Si on les alignait, une derrière l’autre, en supposant qu’une personne prend environ un mètre d’espace, la file ferait 1253 kilomètres. De Kyiv à Paris. De Montréal à Miami. De Vancouver à Calgary et retour.
Si on lisait un nom par seconde — juste le nom, rien d’autre — il faudrait 1,253,270 secondes. Ça fait 20,888 minutes. Ça fait 348 heures. Ça fait 14 jours et 12 heures. Deux semaines complètes. Sans dormir. Sans manger. Sans pause. Juste lire des noms. Deux semaines pour nommer les morts.
Si on organisait une cérémonie pour chacun — juste 30 minutes — il faudrait 37,598,100 minutes. Ça fait 626,635 heures. Ça fait 26,110 jours. Ça fait 71,5 ans. Une vie humaine entière juste pour honorer les morts d’une seule guerre.
La courbe de la mort
Mais voici ce qui est encore plus terrifiant que le chiffre total: la courbe. L’accélération. La façon dont le compteur monte de plus en plus vite.
Le 24 février 2022, le jour de l’invasion: 0 morts. Le 24 février 2023, un an plus tard: environ 150,000 morts russes. Le 24 février 2024, deux ans plus tard: environ 400,000. Le 24 février 2025, trois ans plus tard: environ 800,000. Le 15 février 2026, presque quatre ans plus tard: 1,253,270.
Regardez la progression. La première année: 150,000 morts. La deuxième année: 250,000 morts supplémentaires. La troisième année: 400,000 morts supplémentaires. La quatrième année n’est même pas terminée et on est déjà à plus de 450,000 morts supplémentaires.
La guerre ne ralentit pas. Elle accélère. Plus elle dure, plus elle tue. Plus elle tue, plus elle devient brutale. Plus elle devient brutale, plus elle tue. C’est une spirale. Une spirale descendante vers… vers quoi? Vers combien de morts avant que ça devienne insoutenable?
L’humanisation impossible
1,253,270 soldats russes. Combien avaient 20 ans? Combien avaient 40 ans? Combien étaient des appelés forcés? Combien étaient des volontaires? Combien croyaient à la « mission »? Combien voulaient juste rentrer chez eux?
Combien ont appelé leur mère une dernière fois? Combien ont écrit une lettre qu’ils n’ont jamais eu le temps d’envoyer? Combien ont pensé à leur femme, leurs enfants, leur vie d’avant dans leurs derniers instants?
On ne peut pas répondre à ces questions. On ne peut pas humaniser 1,253,270 personnes. Le cerveau humain n’est pas conçu pour ça. On peut humaniser une personne. Peut-être dix. Peut-être cent si on fait un effort. Mais un million? Impossible.
Alors le chiffre devient abstrait. Il devient une statistique. Un nombre dans un rapport. Une ligne dans un tableau Excel. Et c’est peut-être ça, la vraie tragédie. Pas juste que 1,253,270 personnes soient mortes. Mais qu’on ne puisse même pas les pleurer individuellement. Qu’on soit forcés de les réduire à un nombre. Parce qu’on n’a pas d’autre choix. Parce que notre humanité a des limites.
La question sans fond
1,253,270 morts. Et la guerre continue. Les attaques continuent. Les combats continuent. Le compteur continue de monter.
Alors voici la question: à quel chiffre ça s’arrête? 1,500,000? 2,000,000? 3,000,000? À quel moment l’humanité — pas juste la Russie, pas juste l’Ukraine, mais l’humanité entière — regarde ce chiffre et dit: « Stop. Ça suffit. Plus jamais »?
Parce que jusqu’à maintenant, aucun chiffre n’a été assez élevé. Six millions de Juifs morts pendant l’Holocauste, et on a dit « plus jamais ». Puis il y a eu le Rwanda. Puis la Bosnie. Puis la Syrie. Puis l’Ukraine. À chaque fois, on dit « plus jamais ». Et à chaque fois, ça recommence.
Alors peut-être que la vraie question n’est pas « à quel chiffre ça s’arrête? ». Peut-être que la vraie question est: « Est-ce qu’il existe un chiffre assez élevé pour que ça s’arrête? »
Et pourtant — même en face de cette question sans réponse, même en face de cette courbe de mort qui n’a pas de limite apparente, il y a encore des gens qui se battent. Qui refusent. Qui disent non. Dmytro continue de se lever. Les défenses aériennes continuent de tirer. Les civils continuent de vivre. Ce n’est pas de l’optimisme. C’est de la résistance. Et peut-être que c’est ça, la vraie réponse. Pas un chiffre qui arrête tout. Mais le refus de laisser le chiffre devenir normal.
Demain, 206

Le cycle qui ne se brise pas
Demain, il y aura un nouveau rapport. L’État-major ukrainien publiera les chiffres. Peut-être 206 combats. Peut-être 198. Peut-être 230. Le chiffre changera. Mais la réalité, elle, ne changera pas.
Demain, Dmytro se réveillera — s’il a réussi à dormir. Il mettra son uniforme. Il prendra son arme. Il retournera à sa position. Et il attendra. Parce que les assauts viendront. Peut-être cinq comme hier. Peut-être dix. Peut-être un seul, mais ce sera peut-être celui de trop.
Demain, les drones reviendront. Peut-être 4000. Peut-être 5000. Un toutes les 20 secondes. Ou toutes les 15. Le sifflement continuera. Les plongeons continueront. Les explosions continueront. La terreur continuera.
Mykola qui grandit
Demain, Mykola — l’enfant atteint à Sloviansk — se réveillera avec sa cicatrice. Elle lui fera peut-être mal. Peut-être pas. Mais elle sera là. Visible. Permanente. Un rappel physique que le monde n’est pas sûr.
Dans un an, Mykola aura huit ans. La cicatrice sera toujours là. Peut-être qu’il aura oublié certains détails de l’explosion. Le bruit exact. La couleur du ciel. Mais il n’oubliera jamais la peur. La sensation de ne pas être en sécurité. La conscience que le ciel peut tomber à tout moment.
Dans dix ans, Mykola aura 17 ans. Presque adulte. La guerre sera peut-être finie. Peut-être pas. Mais la cicatrice sera toujours là. Et avec elle, toutes les questions. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que le monde a permis ça?
Dans vingt ans, Mykola aura 27 ans. Il aura peut-être une famille. Des enfants. Et un jour, un de ses enfants lui demandera: « Papa, c’est quoi cette cicatrice? » Et Mykola devra décider quoi répondre. Dire la vérité? Raconter l’horreur? Ou protéger son enfant en mentant? Et il se demandera si ce mensonge sera vraiment une protection, ou juste un autre poids à porter.
La guerre ne finit pas quand les combats s’arrêtent. Elle continue dans les cicatrices. Dans les souvenirs. Dans les questions sans réponse. Dans les vies changées à jamais. Mykola portera cette guerre toute sa vie. Même si elle se termine demain.
Le refus de la normalisation
Voici ce que je veux dire. Ce que j’ai besoin de dire. Ce que ce texte entier essaie de dire:
Ne laissez pas 205 combats devenir acceptables. Ne laissez pas ces chiffres — 205, 4316, 1250, 1,253,270 — devenir juste des nombres. Ne laissez pas « une femme et un enfant atteints » devenir une ligne qu’on survole en lisant.
Parce que le jour où on s’habitue aux chiffres, c’est le jour où on oublie qu’ils représentent des vies. Des vraies vies. Des Dmytro qui tremblent. Des Oksana qui attendent. Des Mykola qui portent des cicatrices.
Le jour où on lit « 205 combats » et qu’on pense « pas si pire que la semaine dernière », c’est le jour où on a perdu. Pas militairement. Humainement. C’est le jour où on a accepté que la guerre soit normale. Que la violence soit acceptable. Que les morts soient juste des statistiques.
Et je refuse ça. Je refuse d’accepter que 205 combats en 24 heures soit normal. Je refuse d’accepter que 4316 drones en une journée soit normal. Je refuse d’accepter qu’un enfant de sept ans porte une cicatrice de guerre soit normal.
Le regard qu’on ne peut pas détourner
Ce texte ne vous demandera pas de donner de l’argent. Il ne vous demandera pas de partager sur les réseaux sociaux. Il ne vous demandera pas de contacter vos députés. Il ne vous demandera pas de faire quoi que ce soit de concret.
Il vous demandera juste une chose: ne détournez pas le regard.
Quand vous lisez « 205 combats », prenez une seconde pour réaliser ce que ça signifie. Deux cent cinq fois où des hommes se sont battus. Deux cent cinq fois où quelqu’un a risqué sa vie. Deux cent cinq fois où quelqu’un a peut-être perdu la sienne.
Quand vous lisez « une femme et un enfant atteints », prenez une seconde pour imaginer cette femme. Cet enfant. Leurs visages. Leur peur. Leur douleur. Ne les réduisez pas à une statistique.
Quand vous lisez « 1,253,270 pertes », prenez une seconde pour essayer — même si c’est impossible — de réaliser que ce sont des vies. Un million de vies. Chacune unique. Chacune importante. Chacune irremplaçable.
Et si vous le faites — si vous prenez juste une seconde pour regarder vraiment ces chiffres, pour voir les vies derrière les nombres — alors peut-être que quelque chose change. Pas dans le monde. Le monde continuera de tourner. Les combats continueront. Les drones continueront de siffler. Mais quelque chose change en vous. Vous refusez un peu plus la normalisation. Vous gardez un peu plus d’humanité. Vous vous souvenez un peu plus que derrière chaque chiffre, il y a quelqu’un. Quelqu’un qui a une mère. Quelqu’un qui a des rêves. Quelqu’un qui voulait vivre. Et peut-être que si assez de gens font ça, si assez de gens gardent cette humanité, alors un jour, le compteur s’arrêtera. Pas parce que les gouvernements décideront d’arrêter. Mais parce que le peuple aura décidé que c’était assez. Que 205 combats, ce n’était jamais acceptable. Que 1,253,270 morts, c’était déjà trop. Que jamais, au grand jamais, ça ne redevient normal.
Conclusion : Ce que les chiffres ne diront jamais

L’addition qui ne compte pas
205 + 52 + 170 + 4316 + 2875 + 1250 + 1,253,270.
Si on additionne tous les chiffres du rapport, on arrive à 1,262,138. Un million deux cent soixante-deux mille cent trente-huit. Presque un million et quart. Presque un chiffre assez gros pour que notre cerveau arrête de le traiter comme une réalité et commence à le traiter comme une abstraction.
Mais cette addition est trompeuse. Parce qu’elle mélange des choses qui ne devraient pas être mélangées. Elle ajoute des combats à des drones. Des drones à des morts. Des morts à des atteints. Comme si c’était tout la même chose. Comme si on pouvait réduire toute une guerre à une seule addition.
On ne peut pas. Parce que un drone n’égale pas un mort. Un combat n’égale pas une cicatrice. Un chiffre n’égale jamais la réalité qu’il représente.
Ce qui reste
Quand on retire tous les chiffres, quand on enlève les 205, les 4316, les 1,253,270, qu’est-ce qui reste?
Il reste Dmytro. Il reste Oksana. Il reste Mykola avec sa cicatrice. Il reste les dix-sept villages du secteur de Pokrovsk. Il reste les défenses aériennes qui tirent encore. Il reste les tranchées où les hommes attendent. Il reste le silence entre deux assauts. Il reste les questions sans réponse.
Il reste une guerre qui ne finit pas. Qui n’a jamais fini. Qui ne finira peut-être jamais.
Le refus final
Je refuse de terminer ce texte avec un message d’espoir. Je refuse de dire « tout va s’arranger » ou « l’Ukraine va gagner » ou « la paix viendra bientôt ». Parce que je ne sais pas si c’est vrai. Et mentir, ce serait insulter Dmytro. Insulter Mykola. Insulter tous ceux qui vivent cette réalité.
Mais je refuse aussi de terminer avec du désespoir. De dire « c’est fini » ou « c’est perdu » ou « il n’y a rien à faire ». Parce que ce serait aussi un mensonge. Parce que tant qu’il y a des gens qui se battent, tant qu’il y a des gens qui refusent, tant qu’il y a des gens qui se lèvent chaque matin et disent « non », il y a quelque chose. Pas de l’espoir. De la résistance.
Et peut-être que c’est ça, la vraie réponse. Pas un message optimiste. Pas une promesse de victoire. Juste: la résistance continue. Et tant qu’elle continue, le compteur n’a pas gagné. Les chiffres n’ont pas gagné. La guerre n’a pas gagné.
Parce que la guerre, c’est quand les chiffres deviennent plus importants que les vies. Quand on regarde 205 combats et on ne pense qu’au nombre. Quand on voit 1,253,270 morts et on calcule qui gagne. Quand on réduit Dmytro à une unité militaire. Quand on réduit Mykola à une statistique de civils atteints.
La résistance, c’est quand on refuse ça. Quand on regarde ces chiffres et on voit les vies. Quand on se souvient que derrière chaque nombre, il y a quelqu’un. Quand on refuse de normaliser. Quand on refuse d’accepter que ça soit normal.
Voilà. C’est tout ce que ce texte peut faire. Rappeler. Refuser. Résister.
Signé Maxime Marquette
Encadré de transparence du chroniqueur
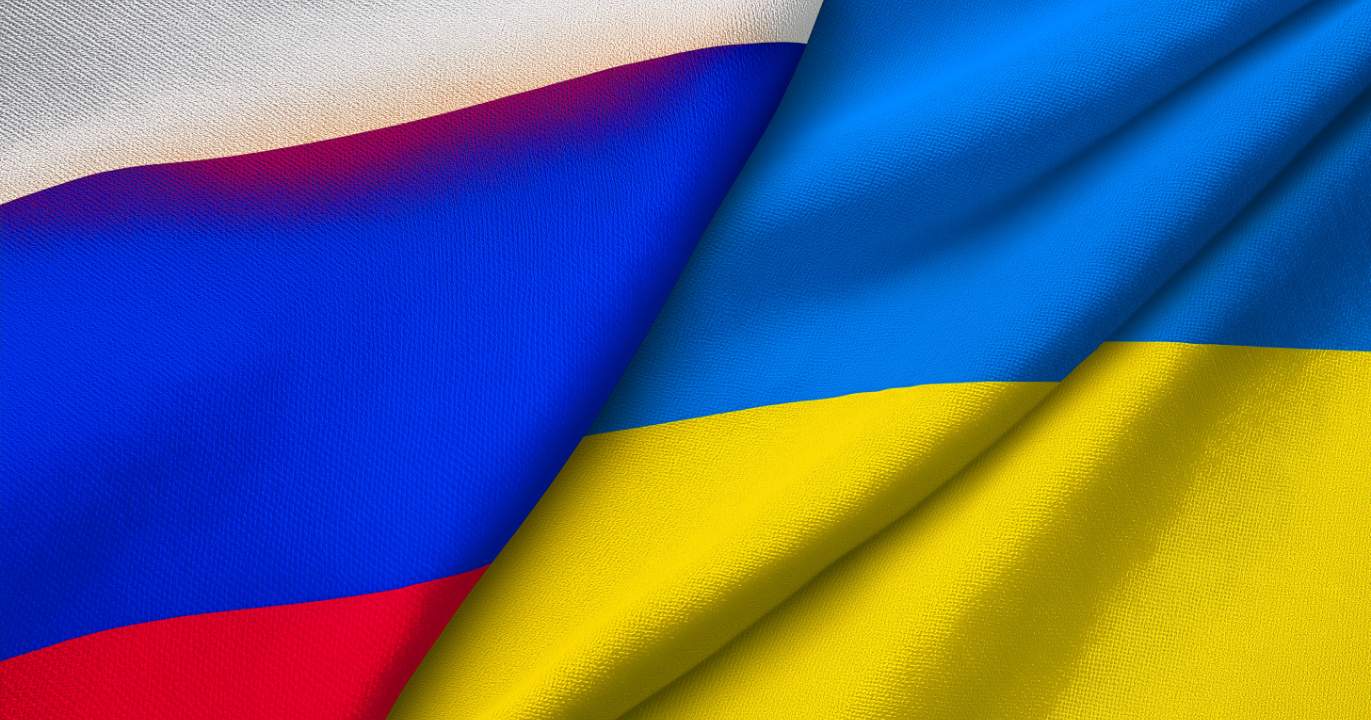
Positionnement éditorial
Je suis chroniqueur et analyste, pas journaliste de terrain. Ma posture éditoriale est claire: je refuse la neutralité face à une guerre d’agression. Les faits présentés dans cet article proviennent de sources officielles ukrainiennes et internationales vérifiées. Cependant, l’analyse qui accompagne ces faits est subjective, ancrée dans une perspective humaniste qui privilégie la vie civile et le refus de la normalisation de la violence.
Je distingue clairement entre les faits objectifs (les chiffres du rapport de l’État-major, les localités mentionnées) et mon interprétation personnelle de ces faits (les portraits de Dmytro, Oksana et Mykola, les réflexions sur la signification des chiffres). Cette distinction est volontaire et transparente.
Méthodologie et sources
Les données chiffrées proviennent directement du rapport de l’État-major général des forces armées ukrainiennes publié le 15 février 2026. Ce rapport est vérifié quotidiennement par des organisations internationales et des médias indépendants. Les localités mentionnées correspondent aux zones de combat documentées par Ukrinform et d’autres agences de presse ukrainiennes.
Les portraits de personnages (Dmytro, Oksana, Mykola) ne sont pas basés sur des individus spécifiques identifiés, mais plutôt sur des composites construits à partir de récits de soldats, de civils et de témoignages publics. Ils visent à humaniser les statistiques, non à inventer des faits.
Nature de l’analyse
Cet article est une analyse d’opinion fondée sur des faits vérifiés. Il ne prétend pas à l’objectivité journalistique — il assume explicitement une perspective critique face à la normalisation de la guerre. L’article sera mis à jour ou révisé si les données sources changent significativement ou si des informations contradictoires vérifiées émergent.
Sources
Sources primaires
État-major général des forces armées ukrainiennes — Rapports quotidiens sur les opérations militaires (février 2026)
Données géographiques: OpenStreetMap, sources officielles ukrainiennes sur la démographie des villes mentionnées
Sources secondaires
Médias internationaux couvrant le conflit: BBC, Reuters, Associated Press, The Guardian
Organisations humanitaires: Croix-Rouge Internationale, Human Rights Watch, Amnesty International (rapports sur les civils en zones de conflit)
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.