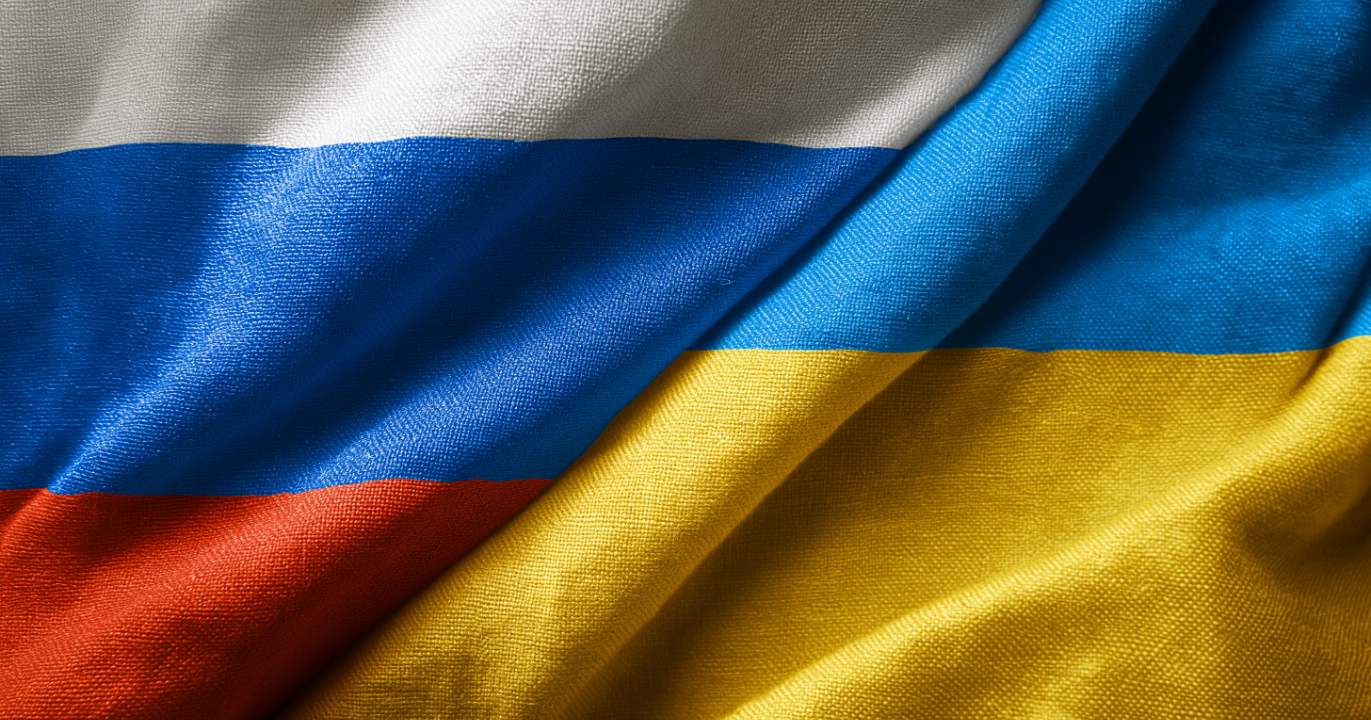
Ce que dit le registre
Froidement. Cliniquement. Parce que c’est comme ça qu’on compte les morts en 2026.
Voici ce que l’état-major général des forces armées ukrainiennes a publié le 17 février 2026, pour les dernières vingt-quatre heures. Je vais vous les donner comme ils les donnent.
Personnel : 890 soldats russes qui ne rentreront pas chez eux.
Chars : 2 de plus. Total cumulé : 11 678.
Véhicules blindés de combat : 3 de plus. Total : 24 045.
Systèmes d’artillerie : 4 de plus. Total : 37 323.
Drones opérationnels et tactiques : 614 de plus. Six cent quatorze. En une seule journée. Total cumulé : 136 073.
Missiles de croisière : 2 de plus. Total : 4 288.
Véhicules et camions-citernes : 71 de plus. Total : 78 725.
Les catégories sans changement : lance-roquettes multiples, systèmes de défense antiaérienne, avions, hélicoptères, navires de guerre, sous-marins, équipements spéciaux. Zéro modification. L’immobilité de ces lignes, paradoxalement, rend le mouvement des autres plus brutal. Parce que les lignes qui bougent, ce sont celles qui comptent les hommes et les machines qui les tuent.
Ce que le registre cache
Le registre ne dit pas que derrière le « +890 », il y a 890 familles qui se sont effondrées. 890 mères qui ont reçu un appel. Des pères, des frères, des sœurs, des enfants, des amis, des voisins qui ne reverront jamais celui qu’ils aimaient. Le registre ne dit pas que certains de ces 890 avaient dix-neuf ans. Que d’autres en avaient quarante-cinq. Que certains étaient volontaires et que d’autres avaient été envoyés sans formation, sans équipement, sans espoir — juste comme du matériel humain à sacrifier.
Ce que les médias montrent : des données. Des listes. Des graphiques en barres montrant la courbe des pertes. Ce que les médias cachent : les cris. Les appels téléphoniques. Les cercueils fermés. Les maisons devenues silencieuses. Ce que personne ne raconte.
Le registre ne dit pas non plus combien de soldats ukrainiens sont tombés dans les mêmes vingt-quatre heures. Ce nombre-là, l’Ukraine ne le publie pas. Et ce silence est une autre forme de vérité. Une vérité que personne n’est prêt à entendre. Une vérité qui pèse dans les décisions, dans les calculs, dans la géométrie cachée de cette guerre.
Le registre ne dit pas que 201 engagements de combat ont eu lieu sur la ligne de front pendant la même période. Deux cent un points sur la carte où des hommes se sont tiré dessus, se sont bombardés, se sont tués. Deux cent un endroits où la terre a tremblé et où quelqu’un a cessé de respirer.
Il y a quelque chose d’obscène dans un registre. Dans la mise en forme. Les colonnes bien alignées. Les totaux en gras. Les parenthèses avec les variations quotidiennes, comme un rapport trimestriel de résultats financiers. « +890 » — on dirait une performance. Un indicateur de rendement. Et quelque part dans un bureau à Kyiv, quelqu’un met à jour ce registre chaque matin. Chaque matin depuis quatre ans. Je me demande ce que ça fait à cette personne. Je me demande si elle arrive encore à voir des visages derrière les données, ou si les données ont fini par manger les visages.
Un million deux cent cinquante-cinq mille — le vertige du cumulatif

Le nombre qu’on ne peut pas imaginer
Depuis le 24 février 2022, les pertes totales estimées des forces russes s’élèvent à environ 1 255 340 soldats. Tués, blessés, disparus, hors de combat.
Je vais l’écrire en toutes lettres, parce que les chiffres arabes passent trop vite. Parce que le cerveau les traite comme des données brutes. Parce qu’il faut forcer la bouche intérieure à prononcer chaque syllabe.
Un million deux cent cinquante-cinq mille trois cent quarante.
Prenez une seconde. Relisez. Essayez de visualiser. Essayez vraiment.
Vous n’y arrivez pas. Personne n’y arrive. Le cerveau humain n’est pas câblé pour ressentir de l’empathie à cette échelle. On peut pleurer pour un enfant. On peut pleurer pour dix personnes. Peut-être pour cent. Mais un million deux cent cinquante-cinq mille ? Le cerveau décroche. Il range le nombre dans la catégorie « très gros » et passe à autre chose. C’est un mécanisme de protection. C’est aussi une trahison.
Rendre le nombre concret
Alors essayons autrement. 1 255 340 personnes, c’est la population d’une grande ville. C’est plus que la population de Prague. C’est plus que celle de Marseille. C’est l’équivalent de la ville de Québec, multipliée par deux, et un peu plus.
Imaginez la ville de Québec. Imaginez chaque habitant — les enfants dans les cours d’école, les commis à l’épicerie, les chauffeurs de bus, les infirmières de nuit, les étudiants qui révisent, les retraités qui promènent leur chien. Imaginez-les tous. Maintenant, multipliez par deux. Et ajoutez-en encore. Et imaginez que tous ont disparu. Tués, blessés, mutilés, disparus. En quatre ans.
C’est ça, ce que signifie le nombre. Deux villes entières, vidées de leurs habitants, transformées en lignes dans un registre quotidien que presque plus personne ne consulte. Mais ce ne sont pas des villes. Ce sont des hommes. Avec des noms. Avec des visages. Avec des vies qui ne seront jamais vécues.
Et le compteur tourne. Chaque jour. Sans pause. Sans relâche. 890 aujourd’hui. Combien demain ? Combien après-demain ? Le nombre n’a pas de plafond. Il n’a pas de limite. Il n’a que la direction : vers le haut. Toujours vers le haut.
Que fait-on d’un nombre qu’on ne peut pas imaginer ? On le range. On le classe. On le compare à d’autres nombres qu’on ne pouvait pas imaginer non plus — les tranchées de 14-18, le front de l’Est en 42, les rizières du Vietnam. On fait de l’histoire comparée pour ne pas avoir à faire de l’empathie. Je le sais parce que c’est exactement ce que je suis en train de faire. Chercher des comparaisons. Chercher des cadres. Chercher des mots pour contenir ce qui ne peut pas être contenu. Un million deux cent cinquante-cinq mille. Et le seul mot qui me vient, le seul mot honnête, c’est : je ne sais pas quoi faire de ce nombre. Je ne sais pas où le mettre. Il est trop gros pour ma tête et trop gros pour mon cœur.
Le métronome — une mort toutes les 97 secondes
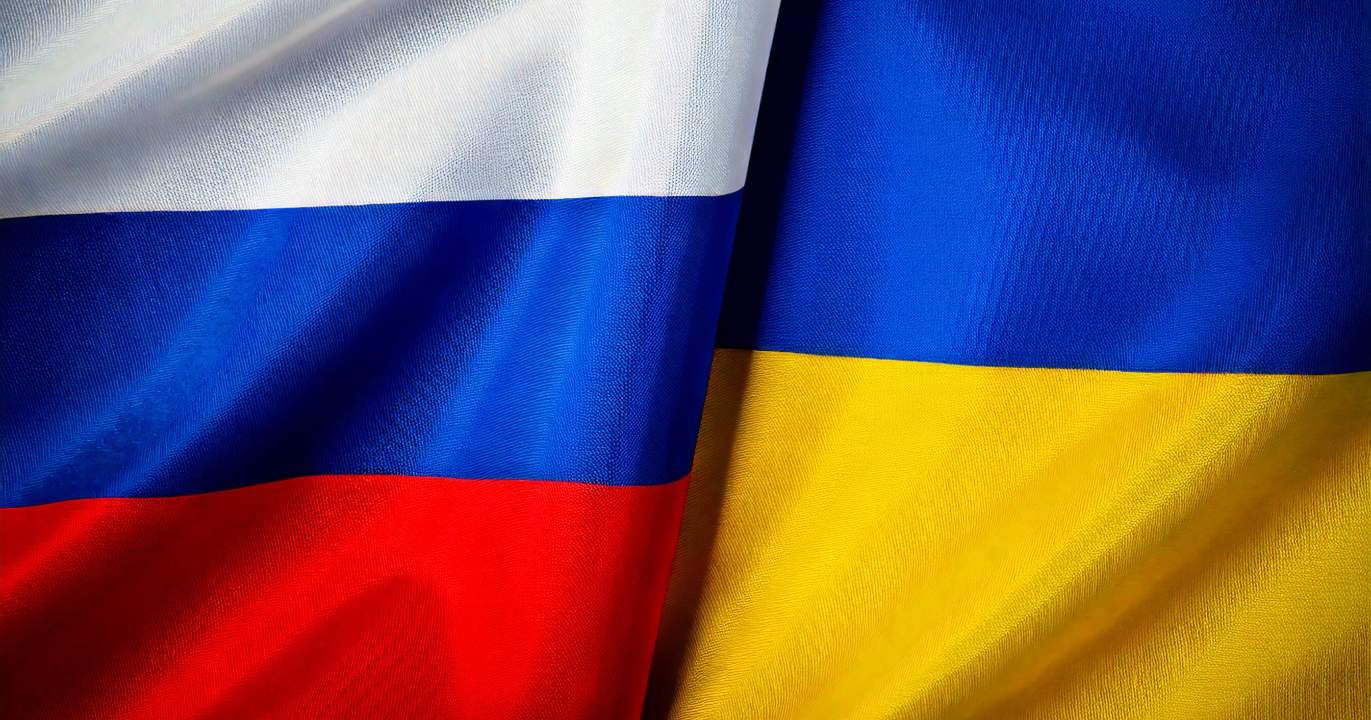
Décomposer le temps
Le calcul que personne ne veut faire.
890 en vingt-quatre heures.
Faisons-le.
890 divisé par 24 heures. Ça donne 37 soldats par heure.
37 divisé par 60 minutes. Ça donne un soldat russe disparu toutes les 97 secondes.
Une minute et trente-sept secondes. C’est le temps qu’il vous a fallu pour lire les deux paragraphes précédents. Pendant que vos yeux parcouraient ces lignes, pendant que votre cerveau traitait ces mots, un homme a cessé d’exister quelque part sur la ligne de front ukrainienne. Un autre est en train de disparaître pendant que vous lisez celui-ci.
Le temps de l’article et le temps de la guerre coexistent. Vous êtes assis. Vous êtes en sécurité. Vous tenez un écran entre vos mains. Et à cinq mille kilomètres d’ici, le métronome bat. Un. Toutes les. Quatre-vingt-dix-sept. Secondes.
Le temps du lecteur, le temps du front
Le temps que vous finissiez cet article — disons trente minutes, si vous lisez attentivement — dix-huit soldats russes seront anéantis ou gravement blessés. Dix-huit. Pendant votre lecture. Pendant que vous êtes là, avec votre café ou votre thé, dans votre salon ou dans le métro, dix-huit hommes auront cessé d’exister en tant que personnes intactes.
Et quand vous aurez fini de lire, quand vous fermerez cet onglet ou passerez au prochain article, le métronome continuera. Il ne s’arrête pas. Il n’a pas de bouton pause. Il bat depuis le 24 février 2022. Il battra demain. Et après-demain. Et le jour d’après.
C’est ça, le rythme de cette guerre. Pas des batailles spectaculaires avec des dates qu’on retient. Pas des offensives éclair qui changent la carte en une nuit. Un égouttement. Régulier. Constant. Mécanique. Un homme toutes les 97 secondes. Comme un robinet qui fuit. Sauf que ce qui coule, c’est du sang.
J’ai fait quelque chose. J’ai mis un chronomètre sur mon téléphone. 97 secondes. Je l’ai laissé tourner pendant que je répondais à mes e-mails. Et chaque fois que la sonnerie retentissait — bip bip bip — je levais les yeux et je pensais : maintenant. En ce moment. Quelqu’un. Quelque part. J’ai tenu onze minutes. Onze minutes avant de couper le chronomètre parce que je ne supportais plus d’être interrompu. Sept sonneries. Sept hommes. Et moi qui trouvais le bruit insupportable. Et la guerre, elle, n’a pas de bouton pour couper le son.
201 engagements — la géographie de l'enfer
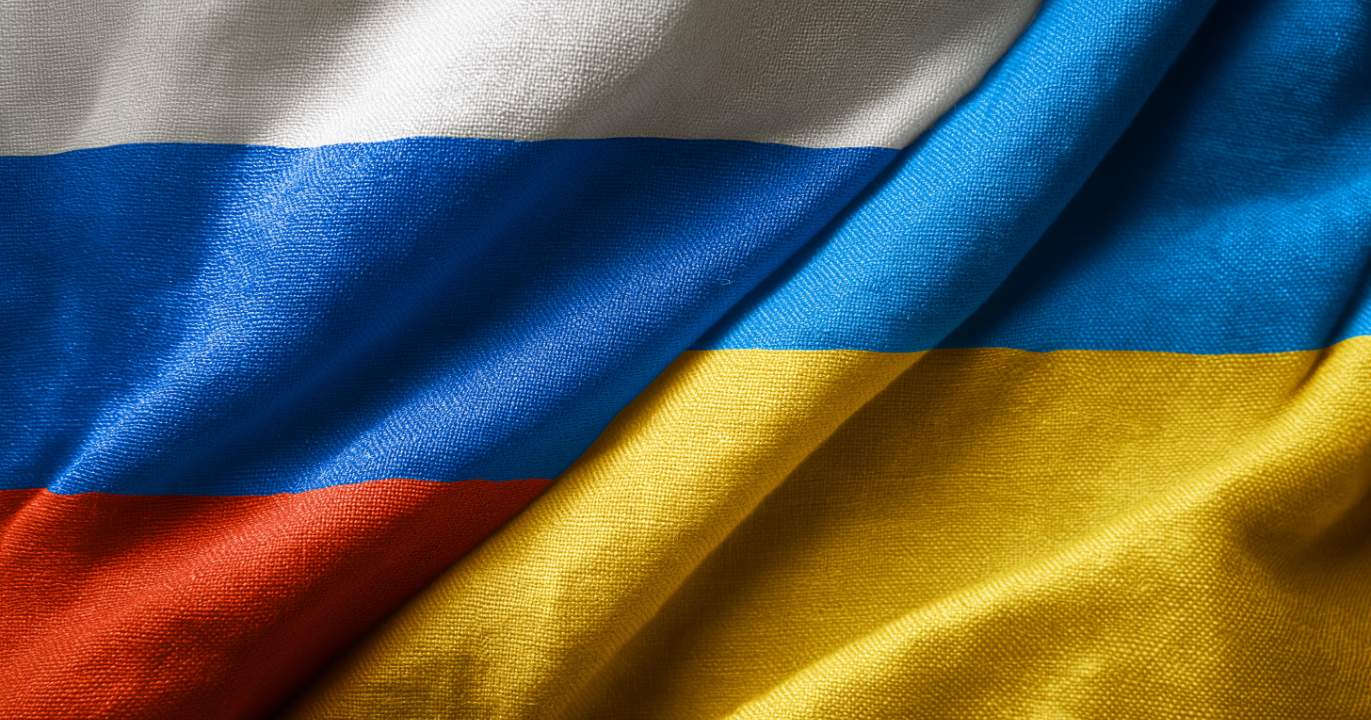
Ce que signifie un engagement de combat
L’état-major ukrainien rapporte 201 engagements de combat sur la ligne de front en vingt-quatre heures. Deux cent un. C’est un nombre qu’on lit vite. Qu’on passe vite. Parce qu’il est technique. Parce qu’il sonne comme du jargon militaire. Mais arrêtons-nous.
Un engagement de combat, c’est un moment et un lieu précis où des soldats se sont affrontés. Avec des armes. Avec des explosions. Avec de la fumée, de la boue, du bruit, de la terreur, de l’adrénaline, et parfois — souvent — de la mort. Chaque engagement est une bataille. Petite ou grande, mais une bataille. Avec des hommes qui tirent et des hommes qui tombent.
201 engagements, ça veut dire 201 points sur la carte où, hier, la terre a tremblé. 201 endroits où des obus ont creusé des cratères. 201 positions où quelqu’un a donné l’ordre d’avancer et où quelqu’un d’autre a donné l’ordre de tenir. 201 lieux où le hasard a décidé qui vivait et qui disparaissait.
La ligne de front qu’on ne voit plus
La ligne de front ukrainienne s’étend sur plus de mille kilomètres. Mille kilomètres. C’est la distance entre Montréal et la frontière du Manitoba. C’est la distance entre Paris et Rome. Et sur chaque portion de cette ligne, chaque jour, des hommes se battent.
On mentionne Chasiv Yar. Un nom que la plupart d’entre vous n’avez jamais entendu. Une ville de la région de Donetsk. Avant la guerre, quelques dizaines de milliers d’habitants. Des rues, des écoles, des magasins, des parcs. Aujourd’hui, un champ de ruines où des soldats s’entre-tuent pour des immeubles éventrés. Chasiv Yar n’est qu’un point parmi les 201. Un nom parmi des dizaines de noms que personne ne retient.
Et c’est là, à Chasiv Yar, qu’un soldat russe a levé les bras. Qu’il a choisi de vivre plutôt que de continuer à tuer. Qu’il a décidé qu’il y avait une autre option.
On regarde les cartes du front comme on regarde un plan de métro. Des lignes. Des couleurs. Des flèches. Du bleu pour l’Ukraine, du rouge pour la Russie. On zoome, on dézoome, on commente les mouvements de quelques kilomètres comme si c’était un jeu de stratégie. Mais derrière chaque pixel de cette carte, il y a de la boue. De la boue et du froid et de la peur et des hommes qui n’ont pas dormi depuis trois jours et qui ne savent pas s’ils verront le prochain matin. 201 engagements. 201 fois, hier, des hommes ont eu peur de disparaître. Et certains avaient raison d’avoir peur.
Le soldat de Chasiv Yar — les bras levés

L’image thermique
Il existe une image. Une image thermique. Noir et blanc. Le blanc, c’est la chaleur. La chaleur d’un corps vivant.
Sur cette image, on voit une silhouette. Un homme. Debout. Les bras levés. Les deux bras. Au-dessus de la tête. La posture universelle. Celle que tout le monde comprend, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, depuis que les guerres existent. La posture qui dit : j’arrête. Je me rends. Je choisis de vivre.
C’est un soldat russe. Près de Chasiv Yar. Il a décidé de se rendre aux forces ukrainiennes. Il connaissait peut-être le programme. Le programme s’appelle « I Want to Live » — « Je veux vivre ». Un numéro de téléphone, une procédure, une promesse : si vous vous rendez, vous serez traité selon les conventions de Genève. Vous survivrez.
Il avait les bras levés. Il avait choisi de vivre.
L’impact
Un drone FPV. First Person View. Un petit engin volant équipé d’une caméra et d’une charge explosive, piloté à distance par un opérateur qui voit à travers les yeux du drone. Le drone est arrivé.
Et il a frappé.
Pas un drone ukrainien. Pas une frappe ennemie qui aurait mal visé.
Un drone russe. Sa propre armée. Ses propres camarades. L’ont tué.
Parce qu’il avait les bras levés. Parce qu’il avait choisi de vivre. Parce que dans la logique de cette machine, un soldat qui se rend n’est pas un homme qui fait un choix courageux. C’est un traître. C’est un exemple à éliminer. C’est un message envoyé à tous les autres : n’essayez même pas.
L’image a été publiée par le programme « I Want to Live ». L’ironie du nom est si dense qu’elle en devient irrespirable. Je veux vivre. Il voulait vivre. On l’a tué pour ça.
Je n’arrive pas à écrire sur cette image sans m’arrêter. J’ai commencé ce paragraphe trois fois. Trois fois, j’ai effacé. Parce que les mots sont trop petits. Parce que dire « c’est horrible » serait une insulte à ce qui s’est passé. Alors je ne dirai pas que c’est horrible. Je dirai seulement ceci : un homme a fait le geste le plus courageux de sa vie — lever les bras, renoncer à la violence, choisir d’exister plutôt que de combattre — et sa propre armée l’a exécuté pour ça. Avec un drone. À distance. Sans le regarder dans les yeux. Et quelque part, un opérateur a vu la silhouette blanche s’effondrer sur son écran noir, et il est passé à la cible suivante. Je ne sais pas comment on vit avec ça. Ni l’opérateur. Ni nous.
La machine qui broie ses propres hommes

Le système, pas l’accident
Ce qui est arrivé au soldat de Chasiv Yar n’est pas une bavure. Ce n’est pas une erreur de communication. Ce n’est pas un opérateur de drone qui a mal identifié sa cible. C’est une politique. C’est un message. C’est le fonctionnement normal d’un système qui considère ses propres soldats comme du matériel consommable.
En janvier 2026, la Russie a perdu 31 700 soldats. En un seul mois. Trente et un mille sept cents. Et pendant le même mois, elle n’en a recruté que 22 700. Le déficit est de 9 000 hommes par mois. Neuf mille. La Russie perd des soldats plus vite qu’elle ne peut les remplacer.
Et pourtant, la machine continue. Les assauts continuent. Les vagues humaines continuent. Les ordres d’avancer sur des positions fortifiées, à travers des champs de mines, sous le feu des engins volants, continuent. Parce que dans cette logique de guerre, l’homme n’est pas une ressource précieuse. L’homme est un intrant. Un coût. Une ligne dans un budget.
Le mépris comme doctrine
Quand un commandement militaire envoie ses soldats dans des assauts frontaux en sachant que le taux de pertes sera catastrophique, ce n’est pas de l’incompétence. C’est un calcul. Le calcul dit : on a plus d’hommes qu’eux. On peut se permettre de perdre trois pour en tuer un. On peut se permettre de saigner si l’adversaire saigne aussi.
C’est la doctrine de l’attrition. La guerre d’usure dans sa forme la plus pure, la plus brutale, la plus cynique. Pas de manœuvre brillante. Pas de stratégie sophistiquée. Juste du volume. Juste de la masse humaine jetée contre des positions défensives, jour après jour, jusqu’à ce que l’un des deux camps craque.
Et quand un soldat décide qu’il ne veut plus faire partie de cette masse, quand il lève les bras et dit non, on le supprime. Pour l’exemple. Pour que les autres n’y pensent même pas. La machine ne tolère pas les pièces qui refusent de fonctionner.
890 par jour. Ce n’est pas une statistique. C’est une cadence de production. La production de morts.
Il y a un mot qu’on n’utilise plus beaucoup, parce qu’il semble appartenir à une autre époque, à d’autres guerres. Le mot, c’est « chair à canon ». On le trouvait dans les livres d’histoire, dans les descriptions des tranchées de Verdun, dans les récits de la Somme. On le lisait avec la distance confortable de celui qui sait que c’était avant, que c’est fini, que plus jamais. Et puis on lit les données de février 2026, et le mot revient. Intact. Précis. Actuel. Chair à canon. Ça n’a pas changé. Ça n’a jamais changé. Seuls les drones sont nouveaux.
L'estimation de l'OTAN — quand le doute n'est plus permis

La question de la fiabilité
Je sais ce que certains d’entre vous pensent. Vous le pensez peut-être depuis le début de cet article. « Ce sont des nombres ukrainiens. » Sous-entendu : des nombres de propagande. Des nombres gonflés. Des nombres de guerre, donc des nombres suspects.
C’est une question légitime. C’est même une question nécessaire. Toute donnée produite par un belligérant doit être examinée avec prudence. L’Ukraine a un intérêt évident à présenter les pertes russes sous le jour le plus défavorable possible. C’est de la guerre informationnelle. C’est normal. C’est attendu.
Sauf que.
1,3 million selon l’OTAN
Un haut responsable de l’OTAN a déclaré que la Russie avait subi environ 1,3 million de pertes — tués et blessés — depuis le début de l’invasion à grande échelle. 1,3 million. C’est l’estimation de l’Alliance atlantique. Pas celle de Kyiv.
Et ce nombre dépasse l’estimation ukrainienne de 1 255 340.
Relisez ça. L’estimation de l’OTAN — une organisation qui dispose de ses propres services de renseignement, de ses propres capacités de surveillance satellite, de ses propres analystes — est plus élevée que celle de l’Ukraine. Pas plus basse. Plus élevée.
Ce qui signifie que les nombres ukrainiens pourraient être conservateurs. Ce qui signifie que le « vrai » total de pertes russes pourrait être encore plus élevé que ce que le bulletin quotidien rapporte. Ce qui signifie que quand vous lisez « 890 », le nombre réel pourrait être de 900, 950, ou plus.
Le doute méthodologique, cette dernière ligne de défense derrière laquelle on pouvait se réfugier pour ne pas avoir à affronter l’ampleur du désastre, vient de s’effondrer. Les nombres sont réels. Au minimum.
J’aurais voulu pouvoir douter. Sincèrement. J’aurais voulu pouvoir me dire que les nombres sont exagérés, que la réalité est moins terrible, que 1 255 340 est un total de propagande et que le vrai nombre est beaucoup plus bas. Ça m’aurait permis de respirer un peu. De me dire que c’est grave, oui, mais pas tant que ça. Pas à ce point. Mais l’OTAN dit 1,3 million. Et l’OTAN n’a aucun intérêt à gonfler les nombres — au contraire, l’Alliance a plutôt intérêt à les minimiser pour ne pas effrayer ses propres opinions publiques. Alors quand l’OTAN dit plus que l’Ukraine, il n’y a plus d’abri. Il n’y a plus de refuge. Il y a juste le nombre. Et le nombre est monstrueux.
136 073 drones — la guerre qui change de visage
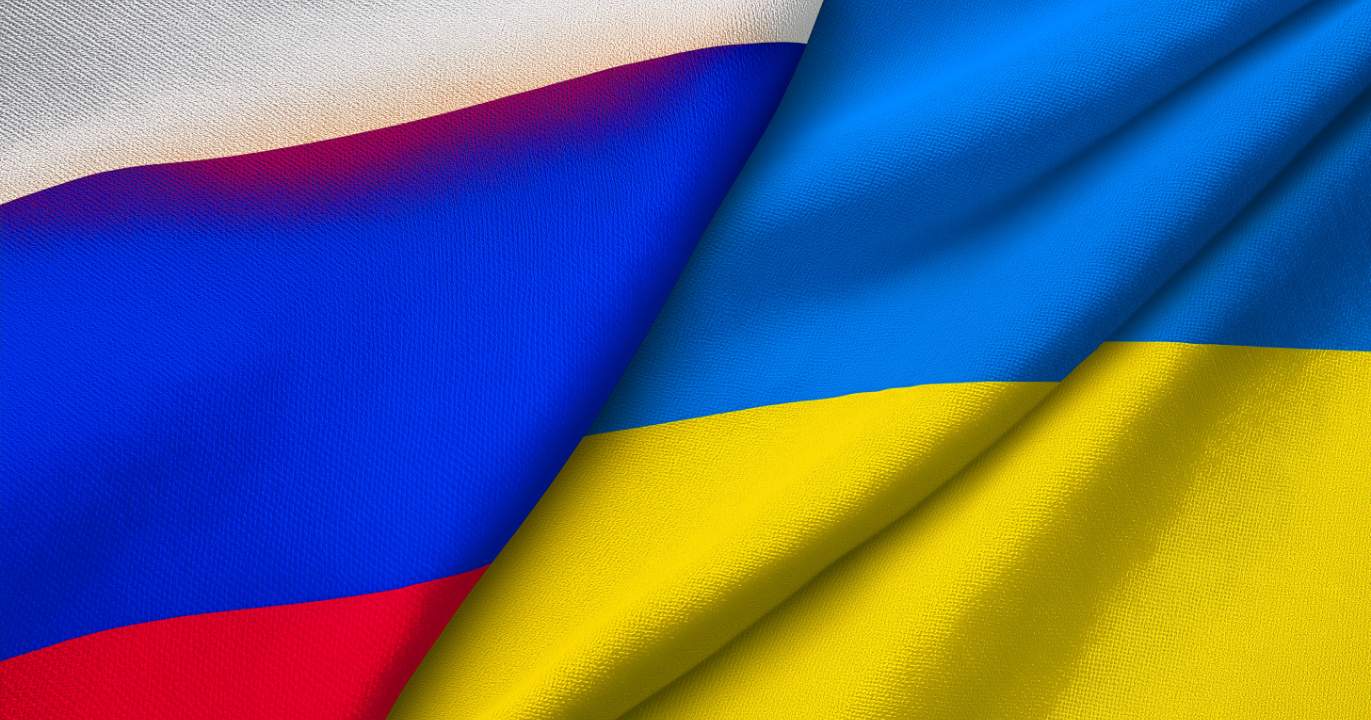
L’industrialisation de la mort
614 engins volants détruits en vingt-quatre heures. Six cent quatorze. C’est presque autant que le nombre de soldats perdus. La guerre se mécanise à une vitesse que personne n’avait anticipée.
Le total cumulé est de 136 073 engins opérationnels et tactiques détruits depuis le début de l’invasion. Cent trente-six mille. C’est un nombre qui dépasse l’entendement. C’est un nombre qui dit quelque chose de fondamental sur la nature de ce conflit : il n’est plus seulement une guerre d’hommes contre des hommes. C’est une guerre de machines contre des hommes. Et de machines contre des machines.
Les engins FPV coûtent quelques centaines de dollars pièce. Ils sont produits en masse. Ils sont pilotés à distance par des opérateurs qui peuvent être à des kilomètres du point d’impact. Un opérateur peut piloter plusieurs appareils dans une journée. Il peut tuer plusieurs personnes dans une journée. Sans jamais quitter sa chaise. Sans jamais voir le visage de celui qu’il supprime.
Mourir sans être regardé
Le soldat de Chasiv Yar a disparu sous un engin FPV. Pas sous le tir d’un autre soldat. Pas dans un corps à corps. Pas face à un ennemi qui le regardait dans les yeux. Il a disparu sous un petit appareil volant piloté par quelqu’un qui le voyait comme une forme sur un écran. Une tache blanche sur fond noir. Un pixel chaud.
Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette façon de disparaître. Quelque chose qui va au-delà de l’horreur habituelle de la guerre. C’est la déshumanisation progressive de la disparition elle-même. Quand un soldat supprime un autre soldat en le regardant, il y a — même dans l’horreur — une forme de reconnaissance. L’autre existe. L’autre est un être humain. L’acte de tuer a un poids moral qui écrase.
Quand un opérateur appuie sur un bouton en regardant un écran, l’autre n’est qu’une forme. Un objectif. Une cible. La distance physique crée une distance morale qui anesthésie. Et cette distance morale permet de tuer 614 fois par jour sans que personne ne perde le sommeil.
C’est la guerre du XXIe siècle. Efficace. Industrielle. Propre pour celui qui tue. Atroce pour celui qui disparaît.
Mon fils joue à des jeux vidéo. Des jeux de guerre. Il pilote des appareils virtuels, il vise des cibles virtuelles, il appuie sur un bouton et une explosion virtuelle remplit son écran. Il a quatorze ans. Et quelque part en Russie ou en Ukraine, un autre garçon de vingt ans fait exactement la même chose — sauf que les explosions sont réelles et que les silhouettes qui s’effondrent ne se relèvent pas. L’interface est la même. L’écran est le même. Les gestes sont les mêmes. Seules les conséquences diffèrent. Et cette ressemblance entre le jeu et la réalité, cette frontière qui s’efface entre le virtuel et le mortel, me donne le vertige. Pas un vertige intellectuel. Un vertige de père.
La soutenabilité — combien de temps encore ?
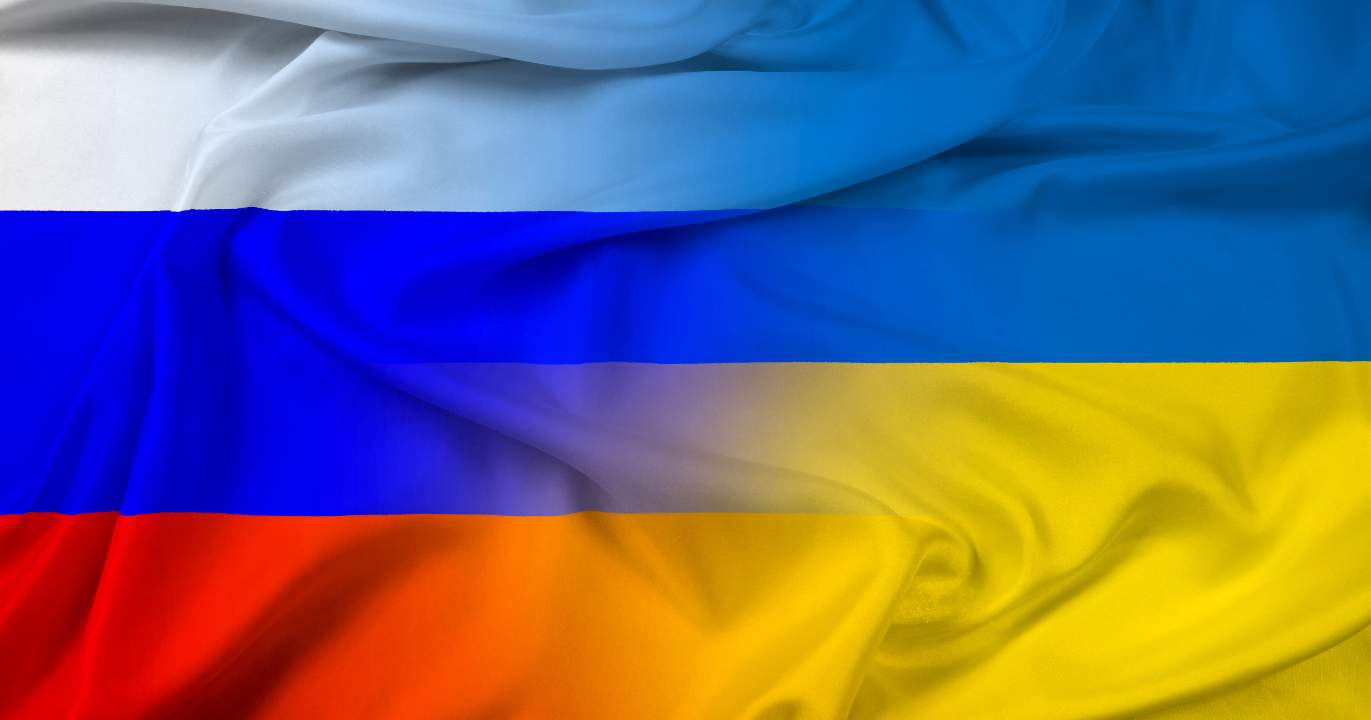
Le déficit structurel
Les données de janvier 2026 posent une question que tous les analystes se posent : combien de temps la Russie peut-elle tenir ce rythme ?
31 700 pertes en un mois. 22 700 recrues dans le même mois. Déficit : 9 000 hommes. Chaque mois, la Russie perd 9 000 soldats de plus qu’elle n’en recrute. En un an, ça fait un déficit de plus de 100 000 hommes. C’est l’équivalent d’une armée entière qui disparaît chaque année sans être remplacée.
Mathématiquement, c’est insoutenable. Aucune armée ne peut absorber un tel déficit indéfiniment. La base de recrutement se rétrécit. Les hommes en âge de combattre ne sont pas infinis. Les régions les plus pauvres de Russie — celles qui fournissent la majorité des recrues — se vident. Les primes d’engagement augmentent, ce qui signifie que le volontariat ne suffit plus.
Le seuil de douleur d’un régime autoritaire
Mais voilà le problème. On a déjà dit ça. En 2023, les analystes regardaient les données et disaient : « insoutenable ». En 2024, même conclusion. En 2025, identique. Et à chaque fois, la Russie a continué comme si de rien n’était.
Elle a continué parce que le seuil de douleur d’un régime autoritaire n’est pas le même que celui d’une démocratie. Dans une démocratie, les pertes militaires massives créent une pression politique. Les familles protestent. Les médias questionnent. L’opinion publique se retourne. Le gouvernement doit rendre des comptes.
Dans la Russie de Vladimir Poutine, les familles qui protestent sont arrêtées. Les médias qui questionnent sont fermés. L’opinion publique est façonnée par la propagande. Et le gouvernement ne rend de comptes à personne. Le seuil de douleur n’est pas déterminé par la souffrance de la population. Il est déterminé par la capacité du régime à dissimuler cette souffrance.
Alors combien de temps encore ? La réponse honnête est : personne ne sait. Les modèles mathématiques disent que c’est impossible. La réalité dit que ça continue. Et entre les modèles et la réalité, c’est toujours la réalité qui gagne.
Quel est le nombre de morts qu’un régime autoritaire est prêt à accepter quand il n’a pas de comptes à rendre ? Y a-t-il seulement un tel nombre ?
Je repense à cette question souvent. La nuit, parfois. Quel est le nombre ? Quel est le total au-delà duquel même un dictateur se dit : c’est trop ? Un million ? Deux millions ? Cinq ? Y a-t-il seulement un tel total ? Ou est-ce que la logique du pouvoir absolu est justement de ne jamais avoir de limite, parce que la limite impliquerait de reconnaître l’erreur, et que reconnaître l’erreur impliquerait de perdre le pouvoir, et que perdre le pouvoir est la seule chose qui soit véritablement insoutenable ? Je crois que c’est ça. Je crois que le seuil n’existe pas. Et c’est la chose la plus effrayante que j’aie écrite depuis longtemps.
La routinisation — le vrai ennemi

Le format qui anesthésie
Le « Daily Update ». La mise à jour quotidienne. Le bulletin de pertes. Chaque jour, à la même heure, dans le même format, avec les mêmes catégories, les mêmes colonnes, les mêmes parenthèses pour les variations. C’est un rituel. C’est une liturgie. C’est la messe quotidienne de ce conflit.
Et comme toute liturgie répétée trop longtemps, elle a perdu son impact émotionnel. Le premier bulletin, en mars 2022, a fait le tour du monde avec des cris d’horreur. Le centième a circulé sur Twitter avec des commentaires. Le millième a atteint quelques comptes spécialisés avec une certaine indifférence. Le bulletin d’aujourd’hui — le combientième ? le mille quatre centième ? — sera lu par quelques milliers de personnes. Peut-être moins.
Le format est nécessaire. Il faut compter. Il faut documenter. Il faut que quelqu’un, quelque part, tienne le registre de ce qui se passe. Pour l’histoire. Pour la justice. Pour la mémoire. Et pourtant, c’est exactement ce format qui nous tue émotionnellement. C’est exactement cette mise en forme qui transforme l’extraordinaire en ordinaire. C’est exactement ce registre qui fait de 890 disparus un mardi normal.
Le miroir du spectateur
Vous avez lu ce titre. Vous avez peut-être hésité à cliquer. Vous avez peut-être pensé : encore un bulletin. Encore des données. Encore la même chose. Et vous avez cliqué quand même, ou peut-être que vous n’avez pas cliqué et que quelqu’un vous a envoyé le lien, ou peut-être que l’algorithme a décidé pour vous.
Mais la question est là, et elle est pour vous : qu’est-ce que vous avez ressenti en lisant « 890 soldats » ? Soyez honnête. Pas ce que vous pensez que vous devriez ressentir. Ce que vous avez VRAIMENT ressenti. Un choc ? Une fatigue sourde face à l’inévitable ? De la curiosité ? De la lassitude ? Un vague malaise ? Rien du tout ?
Et puis il y a la citation. En bas de l’infographie officielle de l’état-major ukrainien, sous le registre des pertes, sous les colonnes de données et les totaux cumulés, il y a une citation de Sénèque. Le philosophe stoïcien. Mort il y a deux mille ans. « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas que les choses sont difficiles. »
Du Sénèque. Sous un registre de 1 255 340 pertes. L’ironie est vertigineuse. Qui a mis cette citation là ? Pourquoi ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce un message aux soldats ukrainiens ? Aux Occidentaux ? À nous, les spectateurs qui lisons les données sans oser les ressentir ?
Je suis un spectateur. Vous aussi. On est tous des spectateurs de ce conflit. On regarde. On lit. On commente. On partage. Et puis on passe à autre chose. On n’est pas sur le front. On n’est pas dans les tranchées. On n’est pas sous les appareils volants. On est derrière nos écrans, dans nos villes intactes, avec nos vies intactes, et on regarde des hommes disparaître à travers des registres de données. Et le pire, ce n’est pas qu’on regarde. Le pire, c’est qu’on s’y est habitués. Le premier bulletin nous a choqués. Le millième ne nous fait plus rien. Et entre le premier et le millième, quelque chose en nous s’est éteint. Pas par cruauté. Par saturation. Par épuisement. Par l’impossibilité de ressentir 890 fois la même douleur chaque jour pendant quatre ans. Mais le fait que notre incapacité soit compréhensible ne la rend pas acceptable. Parce que les morts, eux, ne se sont pas habitués à disparaître.
Ce que disent les données — synthèse d'une guerre qui n'en finit pas

Les tendances qui se dessinent
Maintenant que les données ont un poids — maintenant qu’elles ne sont plus des lignes dans un registre mais des vies, des familles, des formes blanches sur des écrans noirs — regardons ce qu’elles nous disent sur l’état réel de ce conflit.
Première tendance : le rythme d’attrition ne faiblit pas. 890 par jour en février 2026 est comparable aux pires mois de 2024 et 2025. La guerre ne ralentit pas. Elle ne s’essouffle pas. Elle maintient sa cadence de destruction avec une régularité mécanique.
Deuxième tendance : le déficit de recrutement se creuse. 31 700 pertes pour 22 700 recrues en janvier. La Russie puise dans des réserves qui s’amenuisent. Les primes augmentent. Les méthodes de recrutement se durcissent. Le vivier démographique n’est pas infini, même pour un pays de 144 millions d’habitants.
Troisième tendance : la guerre des appareils s’intensifie de façon exponentielle. 614 engins détruits en une journée, 136 073 au total. Le champ de bataille est de plus en plus dominé par des machines. L’humain y est de plus en plus vulnérable, de plus en plus exposé, de plus en plus jetable.
Ce que les données ne disent pas encore
Quatrième tendance, celle que les données ne montrent pas directement : l’intensité des combats (201 engagements par jour) suggère que ni l’un ni l’autre camp n’est en position de percée décisive. La ligne de front bouge de quelques centaines de mètres ici, recule de quelques centaines de mètres là. C’est une guerre de position. Une guerre d’usure. Une guerre qui ressemble de plus en plus aux grandes boucheries du XXe siècle.
Et la cinquième tendance, la plus silencieuse : la lassitude progressive qui s’installe. Pas seulement la fatigue des soldats — celle-là est documentée, visible, palpable. La fatigue du monde. La fatigue des opinions publiques occidentales. La fatigue des dirigeants qui doivent justifier l’aide militaire devant des électeurs qui ont d’autres préoccupations. La fatigue qui est le meilleur allié de celui qui peut se permettre de perdre plus longtemps que l’autre.
Les données disent tout ça. Si on prend le temps de les écouter.
Je relis mes propres mots et je me demande si ça sert à quelque chose. Si un article de plus, un billet de plus, un texte de plus change quoi que ce soit au compteur qui tourne. La réponse honnête est probablement non. Un texte ne sauve personne. Un texte ne stoppe pas un appareil. Un texte ne ramène pas le soldat de Chasiv Yar. Mais un texte peut faire une chose : refuser. Refuser que les données passent sans laisser de trace. Refuser que 890 devienne un bruit de fond. Refuser que la routinisation gagne. C’est dérisoire. C’est insuffisant. Mais c’est ce que j’ai. Et ce soir, c’est tout ce que j’ai.
Conclusion — demain, il y aura un autre bulletin

Le nombre qui a changé
890.
C’est le même nombre qu’au début de cet article. Les mêmes trois caractères. Le même total. Mais si vous avez lu jusqu’ici — si vous avez traversé les registres, les calculs, l’image thermique, les bras levés, l’appareil, le déficit, la routinisation — alors ce n’est plus le même nombre.
Parce que vous n’êtes plus le même lecteur. Quelque chose a bougé. Peut-être pas grand-chose. Peut-être juste un inconfort. Une gêne. Un refus de laisser le nombre glisser comme il glissait avant. C’est peu. Mais c’est déjà quelque chose.
890 hommes ont disparu hier. Pas des statistiques. Pas des lignes dans un registre. Pas des « +890 » entre parenthèses. Des hommes. Avec des visages que nous ne verrons jamais, des noms que nous ne connaîtrons jamais, des histoires que personne ne racontera jamais. Parmi eux, peut-être celui qui avait les bras levés. Celui qui avait choisi.
Ce qui vient après — et le refus qui demeure
Demain, il y aura un autre bulletin. D’autres données. Le compteur passera de 1 255 340 à 1 256 000 et quelques. Les colonnes seront mises à jour. Les parenthèses afficheront de nouvelles variations. Le format sera identique. La liturgie se poursuivra.
Et la question ne sera pas combien. La question ne sera jamais combien. La question sera : est-ce que quelqu’un, quelque part, refuse encore de laisser ces données devenir du bruit ?
Est-ce que quelqu’un s’arrête encore ? Est-ce que quelqu’un prend encore les 97 secondes nécessaires pour penser à un seul de ces 890 ? Est-ce que quelqu’un, en lisant le bulletin de demain, aura encore le réflexe de se dire : ce ne sont pas des données, ce sont des gens ?
C’est la seule chose qui nous reste. Le seul acte de résistance du spectateur. Refuser l’engourdissement. Refuser que la répétition tue l’émotion. Refuser que le millième bulletin soit moins grave que le premier. Même si c’est une illusion. Même si c’est insuffisant. Parce que le jour où on arrête même d’essayer de refuser, c’est le jour où 890 devient vraiment juste un nombre.
890 aujourd’hui. Et demain, encore. Et après-demain, encore.
Le compteur ne s’arrête pas. Nous non plus.
Signé Maxime Marquette
Encadré de transparence du chroniqueur

Positionnement éditorial
Je ne suis pas journaliste, mais chroniqueur et analyste. Mon expertise réside dans l’observation et l’analyse des dynamiques géopolitiques, économiques et stratégiques qui façonnent notre monde. Mon travail consiste à décortiquer les stratégies politiques, à comprendre les mouvements économiques globaux, à contextualiser les décisions des acteurs internationaux et à proposer des perspectives analytiques sur les transformations qui redéfinissent nos sociétés.
Je ne prétends pas à l’objectivité froide du journalisme traditionnel, qui se limite au rapport factuel. Je prétends à la lucidité analytique, à l’interprétation rigoureuse, à la compréhension approfondie des enjeux complexes qui nous concernent tous. Mon rôle est de donner du sens aux faits, de les situer dans leur contexte historique et stratégique, et d’offrir une lecture critique des événements.
Méthodologie et sources
Ce texte respecte la distinction fondamentale entre faits vérifiés et analyses interprétatives. Les informations factuelles présentées proviennent exclusivement de sources primaires et secondaires vérifiables.
Sources primaires : communiqués officiels des gouvernements et institutions internationales, déclarations publiques des dirigeants politiques, rapports d’organisations intergouvernementales, dépêches d’agences de presse internationales reconnues (Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, Bloomberg News, Xinhua News Agency).
Sources secondaires : publications spécialisées, médias d’information reconnus internationalement, analyses d’institutions de recherche établies, rapports d’organisations sectorielles (The Washington Post, The New York Times, Financial Times, The Economist, Foreign Affairs, Le Monde, The Guardian).
Les données statistiques, économiques et géopolitiques citées proviennent d’institutions officielles : Agence internationale de l’énergie (AIE), Organisation mondiale du commerce (OMC), Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale, instituts statistiques nationaux.
Nature de l’analyse
Les analyses, interprétations et perspectives présentées dans les sections analytiques de cet article constituent une synthèse critique et contextuelle basée sur les informations disponibles, les tendances observées et les commentaires d’experts cités dans les sources consultées.
Mon rôle est d’interpréter ces faits, de les contextualiser dans le cadre des dynamiques géopolitiques et économiques contemporaines, et de leur donner un sens cohérent dans le grand récit des transformations qui façonnent notre époque. Ces analyses reflètent une expertise développée à travers l’observation continue des affaires internationales et la compréhension des mécanismes stratégiques qui animent les acteurs globaux.
Toute évolution ultérieure de la situation pourrait naturellement modifier les perspectives présentées ici. Cet article sera mis à jour si de nouvelles informations officielles majeures sont publiées, garantissant ainsi la pertinence et l’actualité de l’analyse proposée.
Sources
Sources primaires
Ministère de la Défense de l’Ukraine (compte officiel X/Twitter) — Publication des pertes estimées des forces russes, données du 17 février 2026.
UNITED24 Media — Déclaration d’un haut responsable de l’OTAN — Estimation des pertes russes à environ 1,3 million de soldats tués ou blessés depuis le début de l’invasion à grande échelle.
Sources secondaires
UNITED24 Media — Couverture quotidienne du conflit en Ukraine, bulletins de pertes et analyses du champ de bataille, février 2026.
UNITED24 Media — Pertes russes de janvier 2026 — Article rapportant que la Russie a perdu 31 700 soldats au cours du premier mois de 2026, soit 9 000 de plus que le nombre de recrues enrôlées sur la même période.
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.