
Comment on élimine un allié sans le dire
Regardons comment ça fonctionne, cette marginalisation. Parce que pendant qu’on va analyser les mécanismes, il y a un soldat quelque part qui se demande si tout ça a un sens. Et voilà comment on le tue, pas avec une balle, mais avec de l’indifférence administrative.
C’est méthodique. Pensé. Stratégique. Ce n’est pas un oubli administratif — c’est une décision calculée. Une cascade d’actions : d’abord la pression, puis la capitulation, enfin l’annonce. Du mauvais, au pire, à l’inacceptable.
D’abord, Washington exerce une pression. Pas publique. Pas officielle. Juste des conversations discrètes entre diplomates. Des appels téléphoniques. Des suggestions fermes. Le genre de pression qui ne laisse pas de traces écrites mais qui fait comprendre clairement ce qu’on attend. Les États-Unis ne veulent pas que l’Ukraine soit invitée formellement. Point final.
Ensuite, les alliés cèdent. Un par un. Parce que s’opposer à Washington dans l’OTAN, c’est compliqué. Surtout maintenant, avec Trump de retour à la Maison-Blanche. Surtout quand on sait que les Américains peuvent rendre la vie difficile à ceux qui ne suivent pas la ligne. Alors on acquiesce. On trouve des justifications techniques. On invoque les règles, les traditions, la complexité de la situation.
J’ai couvert assez de sommets internationaux pour reconnaître cette danse. Cette chorégraphie bien huilée où tout le monde sait ce qui se passe mais où personne ne le dit ouvertement. Où les décisions sont prises avant même que les délégations n’arrivent. Où le sommet lui-même n’est plus qu’un théâtre pour valider ce qui a déjà été décidé dans les coulisses. Et pendant ce temps, à Pokrovsk, des soldats ukrainiens se demandent pourquoi ils combattent encore pour un Occident qui les traite comme des figurants. Cette question — « Pour qui ? » — elle va s’amplifier. Elle va devenir un cri. Et un jour, elle va exiger une réponse.
L’élargissement de la mise à l’écart
Mais l’Ukraine n’est pas seule. Washington veut aussi reléguer l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. Cinq pays. Cinq alliés. Tous écartés de la table principale. Tous confinés aux manifestations périphériques.
Le point commun ? Ce sont tous des pays qui font face à des menaces directes de régimes autoritaires. L’Ukraine contre la Russie. L’Australie, le Japon et la Corée du Sud contre la Chine et la Corée du Nord. La Nouvelle-Zélande dans le contexte indo-pacifique. Des pays qui ont besoin de l’OTAN, ou du moins de sa solidarité symbolique, pour montrer qu’ils ne sont pas seuls face à leurs adversaires.
Et c’est précisément ces pays-là que Washington veut écarter. Ce ne sont pas des choix aléatoires — c’est une décision stratégique chargée d’une indifférence calculée, une volonté de redéfinir l’OTAN comme un club plus restreint, plus « transatlantique » au sens strict, moins ouvert aux partenaires globaux. Un retour en arrière. Un repli.
L’annulation du forum public confirme cette tendance. Ce forum, c’était l’espace où la société civile pouvait s’exprimer. Où les experts indépendants pouvaient débattre. Où les voix dissidentes avaient une place. Trop de bruit, apparemment. Trop de questions embarrassantes. Mieux vaut un sommet entre gouvernements, à huis clos, sans témoin gênant.
Le vocabulaire de la lâcheté
« Very harmful ». Revenons sur ces deux mots. Parce qu’ils disent tout. Un diplomate de l’OTAN, parlant sous couvert d’anonymat, qualifie cette décision de « dommageable ». Il ajoute qu’elle pourrait « affaiblir les efforts pour construire le soutien public aux activités de l’OTAN » et à l’augmentation des dépenses de défense.
Regardez le vocabulaire : pas de « catastrophe », pas de « trahison », pas d’« abandon ». Non. « Très dommageable ». Comme si on parlait d’une mauvaise communication. D’un petit accroc. D’une erreur mineure.
Mais derrière ces mots polis se cache une réalité brutale. Ce diplomate sait exactement ce que signifie cette relégation. Il sait que l’Ukraine va le prendre comme un coup de poignard. Il sait que Moscou va y voir un signal de faiblesse. Il sait que les citoyens européens vont se demander pourquoi on dépense des milliards pour soutenir un pays qu’on ne daigne même pas inviter à nos réunions.
Mais il ne peut pas le dire ouvertement. Parce que dans le monde diplomatique, la franchise est un luxe qu’on ne peut pas se permettre. Alors on dit « très dommageable ». Et on espère que les gens comprendront entre les lignes.
Il y a quelque chose de profondément obscène dans ce langage aseptisé. Dans cette manière de décrire un abandon comme un simple « dommage ». Comme si on parlait d’un budget dépassé ou d’un retard logistique. Pas de centaines de milliers de morts. Pas d’un pays qui se bat pour sa survie. Pas de soldats qui croient encore que l’Occident tient ses promesses. Non. Juste « très dommageable ». Deux mots pour ne rien dire. Deux mots pour tout cacher.
Le poids des promesses oubliées

Vilnius et le chemin vers nulle part
Juillet 2023. Vilnius, Lituanie. Le sommet de l’OTAN qui devait marquer un tournant pour l’Ukraine. Zelensky arrive avec un espoir : obtenir une invitation formelle à rejoindre l’Alliance. Ou au moins un calendrier clair. Une « pathway to membership », comme on dit en anglais. Un chemin vers l’adhésion.
Il repart avec des mots. Beaucoup de mots. Les leaders de l’OTAN affirment que l’Ukraine rejoindra l’Alliance « quand les conditions seront réunies ». Ils promettent un soutien « pour la durée de la crise ». Ils créent un Conseil OTAN-Ukraine pour renforcer la coopération. Ils parlent de formation, d’équipement, de standards militaires à atteindre.
Mais pas d’invitation. Pas de date. Pas de garantie concrète. Juste la promesse vague d’un avenir incertain. Zelensky, frustré, le dit ouvertement : c’est « absurde » de ne pas proposer un calendrier clair à un pays qui combat la Russie depuis des années. Mais les leaders occidentaux ne bougent pas. Trop risqué, disent-ils. Trop compliqué. Pas le bon moment.
Deux ans plus tard, ce même pays qui se battait déjà en 2023 continue de se battre en 2025. Avec plus de morts. Plus de destructions. Plus de sacrifices. Et maintenant, il ne reçoit même plus d’invitation au sommet. Le chemin n’a pas avancé. Il s’est effondré. Et dans quatre mois, quand le sommet d’Ankara se tiendra, cet effondrement sera officiel. Irréversible. Documenté pour l’histoire.
Washington 2024 et le soutien déclaré
Juillet 2024. Washington D.C. Un an après Vilnius. Le sommet du 75e anniversaire de l’OTAN. Biden est encore président. L’ambiance est solennelle. On célèbre l’Alliance, sa résilience, son unité face à l’agression russe.
Zelensky est là, évidemment. Il rencontre Biden, Scholz, Macron, tous les grands leaders. Les communiqués parlent de « soutien constant ». Les États-Unis annoncent de nouvelles livraisons d’armes. L’Europe promet des milliards supplémentaires. Tout le monde répète le mantra : « Pour la durée nécessaire ».
Mais encore une fois, pas d’adhésion. Pas de calendrier. Juste des promesses de continuer à aider. De ne pas abandonner. De rester solidaires. Les mêmes engagements flous qu’à Vilnius. Et derrière les sourires pour les caméras, les premières fissures apparaissent. Trump est en campagne. Il dit ouvertement qu’il veut « finir la guerre en 24 heures ». Qu’il va « forcer » Zelensky à négocier. Que l’aide américaine ne peut pas durer éternellement. Les Européens s’inquiètent mais ne disent rien publiquement. Pas encore.
Je me souviens d’avoir regardé ces images de Washington. Biden serrant la main de Zelensky. Les drapeaux. Les discours. L’unité affichée. Et je me souviens d’avoir pensé : combien de temps encore ? Combien de sommets avant que les promesses ne deviennent du vent ? Avant que « pour la durée nécessaire » ne devienne « en fait, on a autre chose à faire » ? Un an plus tard, j’ai ma réponse. Ankara. Juillet 2025. Pas d’invitation. Le chemin s’arrête là.
La Haye 2025 et les premiers signes
Février 2025. La Haye, Pays-Bas. Sommet extraordinaire de l’OTAN. Trump est de retour à la Maison-Blanche depuis un mois. L’ambiance a changé. Radicalement.
Zelensky est là, mais cette fois, il n’est pas invité à la session principale des leaders. Il reste en marge. Il rencontre Trump dans un couloir. Une discussion rapide. Quelques photos. Puis Trump repart. Les Européens essaient de compenser, organisent des rencontres bilatérales, réaffirment leur soutien. Mais le message est clair : les États-Unis ont changé de priorités.
Trump parle déjà de « finir cette guerre ». De « négociations ». De « compromis nécessaires ». Il ne dit plus « pour la durée nécessaire ». Il dit « on verra ». « On va discuter ». « Il faut être réaliste ».
Et maintenant, Ankara. Quatre mois plus tard. La relégation devient officielle. Plus de faux-semblants. Plus de présence en marge. Juste l’absence pure et simple. Ou alors les « side events ». Les manifestations parallèles. La table des enfants pendant que les adultes décident. Et chaque jour qui passe sans réaction renforce cette décision. Chaque silence en est un consentement.
Le compte à rebours vers juillet
Nous sommes en février 2025. Le sommet d’Ankara est prévu pour juillet. Dans quatre mois et demi. Quatre mois et demi pour que quelque chose change. Pour que quelqu’un dise non à Washington. Pour que les Européens trouvent le courage de s’opposer.
Mais soyons honnêtes : ça n’arrivera probablement pas. Parce que s’opposer aux États-Unis dans l’OTAN, c’est prendre un risque énorme. C’est risquer de perdre le soutien américain sur d’autres dossiers. C’est risquer de se retrouver isolé. C’est risquer de mécontenter Trump, qui n’est pas connu pour sa patience avec ceux qui le contredisent.
Alors les Européens vont probablement faire ce qu’ils font toujours : acquiescer publiquement, exprimer leurs « préoccupations » en privé, et espérer que ça passe. Ils vont trouver des justifications techniques. Invoquer les règles. Expliquer que c’est compliqué. Que ce n’est pas le bon moment. Qu’il faut être stratégique.
Et pendant ce temps, l’Ukraine continuera de se battre. Ses soldats continueront de mourir. Ses civils continueront de vivre sous les bombardements. Et Zelensky continuera de frapper aux portes occidentales, en se demandant combien de temps encore il devra mendier la reconnaissance pour un pays qui paie déjà le prix du sang. Quatre mois. C’est le temps qu’il nous reste pour dire non. Avant que ce silence ne devienne permanent.
Le message envoyé à Moscou
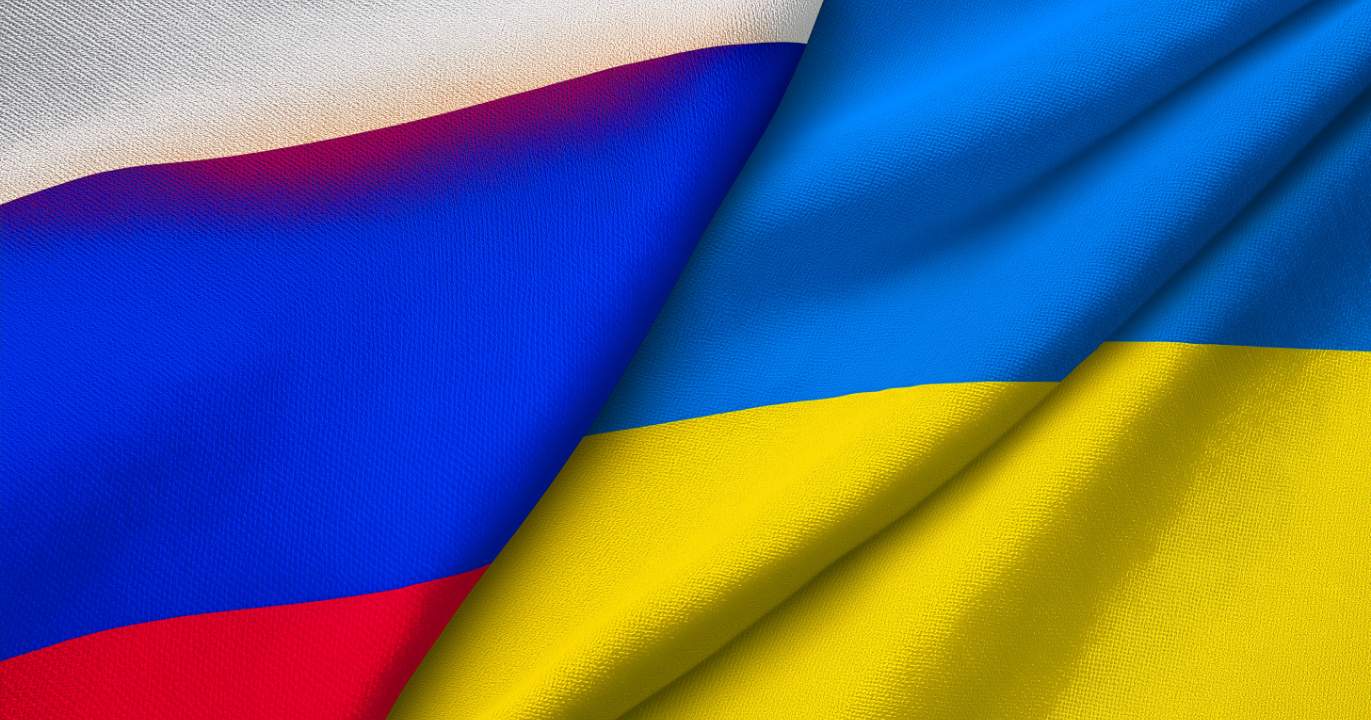
Ce que Poutine va lire dans cette relégation
Imaginons la scène. Quelque part dans le Kremlin, Vladimir Poutine reçoit le briefing quotidien de ses services de renseignement. On lui parle des mouvements de troupes, des livraisons d’armes occidentales, de l’état du front. Et puis, presque en passant, on mentionne cette information : les États-Unis pressent leurs alliés de ne pas inviter l’Ukraine au prochain sommet de l’OTAN à Ankara.
Poutine enregistre. Parce qu’il comprend immédiatement ce que ça signifie. Pas besoin d’analyse géopolitique complexe. Pas besoin de décrypter le langage diplomatique. Le message est limpide : l’Occident hésite. L’Occident commence à lâcher prise. L’Occident se divise.
Depuis le début de cette guerre, Poutine parie sur une chose : la lassitude occidentale. Il sait qu’il ne peut pas vaincre militairement l’Ukraine tant que l’Occident la soutient. Mais il sait aussi que ce soutien n’est pas éternel. Que les opinions publiques se fatiguent. Que les budgets ont des limites. Que les promesses politiques s’évaporent avec le temps.
Je pense souvent à cette phrase de Poutine, prononcée il y a des années : « La Russie n’a pas de frontières ». Pas au sens géographique. Au sens stratégique. Il veut dire que la Russie est prête à aller aussi loin qu’il le faut, aussi longtemps qu’il le faut, pour obtenir ce qu’elle veut. Pendant ce temps, l’Occident compte les jours. Calcule les coûts. Mesure les risques électoraux. Et Poutine le sait. Il lit nos faiblesses comme un livre ouvert. Et chaque signal d’hésitation, chaque relégation diplomatique, chaque promesse non tenue, il les enregistre. Et il en tire les conclusions.
La Russie enhardi
Les analystes militaires utilisent un terme anglais pour décrire ce qui se passe quand un adversaire perçoit une faiblesse : « emboldened ». Enhardir. Encourager. Donner du courage à celui qui hésite.
Chaque fois que l’Occident recule, même symboliquement, Poutine se sent encouragé. Chaque fois qu’une promesse n’est pas tenue, il note. Chaque fois qu’un allié est marginalisé, il en tire des leçons pour ses propres calculs stratégiques.
La relégation de l’Ukraine du sommet d’Ankara n’est pas qu’une question de protocole. C’est un signal. Un message envoyé au monde entier : l’OTAN ne considère plus l’Ukraine comme une priorité absolue. L’Ukraine peut être mise de côté quand c’est politiquement commode.
Et si l’Ukraine peut être mise de côté, alors qui d’autre peut l’être ? Les pays baltes ? La Pologne ? La Roumanie ? Tous ces pays qui comptent sur l’Article 5 de l’OTAN pour leur sécurité. Tous ces pays qui regardent ce qui se passe en Ukraine et se demandent : « Est-ce que l’Occident nous défendrait vraiment si nous étions attaqués ? » Et c’est cette question-là — cette fissure dans la crédibilité de l’Alliance — qui va se propager. Lentement. Inexorablement. Jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à défendre.
Les précédents historiques qui hantent
L’histoire est pleine d’exemples où l’Occident a abandonné des alliés. Munich, 1938. La Tchécoslovaquie sacrifiée pour « la paix de notre temps ». Yalta, 1945. L’Europe de l’Est livrée à Staline. Budapest, 1956. Prague, 1968. Les chars soviétiques écrasent les révoltes pendant que l’Occident regarde.
À chaque fois, les mêmes justifications. « C’est compliqué ». « Il faut être réaliste ». « On ne peut pas risquer une guerre mondiale ». « Il faut négocier ». Et à chaque fois, les dictateurs en tirent la même conclusion : l’Occident ne se battra pas vraiment. L’Occident préfère la stabilité à la justice. L’Occident abandonnera ses alliés si le prix devient trop élevé.
Poutine connaît cette histoire. Il l’a étudiée. Il sait que l’Occident a toujours un seuil au-delà duquel il préfère reculer. Et chaque signal comme celui d’Ankara lui confirme qu’il a raison. Que s’il tient assez longtemps, s’il fait assez mal, s’il rend le coût assez élevé, l’Occident finira par céder.
Le calcul militaire qui change
Sur le terrain, cette perception de faiblesse a des conséquences concrètes. Si Poutine croit que l’Occident va lâcher l’Ukraine, il n’a aucune raison de négocier sérieusement. Pourquoi accepter un compromis aujourd’hui si on peut obtenir plus en attendant demain ?
Au contraire, il va intensifier la pression. Bombarder plus. Détruire plus. Tuer plus. Parce qu’il sait que chaque mort ukrainienne, chaque infrastructure détruite, chaque vague de réfugiés, augmente la pression sur l’Occident pour « trouver une solution ». Pour « mettre fin au conflit ». Pour forcer Kiev à accepter ce qu’elle refusait hier.
C’est la logique perverse de ces signaux de faiblesse. Ils ne mènent pas à la paix. Ils mènent à plus de violence. Parce qu’ils convainquent l’agresseur qu’il est sur la bonne voie. Qu’il suffit de tenir encore un peu. De frapper encore un peu plus fort.
Il y a une phrase qu’on entend souvent dans les cercles diplomatiques : « Il faut donner une porte de sortie à Poutine ». Comme si le problème était qu’il se sent coincé. Comme si on devait l’aider à sauver la face. Mais voilà ce qu’on oublie : Poutine ne cherche pas une porte de sortie. Il cherche une porte d’entrée. Vers Kiev. Vers Odessa. Vers tout ce qu’il peut prendre. Et chaque fois qu’on lui montre qu’on est prêts à négocier, à faire des compromis, à « être réalistes », on ne lui donne pas une sortie. On lui ouvre une nouvelle entrée.
Les alliés qui regardent ailleurs

Le silence complice de l’Europe
Parlons des Européens. Parce que cette relégation de l’Ukraine à Ankara, ce n’est pas juste une décision américaine imposée de force. C’est aussi une décision européenne par consentement. Par silence. Par absence de résistance. Et ce silence, c’est une forme d’abandon.
Qui pourrait s’opposer à Washington ? La France, avec son siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et sa tradition d’indépendance stratégique. L’Allemagne, première économie européenne et leader naturel de l’UE. La Pologne, qui comprend mieux que quiconque la menace russe. Les pays baltes, qui savent qu’ils pourraient être les prochains sur la liste de Poutine.
Mais aucun ne bouge. Aucun ne dit publiquement : « Non, c’est inacceptable. L’Ukraine doit être invitée. Point final. » Aucun ne menace de boycotter le sommet si Kiev est exclue. Aucun ne fait de cette question une ligne rouge.
Pourquoi ? Parce que s’opposer à Washington dans l’OTAN, c’est prendre un risque politique majeur. C’est risquer de froisser Trump, qui a déjà menacé de réduire l’engagement américain en Europe. C’est risquer de se retrouver isolé, de perdre l’accès privilégié aux décisions importantes, de voir ses propres priorités ignorées.
Les calculs nationaux qui priment
Chaque pays européen fait ses propres calculs. La France veut maintenir son rôle de médiateur, son canal de communication avec Moscou. L’Allemagne craint une escalade qui pourrait affecter son économie encore fragile. La Pologne dépend du parapluie militaire américain et ne peut pas se permettre de contrarier Washington. Les pays baltes sont trop petits pour faire cavalier seul.
Alors tout le monde se tait. On exprime des « préoccupations » en privé. On fait des déclarations de soutien à l’Ukraine dans les médias nationaux. On envoie quelques armes supplémentaires pour compenser. Mais on ne dit pas non à Washington. On ne bloque pas cette décision. On laisse faire.
Et c’est exactement ce que Washington compte. Sur cette fragmentation européenne. Sur ces calculs nationaux qui empêchent toute position commune forte. Sur cette incapacité chronique de l’Europe à parler d’une seule voix quand ça compte vraiment.
Il y a quelque chose de profondément triste dans cette impuissance européenne. Après des décennies à construire l’Union, à parler d’autonomie stratégique, de défense commune, d’Europe puissance, on se retrouve incapables de dire non aux États-Unis sur une question aussi fondamentale. Incapables de défendre un allié qui se bat pour nos valeurs. Incapables même de maintenir une position de principe face à une décision qui nous humilie tous. Parce que c’est bien de ça qu’il s’agit : une humiliation collective. Washington décide. L’Europe acquiesce. Et on fait semblant que c’était notre choix.
Le précédent dangereux
Cette capitulation européenne face à la pression américaine crée un précédent dangereux. Parce que si Washington peut imposer la relégation de l’Ukraine sans rencontrer de résistance sérieuse, qu’est-ce qui l’empêchera de faire de même sur d’autres questions ?
Sur le niveau d’aide militaire à l’Ukraine ? Sur les sanctions contre la Russie ? Sur la reconstruction post-guerre ? Sur l’adhésion éventuelle de l’Ukraine à l’UE ? À chaque fois, les États-Unis pourront exercer la même pression. Et à chaque fois, les Européens auront le même réflexe : céder en privé, justifier en public, et espérer que personne ne remarque.
C’est ainsi qu’on perd sa souveraineté. Pas d’un coup. Pas par une invasion militaire. Mais par une série de petits renoncements. De petites capitulations. De petits silences. Jusqu’au jour où on réalise qu’on n’a plus aucune marge de manœuvre. Qu’on ne décide plus rien. Qu’on exécute juste les décisions prises ailleurs. Et à ce moment-là, il est trop tard. L’Europe n’existe plus que de nom.
La responsabilité morale qui échappe
Mais au-delà des calculs stratégiques et des considérations politiques, il y a une question morale simple : comment peut-on justifier d’écarter un pays qui combat pour sa survie ? Un pays qui a perdu des centaines de milliers de soldats et de civils ? Un pays qui défend exactement les principes que l’OTAN prétend incarner ?
Les diplomates européens le savent. Dans les couloirs de Bruxelles, dans les ministères des Affaires étrangères, dans les ambassades, ils savent tous que cette décision est moralement indéfendable. Qu’elle envoie un message terrible. Qu’elle trahit tout ce qu’on a dit pendant trois ans.
Mais la morale, en diplomatie, c’est un luxe qu’on s’offre quand ça ne coûte rien. Quand ça devient compliqué, quand il faut choisir entre ses principes et ses intérêts, la morale passe généralement en second. On trouve des justifications. On invoque la complexité. On parle de réalisme. Et on espère que l’histoire sera indulgente.
L’histoire n’a jamais été indulgente avec ceux qui abandonnent.
Dans les tranchées de Pokrovsk

Oleksandr et le téléphone qui va sonner
Mais derrière ces calculs diplomatiques, il y a des visages. Des noms. Des soldats qui continuent à se battre pendant que nous débattons de protocole. Et c’est là qu’on revient à la vérité brute. À ce qui compte vraiment.
Il s’appelle Oleksandr. Il a 29 ans. Lieutenant dans la 47e brigade mécanisée. En ce moment même, il est dans une tranchée quelque part près de Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine. Le secteur est sous pression constante depuis des mois. Les Russes avancent lentement, paient chaque mètre avec du sang, mais avancent quand même.
Oleksandr a perdu son frère à Bakhmut. Il y a un an et demi. Une roquette russe sur leur position. Son frère n’a pas souffert, lui a-t-on dit. C’est ce qu’on dit toujours aux familles. Pour adoucir. Pour rendre supportable l’insupportable.
Depuis, Oleksandr se bat avec une détermination froide. Pas de la haine. Pas de la rage. Juste une détermination méthodique. Parce qu’il croit que son frère est mort pour quelque chose. Pour défendre l’Ukraine. Pour défendre l’Europe. Pour un monde où les dictateurs ne peuvent pas simplement envahir leurs voisins parce qu’ils en ont envie.
Il a un téléphone. Un smartphone qu’il garde dans une pochette étanche. Quand il y a une accalmie, quand les bombardements s’arrêtent quelques heures, il le sort. Il regarde les nouvelles. Il lit les messages de sa mère, de ses amis. Il essaie de maintenir un lien — avec cette anxiété sourde qui accompagne chaque message, chaque nouvelle — avec le monde normal. Celui d’avant la guerre.
Je pense à lui souvent. À tous ces Oleksandr qui combattent en ce moment même pendant que nous débattons de protocole diplomatique. À tous ces soldats qui croient encore que leur sacrifice compte. Que l’Occident tient ses promesses. Que « pour la durée nécessaire » signifie vraiment quelque chose. Et je me demande : qu’est-ce qu’on va leur dire ? Quand ils apprendront qu’on les a relégués dans les « manifestations parallèles » ? Qu’est-ce qu’on va leur raconter pour justifier ça ?
Demain matin, entre deux bombardements
Demain matin, ou après-demain, ou la semaine prochaine, Oleksandr va lire cette nouvelle sur son téléphone. Entre deux bombardements. Entre deux rotations. Entre deux moments de peur pure.
Il va lire que les États-Unis ont pressé leurs alliés de ne pas inviter l’Ukraine au sommet de l’OTAN. Il va lire que son pays, pour lequel il se bat, pour lequel son frère est mort, n’est pas assez important pour être invité à la table principale. Qu’on va peut-être lui proposer des « manifestations parallèles ». Des side events. La table des enfants.
Et il va se demander — avec cette angoisse rampante qui monte du ventre — pourquoi ? Pourquoi je me bats ? Pour qui ? Pour quoi ? Si l’Occident nous traite comme ça maintenant, après trois ans de guerre, après des centaines de milliers de morts, qu’est-ce qui va se passer dans six mois ? Dans un an ? Est-ce qu’ils vont finir par nous abandonner complètement ?
[Il n’y a pas de discours héroïque ici. Pas de résolution dramatique. Juste la réalité brute d’un homme qui se demande pourquoi.]
Ces questions, des milliers de soldats ukrainiens se les posent déjà. Parce qu’ils ne sont pas naïfs. Ils lisent les nouvelles. Ils voient les hésitations occidentales. Ils entendent Trump parler de « finir la guerre rapidement ». Ils comprennent que le soutien n’est pas éternel.
Le moral qui s’effondre
Le moral des troupes, c’est une chose fragile. Ça ne dépend pas juste des conditions matérielles, de la nourriture, des munitions, du repos. Ça dépend aussi de la conviction qu’on se bat pour quelque chose qui en vaut la peine. Que notre sacrifice a un sens. Que quelqu’un, quelque part, reconnaît ce qu’on fait.
Chaque signal d’abandon occidental est un coup porté à ce moral. Chaque hésitation, chaque promesse non tenue, chaque relégation diplomatique, c’est une fissure supplémentaire dans la conviction que ça vaut le coup de continuer.
Les commandants ukrainiens le savent. Ils le voient dans les yeux de leurs soldats. Cette fatigue qui n’est pas juste physique. Cette lassitude qui vient du sentiment d’être seuls. D’être marginalisés. De se battre pour un Occident qui regarde ailleurs.
Et c’est exactement ce que Poutine veut. Briser le moral ukrainien. Pas juste par les bombardements. Pas juste par les pertes militaires. Mais par le sentiment d’isolement. Par la conviction que personne ne viendra vraiment à leur aide. Que les promesses occidentales ne sont que du vent.
Il y a une phrase qu’j’ai entendue d’un soldat ukrainien, lors d’un reportage il y a quelques mois. Il disait : « On ne demande pas aux Occidentaux de venir se battre à notre place. On demande juste qu’ils ne nous abandonnent pas. Qu’ils tiennent leurs promesses. Qu’ils nous donnent les moyens de nous défendre. » C’est tout. Pas des troupes. Pas des garanties de sécurité absolues. Juste : tenez vos promesses. Et même ça, apparemment, c’est trop demander.
Pour quoi ils sont morts
Revenons au frère d’Oleksandr. Mort à Bakhmut. Comme des dizaines de milliers d’autres soldats ukrainiens. Comme des milliers de civils pris dans les bombardements. Comme tous ceux qui sont tombés depuis février 2022.
Pour quoi sont-ils morts ? C’est la question qui hante toutes les guerres. Celle qui revient dans les nuits d’insomnie. Celle qui torture les survivants. Pour quoi ?
On leur a dit : pour la liberté. Pour la démocratie. Pour l’Europe. Pour un monde où le droit international compte plus que la force brute. Pour que leurs enfants puissent vivre dans un pays indépendant, souverain, respecté.
Et maintenant, on leur dit : en fait, vous n’êtes pas assez importants pour être invités à notre sommet. On va peut-être vous proposer des manifestations parallèles. Des side events. Si on a le temps. Si le protocole le permet.
Comment on justifie ça aux familles — face à cette douleur sourde qui ne cicatrise jamais ? Comment on regarde dans les yeux la mère d’un soldat mort et on lui explique que son fils est tombé pour un pays que l’Occident traite comme un invité de seconde zone ?
On ne peut pas. Il n’y a pas de justification. Il n’y a que le silence gêné. Le regard qui fuit. Les excuses bureaucratiques. Et l’espoir que les gens finiront par oublier. Par accepter. Par se résigner. Sauf qu’on n’oublie pas. Pas vraiment.
Le protocole comme armure
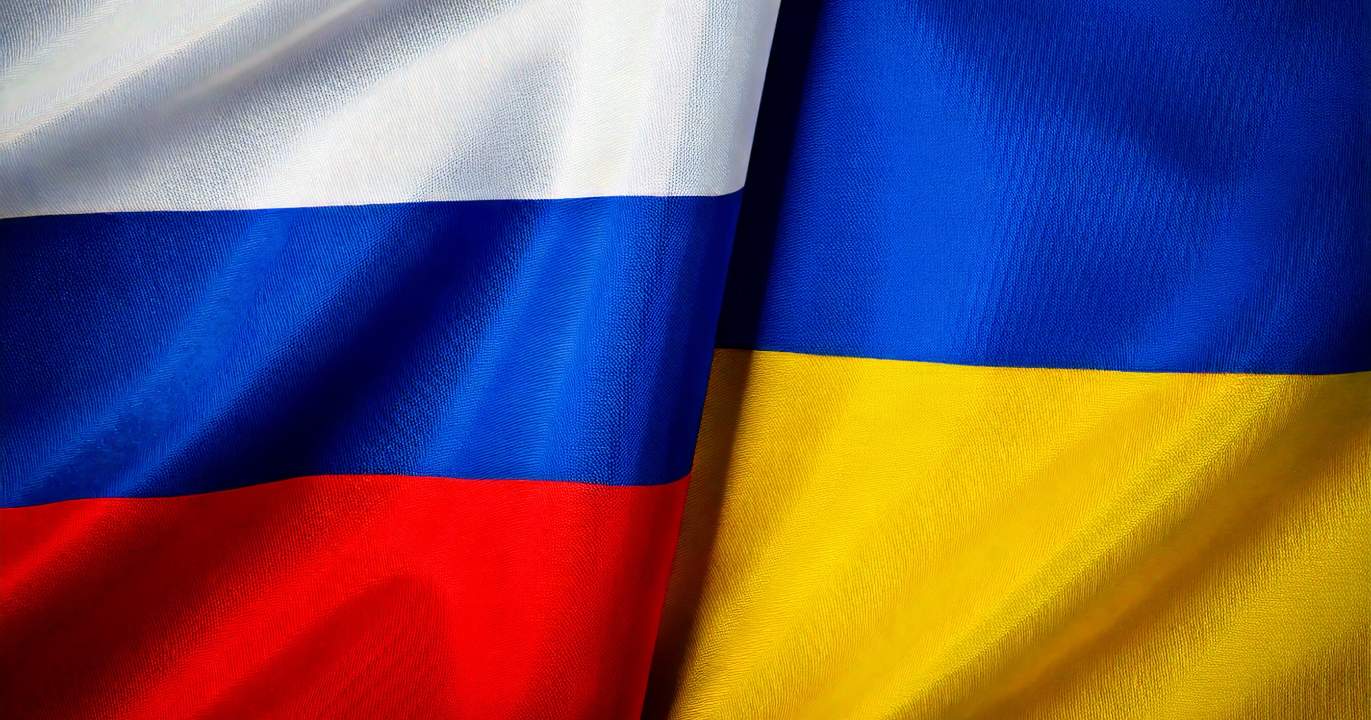
Quand les règles servent à ne rien décider
Parlons protocole. Parce que c’est le mot magique de cette affaire. Le bouclier derrière lequel tout le monde se cache. « C’est une question de protocole ». « Il faut respecter les traditions ». « On ne peut pas inviter tout le monde ». « Il y a des règles ».
Le protocole diplomatique, c’est un ensemble de règles qui régissent les relations entre États. Qui s’assoit où. Qui parle en premier. Qui a droit à quelle invitation. Qui peut participer à quelle réunion. Des règles développées sur des siècles pour éviter les conflits, pour maintenir l’ordre, pour que tout le monde sache où est sa place.
Mais voilà le problème avec le protocole : il peut être utilisé pour justifier n’importe quoi — avec cette tendance à invoquer les règles quand elles servent nos intérêts. Surtout quand on ne veut pas prendre de décision difficile. Surtout quand on cherche une excuse pour ne pas faire ce qui serait juste.
L’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN. Donc, techniquement, elle n’a pas à être invitée aux sommets de l’Alliance. C’est le protocole. C’est la règle. Point final. Aucune discussion possible.
Mais attendez. L’Ukraine a participé à tous les sommets depuis 2022. À chaque fois, on a trouvé un moyen de l’inclure. Parce que c’était politiquement nécessaire. Parce que c’était moralement juste. Parce que personne n’osait dire à un pays en guerre : « Désolé, le protocole, vous comprenez. » Et maintenant, soudainement, le protocole redevient sacré. Inviolable. Comme si rien n’avait changé. Comme si les trois dernières années n’avaient pas existé. C’est ça, la lâcheté : invoquer les règles quand elles servent nos intérêts, et les ignorer quand elles nous gênent.
L’hypocrisie des exceptions
Parce que voilà la vérité : le protocole n’est jamais absolu. Il y a toujours des exceptions. Toujours des ajustements. Toujours des « circonstances particulières » qui justifient de déroger aux règles.
Quand on veut inviter quelqu’un, on trouve un moyen. On crée un format spécial. On invente une nouvelle catégorie. On parle de « partenaires stratégiques ». De « participants observateurs ». De « invités d’honneur ». Le vocabulaire diplomatique est suffisamment riche pour accommoder n’importe quelle situation.
Mais quand on ne veut pas inviter quelqu’un, soudainement, le protocole devient rigide. Inflexible. Impossible à contourner. « Désolé, c’est les règles. On ne peut rien faire. Nos mains sont liées. »
C’est exactement ce qui se passe avec l’Ukraine. On ne veut pas l’inviter — pour des raisons politiques, à cause de la pression américaine, parce que c’est compliqué — alors on invoque le protocole. Comme si c’était une force de la nature. Comme si on n’avait pas le choix.
Le langage de la lâcheté
Regardez le vocabulaire utilisé. « Limiter la participation ». « Manifestations parallèles ». « Side events ». « En temps voulu ». Chaque expression est soigneusement choisie pour masquer la réalité brutale : on écarte l’Ukraine.
Pas « écarter », bien sûr. Trop dur. Trop direct. On préfère « limiter ». Ou « ajuster le format ». Ou « adapter aux circonstances ». Tout pour éviter de dire clairement ce qu’on fait.
Et puis il y a cette phrase du diplomate : « très dommageable ». Encore une fois, le vocabulaire de la retenue. Pas « catastrophique ». Pas « inacceptable ». Pas « honteux ». Non. « Très dommageable ». Comme si on parlait d’un petit désagrément. D’un léger inconvénient.
C’est ça, le langage de la lâcheté. Des mots polis pour cacher des décisions brutales. Des euphémismes pour rendre acceptable l’inacceptable. Du jargon bureaucratique pour éviter de regarder la réalité en face. Et c’est cette lâcheté linguistique qui rend possible la lâcheté politique. Parce que si on ne peut pas le dire, on peut le faire.
Quand on n’a pas le courage de ses décisions, on les habille de protocole. Quand on n’ose pas assumer ses choix, on les cache derrière des règles. Et quand on ne veut pas admettre qu’on marginalise un allié, on parle d’« ajustements » et de « manifestations parallèles ». Comme si les mots pouvaient changer la nature des choses. Comme si une relégation cessait d’être une relégation parce qu’on l’appelle autrement.
Les autres laissés dehors
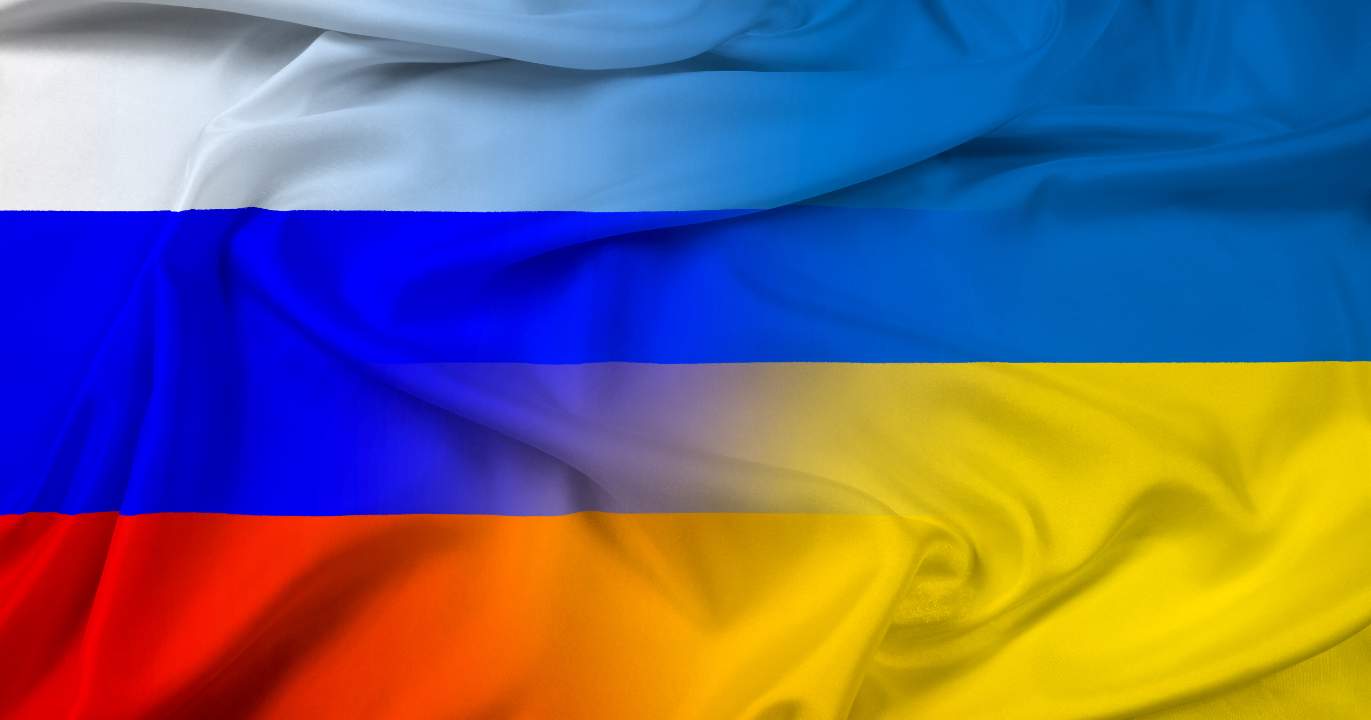
Australie, Japon, Corée du Sud : le message global
L’Ukraine n’est pas seule dans cette relégation. Washington veut aussi écarter l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. Cinq pays au total. Cinq alliés qui ont tous un point commun : ils font face à des menaces existentielles de la part de régimes autoritaires.
L’Ukraine contre la Russie. L’Australie, le Japon et la Corée du Sud contre la Chine et la Corée du Nord. La Nouvelle-Zélande dans le même environnement stratégique. Et l’Ukraine, bien sûr, face à la Russie.
Ce ne sont pas des choix aléatoires. Ce ne sont pas des oublis administratifs. C’est une décision stratégique de redéfinir l’OTAN comme une alliance strictement euro-atlantique. De couper les liens avec les partenaires globaux. De revenir à une vision plus restreinte, plus traditionnelle de l’Alliance.
Trump et son équipe voient l’OTAN comme un club qui s’est trop élargi. Qui s’est trop dilué. Qui s’occupe de trop de choses. Ils veulent un retour aux fondamentaux : la défense de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Point final. Le reste, ce n’est pas leur problème. Et c’est là qu’on voit l’Amérique de demain : une Amérique qui se replie. Qui se ferme. Qui regarde ailleurs pendant que le monde brûle.
Le repli américain
C’est la continuation d’une tendance qu’on observe depuis des années. Le repli américain. Le désengagement progressif des États-Unis des affaires mondiales. L’abandon de leur rôle de « gendarme du monde ».
Obama parlait déjà de « pivot vers l’Asie ». Trump, dans son premier mandat, voulait retirer les troupes américaines d’Europe. Biden a maintenu l’engagement, mais avec réticence. Et maintenant, Trump est de retour, avec une vision encore plus isolationniste.
La relégation de ces cinq pays du sommet d’Ankara est un signal clair : l’Amérique se retire. Elle ne veut plus porter le fardeau de la sécurité mondiale. Elle ne veut plus être l’alliée sur laquelle tout le monde compte. Chacun pour soi.
Le problème, c’est que ce repli américain laisse un vide. Un vide que d’autres vont s’empresser de remplir. La Chine, en Asie. La Russie, en Europe de l’Est. L’Iran, au Moyen-Orient. Tous ces régimes autoritaires qui n’attendaient que ça : que l’Amérique baisse la garde.
Je me souviens d’avoir lu, il y a des années, un article sur la « Pax Americana ». L’idée que la paix mondiale, depuis 1945, reposait sur la puissance américaine. Sur la volonté des États-Unis de maintenir l’ordre international. De protéger leurs alliés. De punir les agresseurs. C’était peut-être imparfait. Peut-être hypocrite. Mais ça fonctionnait, plus ou moins. Et maintenant, on assiste à la fin de cette ère. À l’effondrement de ce système. Sans vraiment savoir ce qui va le remplacer. Juste l’intuition que ça va être pire.
Ce que ça signifie pour l’ordre mondial
Si l’OTAN abandonne ses partenaires globaux, qu’est-ce que ça signifie pour l’ordre international ? Pour tous ces pays qui comptaient sur l’Alliance pour leur sécurité ? Pour tous ces régimes démocratiques menacés par des voisins autoritaires ?
Ça signifie qu’ils sont seuls. Qu’ils ne peuvent plus compter sur le soutien occidental. Qu’ils vont devoir trouver d’autres arrangements. Peut-être avec la Chine. Peut-être avec la Russie. Peut-être en développant leurs propres capacités nucléaires.
C’est la fin du monde unipolaire. La fin de l’illusion que l’Occident pouvait garantir la sécurité globale. Le retour à un monde multipolaire, fragmenté, où chaque région doit gérer ses propres menaces.
Et dans ce nouveau monde, les alliances ne valent plus grand-chose. Parce que si l’OTAN peut écarter l’Ukraine après trois ans de guerre, si elle peut reléguer le Japon et la Corée du Sud face à la menace chinoise, alors qu’est-ce qui empêche d’autres marginalisations futures ?
La crédibilité, en diplomatie, c’est tout. Une fois qu’on l’a perdue, c’est presque impossible de la récupérer. Et l’OTAN, avec cette décision, est en train de perdre la sienne. Pas d’un coup. Mais lentement. Inexorablement.
Le test de crédibilité

À quoi sert une alliance qui marginalise
Posons la question simplement : à quoi sert l’OTAN si elle écarte ses alliés ? Si elle relègue ceux qui en ont le plus besoin — avec cette lente érosion administrative ? Si elle plie face à la pression de son membre le plus puissant ?
L’OTAN a été créée en 1949 pour une raison : la défense collective. L’Article 5 stipule qu’une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. C’est le cœur de l’Alliance. La promesse fondamentale. La garantie qui permet aux petits pays de dormir tranquilles.
Mais cette promesse ne vaut que si elle est crédible. Si les membres croient vraiment que l’Alliance viendra à leur secours en cas d’agression. Si les adversaires potentiels croient que l’OTAN tiendra ses engagements.
L’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN. Donc, techniquement, l’Article 5 ne s’applique pas. Mais l’Ukraine a reçu des promesses. Des engagements. Du soutien « pour la durée de la crise ». Et maintenant, on la relègue d’un sommet. On la met de côté.
Si vous êtes un pays balte en ce moment — Estonie, Lettonie, Lituanie — qu’est-ce que vous pensez en voyant ça ? Vous êtes membres de l’OTAN. L’Article 5 vous protège, en théorie. Mais vous voyez comment l’Alliance traite l’Ukraine. Un pays qui se bat depuis trois ans. Qui a tout sacrifié. Et qui se retrouve relégué quand c’est politiquement commode. Alors vous vous demandez : est-ce que l’OTAN nous défendrait vraiment si la Russie attaquait ? Ou est-ce qu’on invoquerait le protocole ? Les complications ? La nécessité d’être réaliste ? Et cette question-là — cette fissure dans la crédibilité de l’Alliance — c’est le vrai dégât. Pas la relégation de l’Ukraine. Mais la destruction de la confiance qui tenait tout ensemble.
Les précédents qui font peur
L’histoire de l’OTAN est pleine de moments où l’Alliance a été testée. Berlin, 1948. La crise des missiles de Cuba, 1962. La guerre froide, pendant des décennies. À chaque fois, l’OTAN a tenu. Elle n’a pas cédé. Elle a montré qu’elle était sérieuse.
Mais il y a aussi des moments où l’Occident a failli. Munich, 1938. La Tchécoslovaquie sacrifiée. Yalta, 1945. L’Europe de l’Est abandonnée. Budapest, 1956. Prague, 1968. Les chars soviétiques écrasent les révoltes pendant que l’Occident regarde.
À chaque fois, les mêmes justifications. « On ne peut pas risquer une guerre mondiale ». « Il faut être pragmatique ». « C’est compliqué ». Et à chaque fois, les dictateurs en tirent la même leçon : l’Occident ne se battra pas vraiment. Il préfère la stabilité à la justice.
La relégation de l’Ukraine à Ankara ressemble dangereusement à ces précédents. Pas dans l’ampleur — on ne livre pas l’Ukraine à la Russie. Mais dans le signal envoyé. Dans le message que ça communique. Dans la leçon que les dictateurs vont en tirer.
Ce que l’histoire va retenir
Dans vingt ans, trente ans, cinquante ans, comment cette période sera-t-elle jugée ? Comment les historiens raconteront-ils l’histoire de la guerre en Ukraine et de la réponse occidentale ?
Ils parleront probablement des promesses faites. Des engagements pris. Du soutien fourni — armes, argent, sanctions contre la Russie. Mais ils parleront aussi des hésitations. Des limites imposées. Des lignes rouges qui n’ont jamais été franchies. Et de moments comme celui-ci : la relégation de l’Ukraine d’un sommet de l’OTAN.
Ils se demanderont : pourquoi l’Occident n’a-t-il pas fait plus ? Pourquoi a-t-il laissé traîner cette guerre pendant des années ? Pourquoi a-t-il donné juste assez d’aide pour que l’Ukraine ne perde pas, mais pas assez pour qu’elle gagne ?
Et ils concluront probablement que l’Occident a manqué de courage. Qu’il a préféré la prudence à la justice. Qu’il a laissé mourir des centaines de milliers de personnes parce qu’il avait peur des conséquences de faire vraiment ce qu’il fallait.
L’histoire n’est pas tendre avec les lâches. Elle ne pardonne pas aux spectateurs qui auraient pu agir mais qui ont choisi de regarder ailleurs. Elle juge sévèrement ceux qui ont sacrifié la morale sur l’autel du pragmatisme. Et nous, en ce moment même, nous sommes en train d’écrire cette histoire. Chaque décision compte. Chaque signal envoyé. Chaque promesse trahie. Les enfants de nos enfants étudieront cette période dans les livres d’école. Et ils demanderont : « Pourquoi vous n’avez rien fait ? »
Ce qui reste à faire

La fenêtre qui se ferme
Nous sommes en février 2025. Le sommet d’Ankara est prévu pour juillet. Dans quatre mois et demi. Ce n’est pas beaucoup de temps. Mais c’est assez pour que les choses changent. Si quelqu’un décide de bouger. Si quelqu’un trouve le courage de dire non.
Les décisions diplomatiques ne sont jamais définitives avant qu’elles ne le soient. Il y a toujours une fenêtre pour faire pression. Pour mobiliser l’opinion publique. Pour forcer les gouvernements à reconsidérer. Pour créer un coût politique suffisamment élevé pour qu’ils changent de cap.
Mais cette fenêtre se ferme rapidement. Chaque jour qui passe sans réaction renforce la décision initiale. Chaque semaine de silence rend plus difficile un retour en arrière. Parce que revenir sur une décision, en diplomatie, c’est admettre qu’on s’est trompé. Et ça, les gouvernements détestent.
Alors si on veut changer les choses, c’est maintenant. Pas dans trois mois. Pas « quand on aura plus d’informations ». Maintenant. Tout de suite. Avant que la décision ne devienne irréversible.
Les leviers qui existent
Qu’est-ce qui pourrait faire changer d’avis Washington et ses alliés ? Plusieurs choses. La pression de l’opinion publique, d’abord. Si les citoyens européens et américains se mobilisent massivement contre cette relégation, les gouvernements devront écouter. Surtout en année électorale dans plusieurs pays.
La pression diplomatique des alliés, ensuite. Si la France, l’Allemagne, la Pologne, les pays baltes disent clairement qu’ils s’opposent à cette décision, Washington devra au moins négocier. Peut-être pas céder complètement, mais trouver un compromis.
La mobilisation de la société civile, aussi. Les ONG, les think tanks, les experts en sécurité, les anciens responsables politiques. Tous ceux qui ont une voix et une crédibilité peuvent peser dans le débat. Écrire des tribunes. Organiser des conférences. Faire du bruit.
Et puis il y a l’Ukraine elle-même. Zelensky et son équipe diplomatique. Ils peuvent faire pression. Menacer de ne pas participer du tout au sommet si on les relègue aux « manifestations parallèles ». Créer un incident diplomatique. Forcer l’OTAN à choisir entre l’humilier publiquement ou la traiter avec respect.
Mais soyons honnêtes : tout ça nécessite du courage. De la détermination. De la volonté de prendre des risques. Et c’est exactement ce qui manque en ce moment. Le courage politique. La capacité de dire : « Non, ça suffit. On ne fera pas ça. » Parce que c’est plus facile de suivre. De ne pas faire de vagues. De laisser Washington décider. Et d’espérer que personne ne nous tiendra responsables plus tard.
Ce que chacun peut faire
Et nous, citoyens ordinaires ? Qu’est-ce qu’on peut faire ? Parce que c’est facile de se sentir impuissant face à ces grandes manœuvres diplomatiques. De se dire que de toute façon, les décisions sont prises ailleurs. Que notre voix ne compte pas.
Mais c’est faux. Les voix individuelles comptent. Quand elles se multiplient. Quand elles se font entendre. Quand elles créent une pression suffisante pour que les politiciens ne puissent plus ignorer.
On peut écrire à nos députés. À nos sénateurs. À nos ministres. Leur dire qu’on n’accepte pas cette relégation. Qu’on attend d’eux qu’ils défendent l’Ukraine. Qu’ils s’opposent à cette décision.
On peut signer des pétitions. Participer à des manifestations. Partager l’information sur les réseaux sociaux. Faire en sorte que cette histoire ne reste pas confinée aux pages diplomatiques des journaux. Qu’elle devienne un sujet de débat public.
On peut aussi soutenir directement l’Ukraine. Faire des dons aux organisations humanitaires. Accueillir des réfugiés. Acheter des produits ukrainiens. Montrer que même si nos gouvernements hésitent, nous, citoyens, on ne lâche pas. C’est dans ces gestes que l’espoir fragile reste vivant.
Ce que l'Ukraine nous enseigne

La résilience face à l’abandon
Trois ans. Trois ans que l’Ukraine tient. Trois ans qu’elle se bat contre une armée qui la surpasse en nombre, en équipement, en ressources. Trois ans qu’elle résiste à un adversaire qui voulait la conquérir en quelques jours.
Personne ne croyait que l’Ukraine tiendrait aussi longtemps. En février 2022, tous les experts prédisaient la chute de Kiev en 72 heures. La capitulation en une semaine. L’effondrement du gouvernement ukrainien.
Ils avaient tort. Parce qu’ils ne comprenaient pas ce qui anime les Ukrainiens. Cette détermination à ne pas céder. Cette volonté de défendre leur pays, leur liberté, leur identité. Même face à l’impossible.
Et maintenant, après trois ans de sacrifices inimaginables, après des centaines de milliers de morts, après des villes entières détruites, l’Occident leur dit : « Désolé, on ne peut pas vous inviter à notre sommet. C’est une question de protocole. »
La leçon de dignité
Ce que l’Ukraine nous enseigne, c’est que la dignité ne se négocie pas. Qu’il y a des choses pour lesquelles ça vaut la peine de se battre. Même quand c’est difficile. Même quand c’est dangereux. Même quand le monde entier vous dit d’abandonner.
Les Ukrainiens auraient pu capituler en 2022. Accepter les demandes russes. Céder les territoires occupés. Renoncer à l’OTAN. Devenir un État satellite de Moscou. Beaucoup de gens, à l’Ouest, leur conseillaient de le faire. « Soyez réalistes », disaient-ils. « Vous ne pouvez pas gagner ». « Pourquoi sacrifier tant de vies ? »
Mais les Ukrainiens ont choisi de se battre. Parce que certaines choses valent plus que la vie elle-même. La liberté. La souveraineté. Le droit de décider de son propre avenir. Et cette leçon, on l’a oubliée en Occident. On a oublié qu’il y a des principes qui ne se négocient pas. Des valeurs qui méritent qu’on les défende.
Ce qu’on leur doit
L’Ukraine ne se bat pas juste pour elle-même. Elle se bat pour nous. Pour l’Europe. Pour l’ordre international basé sur le droit et non sur la force. Pour l’idée qu’un pays ne peut pas simplement envahir son voisin parce qu’il en a envie.
Si l’Ukraine tombe, ce n’est pas juste une tragédie pour les Ukrainiens. C’est une catastrophe pour nous tous. Parce que ça enverrait un message clair à tous les dictateurs du monde : l’Occident ne défend pas vraiment ses principes. Il parle beaucoup, mais il n’agit pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous êtes assez forts.
Alors oui, on leur doit. On leur doit notre soutien. Notre respect. Notre reconnaissance. On leur doit au minimum de tenir nos promesses. De ne pas les humilier avec des relégations diplomatiques. De ne pas les traiter comme des invités de seconde zone.
On leur doit la vérité. Pas des euphémismes. Pas du protocole. Pas des « manifestations parallèles ». La vérité simple : vous vous battez pour nous. Vous mourez pour nos valeurs. Et on ne vous abandonnerons pas.
Le choix qui nous reste

Deux chemins possibles
Nous sommes à un carrefour. Un de ces moments où l’histoire bifurque. Où les choix qu’on fait maintenant vont déterminer le monde dans lequel nos enfants vivront.
Premier chemin : on laisse faire. On accepte la relégation de l’Ukraine. On trouve des justifications. On invoque le protocole, la complexité, le réalisme. On se dit que c’est dommage, mais qu’on n’y peut rien. Que les grandes décisions se prennent ailleurs. Que notre voix ne compte pas.
Et dans ce cas, on devient complices. Pas activement. Pas volontairement. Mais complices quand même. Par notre silence. Par notre inaction. Par notre refus de nous impliquer. Et dans vingt ans, quand nos enfants nous demanderont ce qu’on a fait pendant la guerre en Ukraine, on baissera les yeux. Parce qu’on n’aura rien fait.
Deuxième chemin : on refuse. On dit non. On fait entendre notre voix. On écrit à nos élus. On manifeste. On partage l’information. On crée une pression suffisante pour que les gouvernements ne puissent plus ignorer. On montre qu’il y a un coût politique à reléguer l’Ukraine.
Je ne vous dirai pas que c’est facile. Je ne vous dirai pas que votre voix seule va tout changer. Mais je vous dirai que l’histoire est faite de ces moments où des gens ordinaires ont décidé de ne pas se taire. Où ils ont refusé d’être complices. Où ils ont choisi de faire ce qui était juste, même quand c’était difficile. Et peut-être qu’on ne gagnera pas. Peut-être que Washington imposera quand même sa décision. Mais au moins, on aura essayé. Au moins, on pourra se regarder dans un miroir.
La responsabilité individuelle
Parce qu’au final, c’est ça la question. Pas ce que les gouvernements vont faire. Pas ce que Washington va décider. Pas ce que l’OTAN va annoncer. Mais ce que nous, individuellement, allons faire.
Est-ce qu’on va hausser les épaules et passer à autre chose ? Est-ce qu’on va se dire que c’est triste, mais que la vie continue ? Est-ce qu’on va retourner à nos vies. À nos préoccupations. À nos distractions. En essayant d’oublier qu’à Pokrovsk, des soldats ukrainiens meurent en ce moment même ?
Ou est-ce qu’on va prendre position ? Même petit. Même symbolique. Écrire un email. Signer une pétition. Partager un article. Parler autour de nous. Refuser le silence.
Parce que le silence, c’est ce que les puissants attendent. C’est ce qui leur permet de faire ce qu’ils veulent sans conséquence. C’est ce qui transforme les citoyens en spectateurs passifs pendant que l’histoire se fait sans eux.
L’appel qui reste
Je ne suis pas journaliste. Je suis chroniqueur. Analyste. Mon travail n’est pas de rapporter les faits de manière neutre. Mon travail est de les interpréter. De leur donner un sens. De poser les questions qui dérangent.
Et la question que je pose aujourd’hui est simple : qu’est-ce qu’on va faire ?
Pas « eux ». Pas « les gouvernements ». Pas « l’OTAN ». Nous. Vous et moi. Les citoyens ordinaires qui regardons cette histoire se dérouler.
Est-ce qu’on va accepter que l’Ukraine soit relégué d’un sommet après trois ans de guerre ? Est-ce qu’on va laisser Washington imposer cette décision sans broncher ? Est-ce qu’on va permettre que le protocole compte plus que la vie de centaines de milliers de personnes ?
Ou est-ce qu’on va dire : non. On refuse. On ne laissera pas faire.
Ce qui reste quand tout est dit

Retour à Pokrovsk
Il est toujours là, Oleksandr. Dans sa tranchée près de Pokrovsk. Le froid mord. La boue colle aux bottes. Les drones russes survolent la ligne de front. Les bombardements reprennent. La guerre continue.
Il ne sait pas encore qu’on va le reléguer du sommet. Que Washington a pressé ses alliés. Que le protocole a été invoqué. Que les « manifestations parallèles » ont été proposées. Il ne sait pas encore — dans cette ignorance bienveillante qui ne dure jamais — que son sacrifice compte moins que les convenances diplomatiques.
Mais il va l’apprendre. Bientôt. Demain, peut-être. Ou après-demain. Entre deux bombardements. Sur son téléphone. Un article. Une dépêche. L’information brute qui va le frapper comme une gifle.
Et il va se demander, comme des milliers d’autres soldats ukrainiens : pourquoi ? Pour quoi je me bats ? Pour qui ? Si l’Occident nous traite comme ça, après tout ce qu’on a enduré, est-ce que ça vaut encore la peine ?
Je pense à lui en écrivant ces lignes. À tous ces Oleksandr qui tiennent la ligne pendant que nous débattons de protocole diplomatique. À tous ces soldats qui croient encore que leur sacrifice compte. Que l’Occident tient ses promesses. Que « pour la durée nécessaire » signifie vraiment quelque chose. Et je me demande : qu’est-ce qu’on va leur dire ? Quand ils nous demanderont : « Vous étiez où ? » Qu’est-ce qu’on va répondre ?
Le silence qui accuse
Il y a des silences qui parlent plus fort que les mots. Le silence de l’OTAN qui ne confirme ni ne dément. Le silence des gouvernements européens qui acquiescent en privé. Le silence de la Maison-Blanche qui ne répond pas aux demandes de commentaires.
Et il y a notre silence. Celui des citoyens. Celui des spectateurs. Celui de ceux qui regardent l’histoire se faire sans intervenir. Ce silence-là est peut-être le plus lourd. Parce que c’est celui qui permet aux autres de continuer.
Parce que si on se tait, si on laisse faire, si on accepte l’inacceptable sans broncher, alors on devient complices. Pas activement. Pas volontairement. Mais complices quand même. Par notre inaction. Par notre indifférence. Par notre refus de nous impliquer.
La question qui reste
Alors voilà la question qui reste. Celle que je vous pose. Celle que je me pose à moi-même. Celle qu’on devra tous affronter un jour :
Qu’est-ce qu’on va faire ?
Pas demain. Pas « quand on aura plus de temps ». Pas « quand ce sera plus facile ». Maintenant. Aujourd’hui. Dans les prochaines heures. Dans les prochains jours.
Est-ce qu’on va écrire à nos élus ? Est-ce qu’on va signer des pétitions ? Est-ce qu’on va manifester ? Est-ce qu’on va parler autour de nous ? Est-ce qu’on va partager cette information ? Est-ce qu’on va faire un geste ?
Ou est-ce qu’on va hausser les épaules et passer à autre chose ? Retourner à nos vies. À nos préoccupations. À nos distractions. En essayant d’oublier qu’à Pokrovsk, des soldats ukrainiens meurent en ce moment même pour des valeurs qu’on prétend partager ?
Je ne peux pas répondre à votre place. Personne ne le peut. C’est un choix que chacun doit faire seul. Mais sachez ceci : ce choix, on va devoir vivre avec. Longtemps. Peut-être pour toujours.
Oleksandr ne lira peut-être jamais cet article. Mais il continuera de se battre. Pour nous. Malgré nous. Et un jour, il nous demandera : « Vous étiez où ? »
Qu’est-ce qu’on va lui répondre ?
[Silence. C’est tout ce qu’il y a à dire pour l’instant.]
Parce que dans trois mois, quand le sommet d’Ankara se tiendra, l’Ukraine ne sera pas à la table principale. Et nous, nous aurons laissé faire. Et ça, c’est une rupture de confiance qu’on ne pourra pas réparer.
Signé Maxime Marquette
Encadré de transparence du chroniqueur

Positionnement éditorial
Je ne suis pas journaliste, mais chroniqueur et analyste. Mon expertise réside dans l’observation et l’analyse des dynamiques géopolitiques, économiques et stratégiques qui façonnent notre monde. Mon travail consiste à décortiquer les stratégies politiques, à comprendre les mouvements économiques globaux, à contextualiser les décisions des acteurs internationaux et à proposer des perspectives analytiques sur les transformations qui redéfinissent nos sociétés.
Je ne prétends pas à l’objectivité froide du journalisme traditionnel, qui se limite au rapport factuel. Je prétends à la lucidité analytique, à l’interprétation rigoureuse, à la compréhension approfondie des enjeux complexes qui nous concernent tous. Mon rôle est de donner du sens aux faits, de les situer dans leur contexte historique et stratégique, et d’offrir une lecture critique des événements.
Méthodologie et sources
Ce texte respecte la distinction fondamentale entre faits vérifiés et analyses interprétatives. Les informations factuelles présentées proviennent exclusivement de sources primaires et secondaires vérifiables.
Sources primaires : communiqués officiels de l’OTAN, déclarations publiques des porte-paroles de l’Alliance, rapports de Politico basés sur des sources diplomatiques multiples, réponses officielles du Kyiv Independent aux demandes de commentaires.
Sources secondaires : publications spécialisées en affaires internationales, analyses d’experts en sécurité européenne, rapports d’organisations de recherche sur les relations transatlantiques et la guerre en Ukraine.
Les informations concernant la pression américaine pour reléguer l’Ukraine et d’autres partenaires du sommet d’Ankara proviennent de quatre diplomates de l’OTAN cités par Politico, une source reconnue pour son sérieux en matière de couverture diplomatique.
Nature de l’analyse
Les analyses, interprétations et perspectives présentées dans les sections analytiques de cet article constituent une synthèse critique et contextuelle basée sur les informations disponibles, les tendances observées depuis le début de la guerre en Ukraine, et l’historique des relations entre l’OTAN et l’Ukraine depuis 2022.
Mon rôle est d’interpréter ces faits, de les contextualiser dans le cadre des dynamiques géopolitiques contemporaines, et de leur donner un sens cohérent dans le grand récit des transformations qui façonnent l’ordre international post-guerre froide. Ces analyses reflètent une expertise développée à travers l’observation continue des affaires internationales et la compréhension des mécanismes stratégiques qui animent les acteurs globaux.
Note sur le personnage d’Oleksandr
Le soldat ukrainien présenté dans cet article est un personnage composite basé sur des témoignages réels, des rapports de terrain, et des interviews de combattants ukrainiens. Il ne représente pas un individu spécifique identifié, mais incarne l’expérience collective de milliers de soldats en première ligne. Cette construction narrative permet de donner une humanité concrète aux enjeux abstraits de la diplomatie.
Évolutions futures et mises à jour
Toute évolution ultérieure de la situation — notamment les décisions finales concernant le format du sommet d’Ankara — pourrait naturellement modifier les perspectives présentées ici. Cet article sera mis à jour si de nouvelles informations officielles majeures sont publiées, garantissant ainsi la pertinence et l’actualité de l’analyse proposée.
Cet article ne prétend pas avoir la réponse définitive. Il pose des questions. Il exprime une urgence morale. Mais il reconnaît aussi que les solutions diplomatiques sont complexes, que les gouvernements font des calculs que nous ne voyons pas, et que la bonne intention n’est pas toujours suffisante. Ce que je sais, c’est que le silence ne résout rien. Et que l’indifférence a un coût.
Sources
Sources primaires
US reportedly presses allies to block Ukraine from full participation at NATO summit — The Kyiv Independent, 19 février 2025. Article basé sur quatre sources diplomatiques de l’OTAN confirmant la pression américaine pour limiter la participation de l’Ukraine au sommet d’Ankara.
US presses NATO for major reset, ending mission in Iraq — Politico Europe, février 2025. Analyse détaillée de la stratégie américaine de redéfinition du rôle de l’OTAN sous l’administration Trump.
Sources secondaires
US reportedly presses allies to block Ukraine from full participation at NATO summit — Yahoo News, reprise de l’article du Kyiv Independent avec contexte additionnel sur les implications diplomatiques.
Summit Shows NATO’s Limited Relevance to Ukraine (Part Two) — Jamestown Foundation, analyse experte sur l’évolution des relations OTAN-Ukraine depuis 2022.
NATO enlargement: Ukraine — House of Commons Library, document de recherche parlementaire britannique sur l’historique des discussions concernant l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’OTAN.
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.