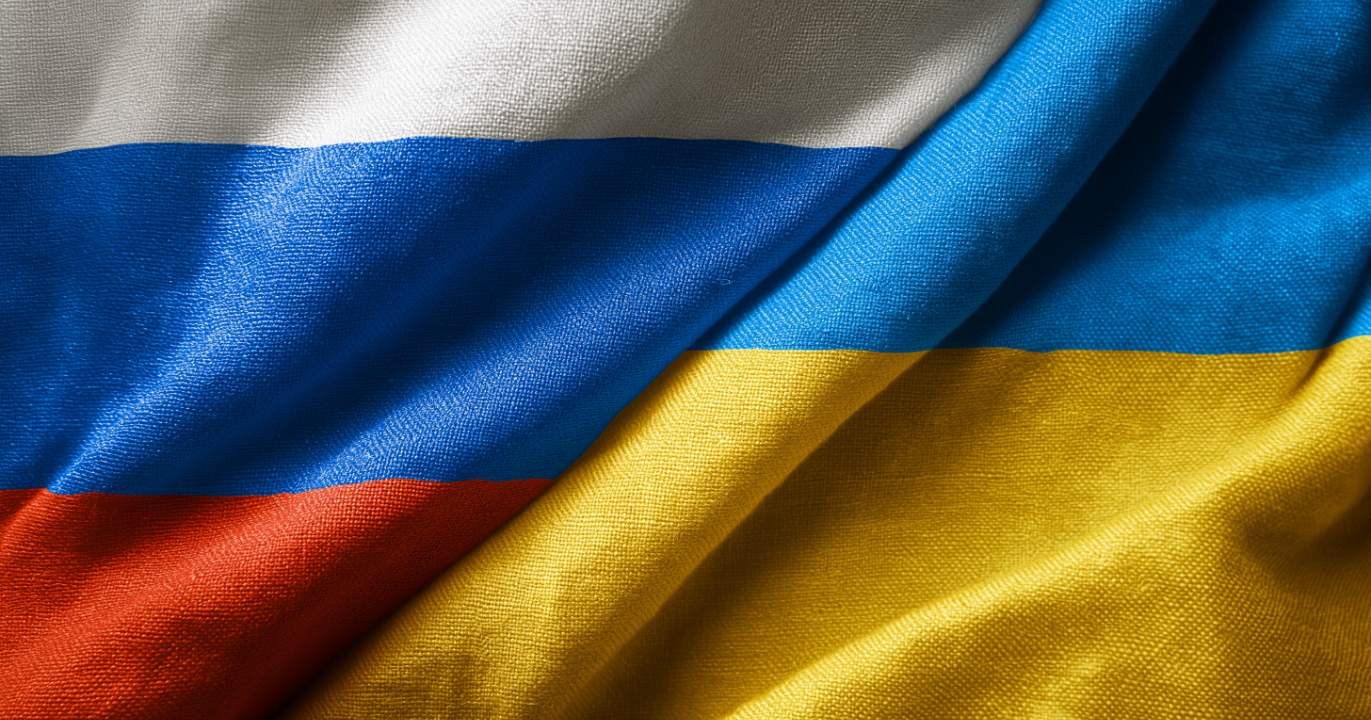
La cadence qui ne ralentit pas
Hier, 970 pertes russes. Avant-hier, un chiffre comparable. Demain, un autre. Après-demain, encore un autre. Le communiqué tombe chaque matin avec la régularité d’un bulletin météo. Sauf qu’on ne parle pas de degrés Celsius. On parle de vies humaines.
970 par jour. Faites le calcul. C’est 40 par heure. Un peu plus d’un toutes les deux minutes. Pendant que vous lisez ce paragraphe, quelqu’un est tombé quelque part entre Pokrovsk et Bakhmout, entre Kherson et Zaporizhzhia. Quelqu’un dont la mère ne sait pas encore. Quelqu’un dont les enfants attendent un message qui ne viendra pas ce soir.
Le rythme ne faiblit pas. Il ne faiblit jamais. Quatre ans que la machine tourne à plein régime, et personne n’a trouvé le bouton d’arrêt — ou personne ne veut le chercher.
La banalité bureaucratique du carnage
Ce qui frappe dans ces communiqués quotidiens de l’État-major ukrainien, c’est leur froideur administrative. Un tableau. Des catégories. Des chiffres. Tanks : 11 684. Véhicules blindés : 24 060. Artillerie : 37 387. Drones : 138 881. Navires : 29. Sous-marins : deux. Tout est compté, classé, archivé. Comme un inventaire de quincaillerie.
Sauf que chaque blindé détruit contenait des hommes. Chaque véhicule en flammes était un cercueil mobile. Chaque pièce d’artillerie pulvérisée avait un équipage. Le tableau ne dit pas ça. Le tableau ne dit jamais ça. Il aligne des colonnes propres et des totaux nets, et il laisse au lecteur le soin de remplir les blancs — si le lecteur en a encore la force.
La bureaucratie des hostilités est peut-être leur dimension la plus obscène. Réduire l’enfer à un fichier Excel. Transformer le sang en données. Publier le tout chaque matin, à heure fixe, comme si c’était normal.
J’ai essayé de compter jusqu’à 970. À voix haute, dans mon bureau, un matin de février. Un, deux, trois, quatre. J’ai tenu jusqu’à 214 avant que ma voix ne se brise — pas d’émotion, de fatigue. De la pure fatigue mécanique de prononcer des nombres. Et je me suis dit : si je n’arrive même pas à compter jusqu’à 970, comment est-ce que je peux prétendre comprendre ce que 970 morts par jour signifie ? La réponse est simple. Je ne peux pas. Personne ne peut.
L'inventaire de la destruction — quand les chiffres deviennent vertigineux

Une armée entière réduite en cendres
11 684 tanks. Ce chiffre, à lui seul, dépasse l’entendement. Pour donner une idée de l’échelle : l’armée française possède environ 200 chars Leclerc. L’armée britannique, environ 230 Challenger. L’Allemagne, quelque 300 Leopard en service actif. Additionnez les trois. Vous obtenez un peu plus de 700. La Russie en a perdu seize fois plus en Ukraine.
24 060 véhicules blindés de combat. 79 112 véhicules et citernes de carburant. 37 387 systèmes d’artillerie. 1 649 lance-roquettes multiples. 1 303 systèmes de défense antiaérienne. 435 avions. 347 hélicoptères. 138 881 drones. 29 navires et bateaux. Deux sous-marins.
Chaque nombre est un gouffre. Chaque catégorie, un abîme. L’accumulation est suffocante — volontairement. Parce que c’est exactement ce que cette confrontation produit : elle suffoque. Elle empile. Elle entasse la destruction jusqu’à ce que le regard se détourne, incapable de soutenir le spectacle.
L’échelle industrielle de la mort
138 881 drones. Ce nombre mérite qu’on s’y arrête. Cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-un engins volants détruits. Cela signifie que des dizaines de milliers d’autres sont encore en l’air, en ce moment même, quelque part au-dessus des tranchées ukrainiennes. La bataille des drones n’est pas un concept futuriste. C’est la réalité de chaque seconde sur ce front.
Et derrière chaque drone abattu, derrière chaque char en flammes, derrière chaque canon réduit au silence, il y a une question que personne ne pose assez fort : qui fabrique tout ça ? Qui finance cette production industrielle de mort ? Quelles usines tournent jour et nuit pour remplacer ce qui est détruit ? Quelles économies alimentent cet engrenage ?
La réponse est connue. Elle est documentée. Elle implique des chaînes d’approvisionnement qui traversent des continents, des composants électroniques qui passent par des dizaines de mains avant de finir dans un drone qui tuera un soldat de 22 ans dans une tranchée de boue. Mais la réponse est trop complexe, trop diffuse, trop systémique pour tenir dans un titre de journal. Alors on ne la pose pas. On compte les drones. On passe au chiffre suivant.
Il y a quelque chose d’obscène à compter des tanks comme on compte des points dans un match. « 11 684 à zéro. » Sauf que ce n’est pas un match. Chaque blindé, c’est un équipage de trois ou quatre hommes. Faites le calcul. Non, ne le faites pas. Pas maintenant. Gardez ce calcul pour un moment où vous serez seul, dans le silence de votre cuisine, à trois heures du matin, quand le monde dort et que la vérité se faufile entre les certitudes. Là, peut-être, le chiffre vous atteindra.
Le silence ukrainien — ce que l'absence de chiffres raconte

Un secret qui hurle plus fort que les bombes
L’État-major ukrainien publie chaque jour, avec une précision méticuleuse, les pertes infligées à l’ennemi. Chaque char. Chaque drone. Chaque bateau. Chaque sous-marin. Tout est compté, tout est affiché, tout est revendiqué. La transparence est totale — du côté russe.
Du côté ukrainien ?
Le silence.
L’Ukraine ne publie pas ses propres pertes. Raison officielle : le secret opérationnel. C’est une raison valide. En temps de conflit armé, révéler l’étendue de ses pertes, c’est donner à l’adversaire une information stratégique précieuse. C’est lui permettre de calibrer son effort, d’ajuster sa pression, de mesurer l’usure d’en face.
Mais ce silence dit aussi autre chose. Il dit que le chiffre est peut-être trop lourd pour être prononcé devant une nation déjà épuisée. Il dit que dans un pays où chaque famille connaît quelqu’un qui est parti au front, la vérité statistique pourrait être plus dévastatrice que n’importe quelle frappe de missile.
Le contraste qui dérange
Regardez l’asymétrie. D’un côté, la transparence chirurgicale sur les pertes adverses : 1 257 880, ventilées par catégorie, mises à jour quotidiennement, affichées avec la fierté sombre de celui qui se défend. De l’autre, le vide absolu sur ses propres sacrifices.
Ce décalage n’est pas anodin. Il raconte le déséquilibre fondamental de cette confrontation. L’Ukraine compte les pertes de l’envahisseur parce que chaque perte russe est une preuve que la défense fonctionne, que le prix de l’agression est astronomique, que l’invasion n’est pas gratuite. Mais elle ne compte pas — publiquement — ses propres morts, parce que chaque mort ukrainien est un rappel que la résistance a un coût. Un coût que personne ne veut quantifier à voix haute.
Le silence est parfois plus éloquent que les mots. Celui-là est assourdissant.
Je pense souvent à ce que signifie « secret opérationnel » pour une mère de Dnipro dont le fils est au front depuis dix-huit mois. Le secret opérationnel, c’est une phrase de communiqué. Pour elle, c’est l’absence de nouvelles. C’est le téléphone qu’elle regarde cent fois par jour. C’est la porte d’entrée qu’elle surveille du coin de l’œil en préparant le dîner — un dîner pour deux qu’elle mange seule depuis des mois. Le secret opérationnel protège la nation. Mais qui protège les mères ?
55 000 tués — quand Zelensky lève un coin du voile
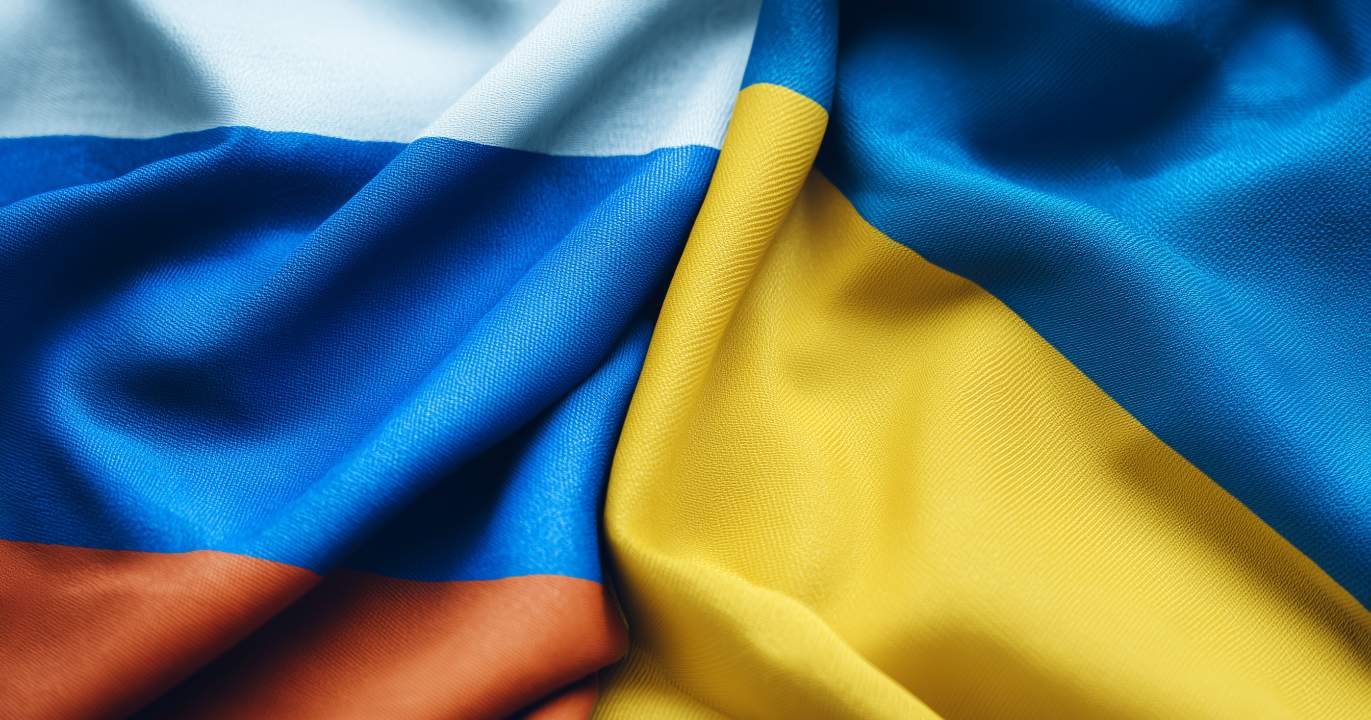
Un aveu qui pèse comme un cercueil
Le 4 février 2026, le président Volodymyr Zelensky a brisé le silence. Partiellement. Devant les caméras de France Télévisions, il a lâché un nombre : au moins 55 000 soldats ukrainiens tués au combat depuis le début de l’invasion à grande échelle. Plus de nombreux autres classés comme disparus.
55 000 tués. C’est plus que la population de certaines villes ukrainiennes qui existaient avant les hostilités et qui n’existent plus aujourd’hui. C’est l’équivalent d’un stade de football rempli à capacité — et vidé. Définitivement.
Mais 55 000, c’est le chiffre que Zelensky a choisi de donner. Le chiffre qu’il pouvait se permettre de révéler sans que le sol ne se dérobe sous les pieds de la nation. Le chiffre réel — celui qui inclut les blessés graves, les amputés, les traumatisés crâniens, les disparus dont on ne retrouvera jamais la trace — est infiniment plus élevé.
Les disparus — le gouffre dans le gouffre
« En plus de nombreux autres classés comme disparus. »
Cette phrase, dans la bouche de Zelensky, est passée presque inaperçue. Elle ne devrait pas. Parce que « disparu », dans le contexte de cet affrontement, ne signifie pas « temporairement introuvable ». Ça signifie : on ne sait pas. On ne sait pas s’il est mort. On ne sait pas s’il est prisonnier. On ne sait pas s’il est blessé quelque part, incapable de communiquer. On ne sait rien.
Pour les familles, « disparu » est le pire des statuts. Pire que « tué au combat », aussi insoutenable que cela puisse paraître. Parce que « tué » permet le deuil. « Tué » permet de pleurer, d’enterrer, de commencer — un jour, peut-être — à reconstruire. « Disparu » ne permet rien. Le cœur se fige. L’attente qui ne mène nulle part. L’espoir qui refuse de mourir et qui, précisément pour cette raison, empêche de vivre.
Combien sont-ils, ces disparus ? Zelensky n’a pas donné de chiffre.
Le silence, encore. Le silence toujours.
55 000. J’ai écrit ce nombre et je l’ai regardé longtemps. Puis j’ai pensé à autre chose — quelque chose de banal, d’humain, de presque honteux. J’ai pensé au fait que 55 000, c’est à peu près le nombre de personnes qui remplissent le Stade olympique de Montréal un soir de spectacle. Et je me suis imaginé ce stade, plein à craquer, avec 55 000 visages, 55 000 voix, 55 000 vies — et puis le noir. Le silence total. Plus personne. Juste les sièges vides. Et le vent qui passe entre les rangées. C’est ça, 55 000. C’est un stade qu’on ne remplira plus jamais.
Les corps qu'on ne ramène pas — le deuil interdit

Quand un drone à 500 dollars vole la dignité des morts
Il y a une phrase dans le rapport du Kyiv Independent qui m’a arrêté net. Une phrase clinique, factuelle, presque anodine dans sa formulation : « The intensity of Russian drones and fighting has made it difficult for Ukraine to retrieve the bodies of fallen soldiers, which are needed for DNA confirmation. »
Relisez. Lentement.
L’intensité des drones russes et des combats rend difficile — pas impossible, difficile, ce qui est presque pire — la récupération des corps des soldats tombés. Ces dépouilles sont nécessaires pour la confirmation ADN. Sans corps, pas de confirmation. Sans confirmation, pas de statut officiel. Sans statut officiel, pas de certificat de décès. Sans certificat de décès, pas de deuil administratif. Pas de pension pour la veuve. Pas de reconnaissance pour les orphelins.
Un corps qui reste entre les lignes, c’est une vie qui n’a pas de fin. Une mort qui n’est pas officiellement une mort. Un fantôme administratif dans un pays qui croule déjà sous le poids de ses défunts réels.
Le geste le plus ancien de l’humanité, rendu impossible
Enterrer ses morts. C’est le geste fondateur de la civilisation. Les archéologues le disent : le moment où l’être humain a commencé à ensevelir ses semblables est le moment où il est devenu humain. Avant les temples, avant l’écriture, avant les villes — il y a eu les tombes. Le refus de laisser les siens pourrir à ciel ouvert. La dignité accordée aux défunts.
En 2026, sur le front ukrainien, ce geste est devenu un luxe. Un drone à 500 dollars — un bout de plastique avec un moteur et une caméra — empêche des familles d’inhumer leurs fils. La technologie la plus primitive de la guerre moderne interdit le rituel le plus ancien de l’humanité. Il y a dans cette collision entre le primitif et le technologique quelque chose qui provoque d’abord une stupeur nauséeuse. Le sentiment que quelque chose de fondamental s’est déréglé dans l’ordre des choses, et que personne ne sait comment le remettre en place.
Alors on ne le dit pas. On écrit « difficult to retrieve the bodies » et on passe à la ligne suivante du communiqué.
Je pense à une femme. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son visage. Mais je sais qu’elle existe, quelque part en Ukraine, dans un appartement dont les murs portent encore les photos de son fils en uniforme. Elle attend. Elle attend depuis des mois. Peut-être depuis un an. Son fils est « disparu ». Pas mort — disparu. Pas vivant — disparu. Juste… absent. Et chaque matin, elle se lève, elle prépare du café pour deux, et elle attend. Le téléphone ne sonne pas. La porte ne s’ouvre pas. Le café refroidit. Elle le verse dans l’évier. Et elle recommence le lendemain. Chaque jour. Depuis des mois. C’est ça, un corps qu’on ne récupère pas. C’est du café froid versé dans un évier, tous les matins, jusqu’à la fin du monde.
Le rapport CSIS — quand les chiffres des deux côtés s'additionnent

2,5 pour 1 — le ratio qui ne console personne
Le Center for Strategic and International Studies — le CSIS, basé à Washington — a publié en janvier 2026 un rapport intitulé « Russia’s Grinding War in Ukraine ». Un titre qui dit tout. Grinding. Le mot anglais pour « broyer ». Le conflit qui broie.
Les conclusions du CSIS sont glaçantes dans leur sobriété. L’Ukraine a probablement subi entre 500 000 et 600 000 pertes entre février 2022 et décembre 2025. Parmi celles-ci, entre 100 000 et 140 000 seraient des tués au combat. Le reste : blessés, mutilés, traumatisés, disparus.
Le CSIS estime le ratio de pertes entre la Russie et l’Ukraine à « roughly 2.5:1 or 2:1 ». Pour chaque Ukrainien qui tombe, entre deux et deux Russes et demi tombent aussi. Ce ratio est censé être une bonne nouvelle pour l’Ukraine. Sur le papier stratégique, c’est le signe d’une défense efficace. Dans la réalité des tranchées, c’est une arithmétique de l’horreur qui ne réconforte personne.
Le total que personne ne veut écrire
Faisons l’addition. Vous et moi, maintenant. L’addition que les communiqués évitent. L’addition que les analystes murmurent dans les couloirs des conférences mais qu’ils n’écrivent pas en gros caractères.
Pertes russes (estimation ukrainienne) : 1 257 880. Pertes ukrainiennes (estimation CSIS) : 500 000 à 600 000. Total combiné : entre 1,76 et 1,86 million de pertes humaines.
Près de deux millions.
Deux millions de vies brisées, interrompues, détruites. Deux millions de familles en deuil ou dans l’attente. Deux millions de places vides à des tables de cuisine, de chaises inoccupées lors des fêtes de fin d’année, de prénoms qu’on prononce au passé.
Pour combien de kilomètres carrés ? Pour quels objectifs stratégiques ? Pour quelle vision du monde qui vaudrait le prix de deux millions de vies ?
La question reste sans réponse. Elle restera sans réponse. Parce qu’il n’existe pas de réponse qui puisse justifier ce total.
Près de deux millions. J’ai écrit ce chiffre et j’ai dû me lever de ma chaise. Marcher. Ouvrir une fenêtre. Respirer l’air de février. Parce que deux millions, ce n’est plus un chiffre. C’est un pays. C’est une ville. C’est la population entière de certaines nations européennes. Et tout ça pour quoi ? Pour des lignes sur une carte que personne ne regarde ? Pour des « sphères d’influence » dont les habitants n’ont jamais voulu faire partie ? Pour l’ego d’un homme dans un bureau du Kremlin qui ne mettra jamais les pieds dans une tranchée ? Près de deux millions. Et le compteur tourne encore.
La machine — 970 par jour, l'engrenage qui ne s'arrête pas

L’attrition : un mot du siècle dernier pour un carnage bien actuel
Il y a un mot pour ce qui se passe en Ukraine. Un mot ancien, un mot du siècle dernier, un mot qu’on croyait relégué aux manuels d’histoire. Attrition. La guerre d’attrition. Celle qui ne cherche pas la percée décisive, la manœuvre brillante, la victoire éclair. Celle qui use. Qui broie. Qui épuise. Qui transforme des êtres humains en consommables.
970 pertes par jour, c’est le rythme de fonctionnement de cette machine. Pas un accident. Pas une anomalie. Le rythme normal. Le régime de croisière. La machine a trouvé sa cadence et elle s’y tient, jour après jour, mois après mois, année après année. Elle ingère des hommes d’un côté et produit des statistiques de l’autre. L’input est humain. L’output est comptable.
Et quelque part à Moscou, dans des bureaux climatisés, des hommes en costume calculent si le rythme est soutenable. Si les réserves démographiques sont suffisantes pour maintenir la cadence. Si la mobilisation peut fournir assez de corps pour alimenter la machine jusqu’à ce que l’autre côté craque en premier.
Le XXIe siècle qui ressemble au XIXe
On nous avait promis autre chose. On nous avait dit que le XXIe siècle serait celui de la frappe chirurgicale. Des tirs précis. Des drones intelligents. Des conflits courts, technologiques, presque propres. La campagne du Golfe de 1991 devait être le modèle : quelques semaines, une supériorité technologique écrasante, et c’est fini.
Ce qui se passe en Ukraine ressemble davantage à Verdun qu’à la tempête du désert. Des tranchées. De la boue. De l’artillerie qui pilonne sans relâche. Des hommes qui meurent pour gagner — ou perdre — quelques centaines de mètres de terrain dévasté. La technologie est là, bien sûr — les drones, les satellites, les missiles guidés. Mais elle n’a pas remplacé la chair. Elle l’a complétée. La mort est devenue hybride : moitié XXIe siècle, moitié Première Guerre mondiale.
En 2022, le monde s’est indigné. En 2023, il s’est inquiété. En 2024, il s’est habitué. En 2025, il a commencé à regarder ailleurs. En 2026—
En 2026, je ne sais plus quel mot utiliser. « Tragédie » est usé jusqu’à la corde. « Catastrophe » sonne comme un titre de journal télévisé. « Horreur » est devenu un cliché. La langue elle-même s’épuise face à cet affrontement. Les mots s’usent comme les soldats — ils perdent leur tranchant à force d’être mobilisés. Et quand les mots ne coupent plus, quand ils glissent sur la conscience sans laisser de marque, c’est que la normalisation a gagné. C’est que la machine a réussi son pari : nous rendre sourds à notre propre vocabulaire de l’indignation.
Le coût humain invisible — au-delà du compteur

Le mot « pertes » : un chef-d’œuvre de camouflage linguistique
Le mot « pertes » est un chef-d’œuvre de langage militaire. Vague à dessein. Il englobe tout : les morts, les blessés, les disparus, les capturés, les inaptes au combat. Il permet de gonfler les chiffres sans mentir — et de les minimiser sans mentir non plus. Un mot élastique, conçu pour absorber toutes les réalités sans en nommer aucune.
Derrière « 1 257 880 pertes », il y a des tués — peut-être 300 000, peut-être 400 000, peut-être davantage. Personne ne sait exactement. Mais il y a aussi des blessés. Des hommes qui ont perdu une jambe, deux jambes, un bras, la vue, l’ouïe. Des hommes dont le crâne a été ouvert par un éclat d’obus et qui ne seront plus jamais les mêmes. Des hommes qui marchent, qui parlent, qui respirent — mais qui ne vivent plus vraiment.
Et il y a les traumatisés. Ceux dont le corps est intact mais dont l’esprit est en morceaux. Le syndrome de stress post-traumatique — le PTSD — est l’épidémie silencieuse de cette confrontation. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne produit pas de chiffres spectaculaires. Elle se manifeste dans les cauchemars, les crises de panique, les violences domestiques, les suicides. Elle se manifeste après. Quand les caméras sont parties. Quand le monde a tourné la page.
La multiplication que personne ne fait
Chaque « perte » a une mère. Un père, peut-être. Une épouse ou une compagne. Des enfants, souvent. Des frères, des sœurs, des amis, des collègues. Multipliez 1 257 880 par trois. Par quatre. Par cinq. Vous obtenez le nombre réel de personnes affectées. Pas des « pertes ». Des êtres humains en deuil, en attente, rongés par une angoisse qui ne trouve pas de fond.
Cinq millions de personnes. Peut-être six millions. Rien que du côté russe. Ajoutez le côté ukrainien. Vous dépassez les dix millions. Dix millions de vies fracturées par ces hostilités. Dix millions de personnes pour qui le 24 février 2022 a été le dernier jour normal.
Le compteur ne mesure pas ça. Il ne recense que les soldats. Pas les mères qui ne dorment plus. Pas les enfants qui dessinent des tanks à l’école. Pas les villages vidés de leurs hommes, les usines sans ouvriers, les champs sans paysans. Le compteur est aveugle à tout ce qui n’est pas militaire. Et pourtant, c’est tout le reste — le civil, l’humain, le quotidien — qui paie le prix le plus lourd.
Je voudrais vous parler d’un homme. Je ne connais pas son nom non plus. Mais je sais qu’il existe — pas en Ukraine, en Russie. Il a 24 ans. Il était serveur dans un restaurant de Krasnodar avant d’être mobilisé à l’automne 2022. Il a perdu sa jambe droite près de Vuhledar en mars 2023. Il est rentré chez lui avec une prothèse et un regard que sa mère ne reconnaît pas. Il ne travaille plus. Il ne sort plus. Il boit. Il fait partie des « pertes » — catégorie « blessé », sous-catégorie « inapte au combat ». Dans le communiqué ukrainien, il est un chiffre parmi 1 257 880. Dans sa cuisine de Krasnodar, il est un homme de 24 ans qui essaie de se souvenir de ce que ça fait d’avoir deux jambes.
La guerre des chiffres — peut-on faire confiance au compteur ?
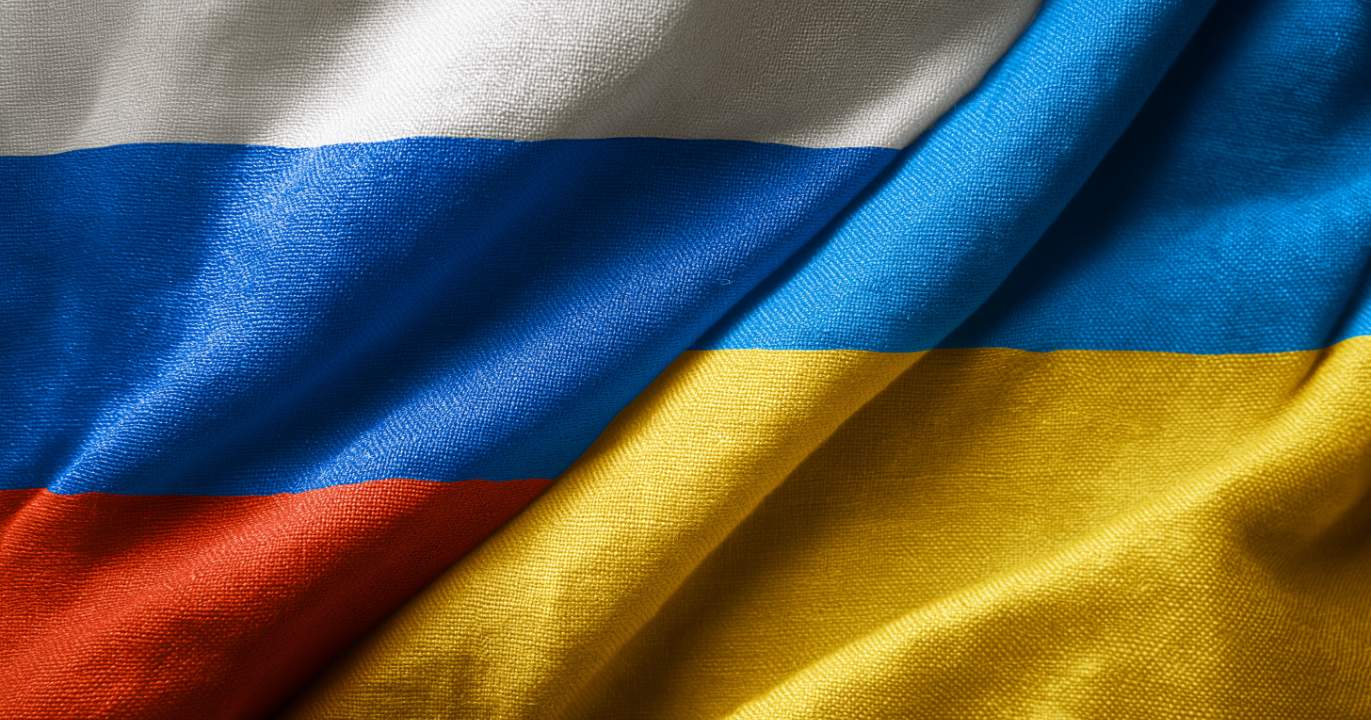
1 257 880 : chiffre exact ou arme de communication ?
Soyons honnêtes. Radicalement honnêtes. Ces chiffres — 1 257 880 pertes russes — proviennent de l’État-major ukrainien. L’Ukraine est une partie au conflit. Elle a un intérêt stratégique, politique et psychologique à maximiser les pertes de l’adversaire. C’est de bonne guerre — au sens littéral du terme.
Est-ce que les chiffres ukrainiens sont exacts ? Probablement pas, au sens d’une précision comptable. Les conditions du champ de bataille rendent le décompte exact impossible. Les doubles comptages existent. Les estimations remplacent parfois les confirmations. La marge d’erreur est réelle et potentiellement significative.
Mais voici la question qui compte : est-ce que cette marge d’erreur change quelque chose à l’ampleur du carnage ? Non. Divisez le chiffre par deux. Vous obtenez 630 000. Divisez-le par trois, si vous êtes très sceptique. Vous obtenez 420 000. Même au tiers du chiffre annoncé, les pertes russes restent catastrophiques. Même au tiers, c’est une saignée historique.
Le CSIS comme ancrage de crédibilité
C’est ici que le rapport du CSIS prend toute son importance. Le Center for Strategic and International Studies n’est pas une partie au conflit. C’est un think tank américain, indépendant, reconnu pour la rigueur de ses analyses. Quand le CSIS estime le ratio de pertes à « roughly 2.5:1 or 2:1 », il ne reprend pas les chiffres ukrainiens à l’aveugle. Il les croise avec des sources ouvertes, des images satellites, des interceptions de communications, des témoignages, des analyses démographiques.
Le CSIS confirme l’ordre de grandeur. Pas le chiffre exact — l’ordre de grandeur. Et l’ordre de grandeur, c’est : les pertes russes sont massives, probablement supérieures à un million, et le ratio est nettement défavorable à Moscou.
La différence entre 1,2 million et 900 000, est-ce qu’elle change quelque chose ? Pour les stratèges, peut-être. Pour les mères qui attendent un appel, non. Leur fils est mort ou disparu, que le total soit d’un million ou de huit cent mille. La précision statistique ne console personne.
On me reprochera peut-être de ne pas être assez « rigoureux » avec les chiffres. De ne pas avoir épluché chaque méthodologie, chaque source, chaque marge d’erreur. C’est vrai. Je ne suis pas statisticien. Je suis chroniqueur. Et ce que je sais, avec la certitude de celui qui regarde ce conflit depuis quatre ans, c’est que le débat sur la précision des chiffres est devenu un alibi commode pour ne pas regarder ce qu’ils disent. On ergote sur les décimales pendant que les corps s’empilent. On discute de méthodologie pendant que le compteur tourne. La précision est importante. Mais elle ne doit pas devenir un refuge contre l’émotion.
La saignée russe — le prix que Moscou ne montre pas
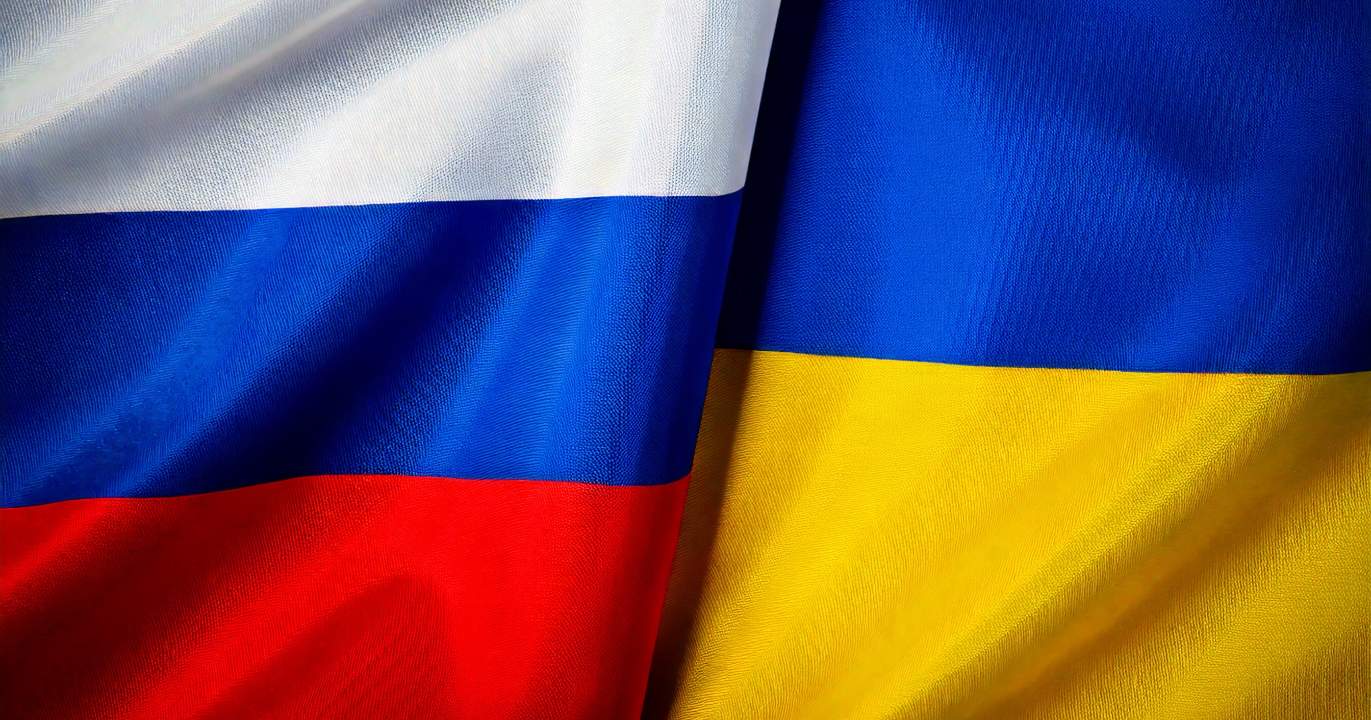
Des hommes, pas des « ennemis »
Il serait facile — et tentant — de traiter ces 1 257 880 pertes comme une victoire ukrainienne. De célébrer le ratio. De se réjouir que l’envahisseur paie cher. De transformer le communiqué quotidien en tableau de score où le « bon » côté mène largement.
Je refuse.
Parce que derrière chaque unité de ce compteur, il y a un être humain. Un Russe. Un homme — presque toujours un homme — qui avait une vie avant d’être envoyé mourir dans un pays qu’il n’avait peut-être jamais visité. Un conscrit de 19 ans qui ne comprenait pas pourquoi il était là. Un mobilisé de 35 ans arraché à son usine, à sa famille, à sa routine. Un contractuel de 45 ans qui avait signé pour l’argent parce que son village n’offrait rien d’autre.
Ces hommes ne sont pas « l’ennemi » dans un sens abstrait et déshumanisé. Ce sont des êtres humains broyés par un système qui les considère comme des consommables. L’indignation ne doit pas viser les soldats qui tombent. Elle doit viser ceux qui les envoient tomber.
La démographie comme sentence
La Russie souffrait déjà d’un déclin démographique avant cette guerre. Un taux de natalité en chute libre. Une espérance de vie masculine parmi les plus basses d’Europe. Un exode des cerveaux accéléré par les sanctions et la mobilisation. Et maintenant, 1 257 880 pertes — essentiellement des hommes en âge de travailler, de fonder une famille, de construire quelque chose.
Ce que cet affrontement fait à la pyramide des âges russe est un désastre silencieux. Des villages entiers vidés de leurs jeunes hommes. Des régions périphériques — le Daghestan, la Bouriatie, les républiques du Caucase — qui fournissent une part disproportionnée des victimes. Le conflit ne saigne pas la Russie uniformément. Il saigne les plus pauvres, les plus éloignés, les plus invisibles.
Pendant ce temps, un négociateur du Kremlin parle d’un « portefeuille de projets potentiels de 14 000 milliards de dollars » avec les États-Unis. Quatorze mille milliards. L’obscénité de ce montant, mis en regard du million de pertes, dépasse l’entendement. On négocie des contrats sur les cadavres de ses propres citoyens. On parle business pendant que les cercueils — quand il y a des cercueils — arrivent dans les gares de province.
Il y a un mot russe que j’ai appris en couvrant ce conflit : « груз 200 » — « grouz 200 ». C’est le code militaire pour les cercueils rapatriés du front. Cargo 200. Un code. Pas un nom. Pas un visage. Un code logistique. Comme si les défunts étaient des colis. Comme si la mort était une livraison. Et je me demande : dans les villages de Bouriatie, du Daghestan, de Tchouvachie, combien de « cargos 200 » sont arrivés depuis quatre ans ? Combien de mères ont ouvert leur porte pour trouver deux officiers en uniforme et un silence qui dit tout ? Combien de fois cette scène s’est-elle répétée, identique, mécanique, dans des cuisines qui se ressemblent toutes ? Le compteur ukrainien dit 1 257 880. Les cuisines russes disent autre chose. Elles disent : mon fils.
La normalisation — quand le monde s'habitue à l'inacceptable
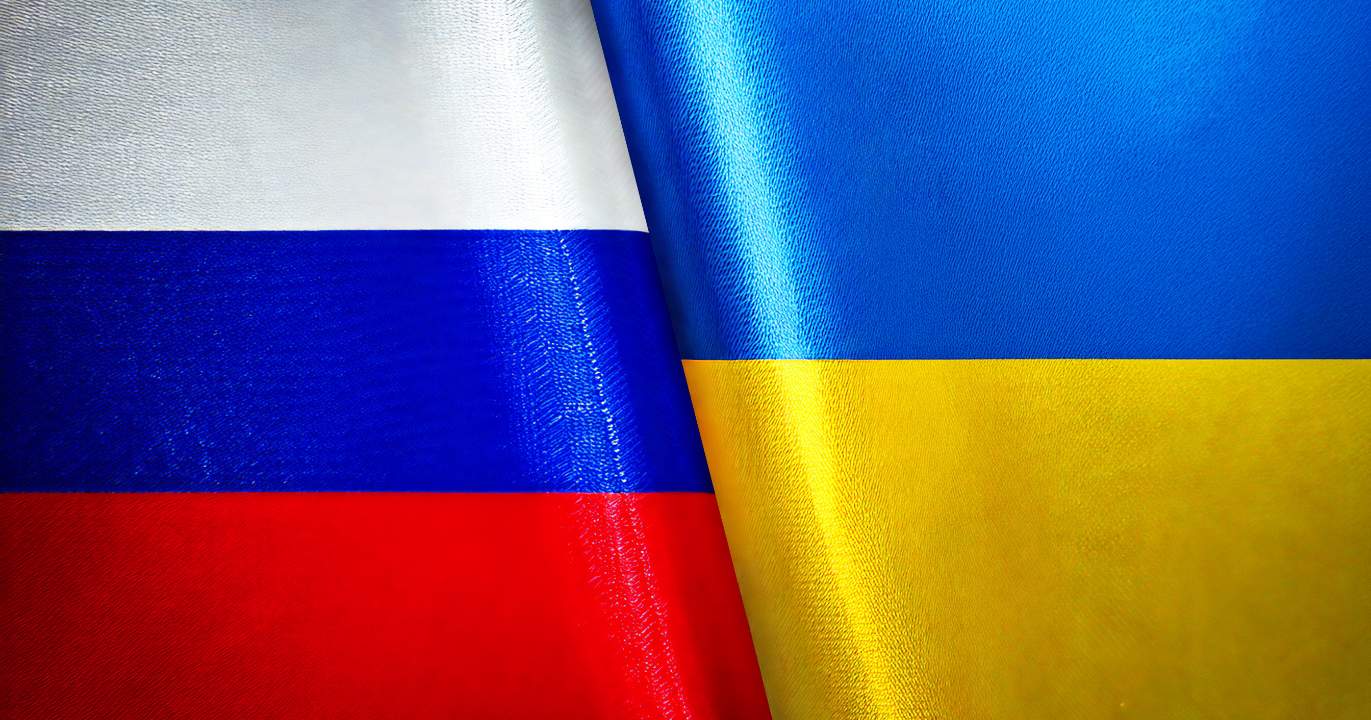
Votre pouce a déjà failli scroller — et c’est exactement le problème
Vous avez lu le titre de cet article. Vous avez peut-être haussé les sourcils. Peut-être pas. Peut-être que 1 257 880 n’a provoqué qu’un léger froncement — un micro-mouvement facial, à peine perceptible, immédiatement suivi par le réflexe du pouce qui descend vers l’article suivant.
C’est normal. C’est humain. C’est aussi exactement le problème.
Les psychologues appellent ça le « psychic numbing » — l’engourdissement psychique. Le cerveau humain n’est pas câblé pour ressentir de l’empathie à l’échelle du million. Il peut pleurer pour un enfant. S’émouvoir pour dix victimes. Mais au-delà d’un certain seuil — quelque part entre cent et mille — le circuit empathique disjoncte. Les chiffres deviennent abstraits. Les morts deviennent des statistiques. Et les statistiques ne font pas pleurer.
Joseph Staline le savait. On lui attribue — peut-être à tort — cette phrase : « La mort d’un homme est une tragédie. La mort d’un million est une statistique. » Qu’il l’ait dite ou non, la phrase est d’une justesse terrifiante. Elle décrit exactement ce qui se passe avec le compteur ukrainien.
Le décalage qui accuse
La mort d’un enfant tombé dans un puits fait la une des journaux pendant des jours. Des équipes de secours sont mobilisées. Le monde entier retient son souffle. Les chaînes d’information continue couvrent l’événement minute par minute. Et quand l’enfant est sauvé — ou quand il ne l’est pas — l’émotion est universelle, viscérale, immédiate.
970 soldats périssent chaque jour, et c’est un entrefilet. Un paragraphe dans un fil d’actualité. Un chiffre parmi d’autres, coincé entre la météo et les résultats sportifs. Pas de visage. Pas de prénom. Pas de caméra braquée sur le drame. Juste un nombre. Un nombre qui augmente. Un nombre qu’on a cessé de regarder.
Ce n’est pas de l’indifférence. C’est de l’impuissance déguisée en indifférence. Nous ne sommes pas insensibles — nous sommes submergés. La différence est cruciale, mais le résultat est le même : le compteur tourne, et nous regardons ailleurs.
Je ne vous juge pas. Comment pourrais-je ? Je fais la même chose. Je lis le communiqué du matin, je note le chiffre, je commence à écrire — et entre deux paragraphes, je vérifie mes courriels, je regarde la météo, je pense au souper. La vie continue. C’est sa force et sa cruauté. La vie continue pendant que 970 personnes cessent de vivre. Et cette coexistence — ma vie qui continue, leur fin qui survient — est peut-être la chose la plus difficile à accepter dans ce conflit. Pas les chiffres. Pas les images. La coexistence. Le fait que tout ça se passe en même temps que mon café du matin.
Quatre ans — la chronologie de l'usure
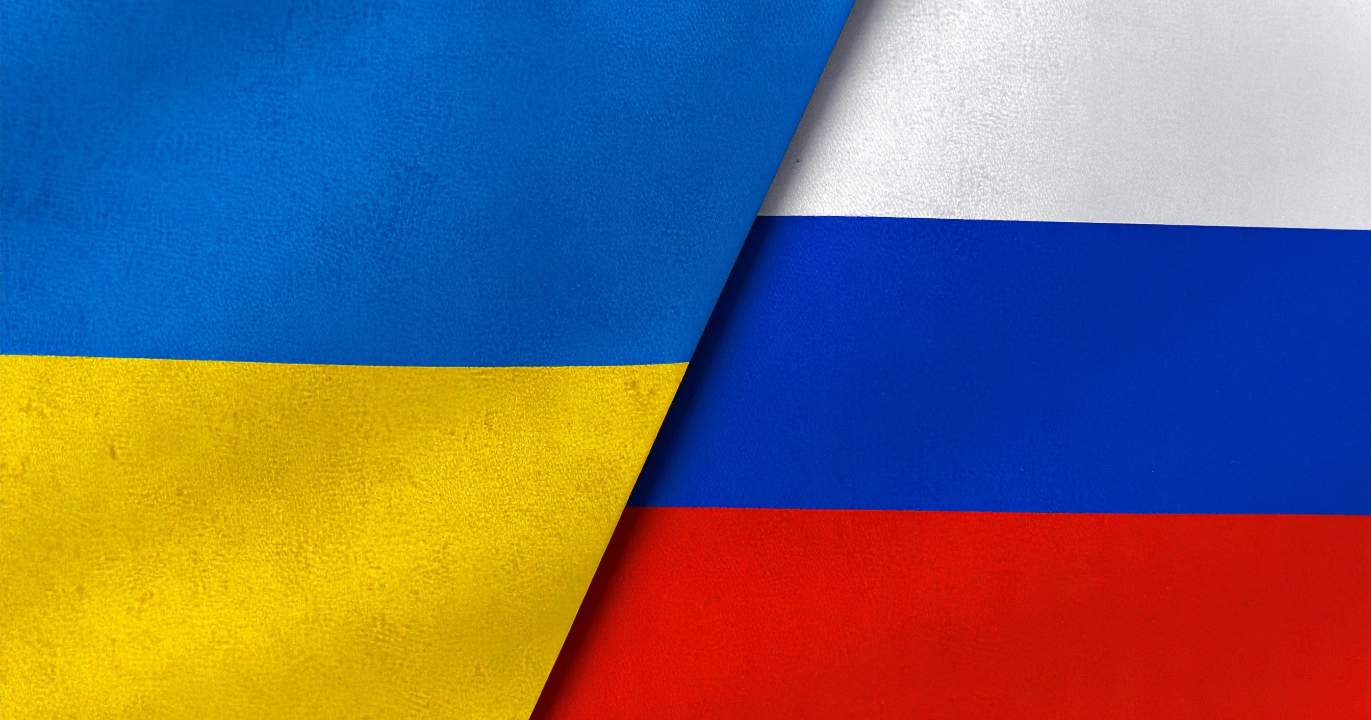
24 février 2022 : le jour où « impossible » est mort
24 février 2022. Le monde se réveille avec des images de colonnes de chars sur les routes ukrainiennes. L’incrédulité est totale. « En Europe, en 2022, c’est impossible. » Les réseaux sociaux s’enflamment. Les drapeaux ukrainiens apparaissent sur les profils. Les sanctions tombent. L’Occident est uni, résolu, indigné.
On pensait que ça durerait trois jours. Peut-être une semaine. Le temps que Kyiv tombe. Le temps que Zelensky fuie. Le temps que la « opération militaire spéciale » accomplisse ses objectifs et que le monde passe à autre chose.
Kyiv n’est pas tombée. Zelensky n’a pas fui. Et trois jours sont devenus trois semaines, puis trois mois, puis trois ans. Puis quatre.
Les jalons de l’épuisement
Chaque année de cette confrontation a eu sa tonalité émotionnelle. 2022 : le choc et l’admiration. L’héroïsme de Kyiv, la libération de Kherson, la contre-offensive de Kharkiv. Le monde applaudissait. 2023 : l’espoir et la déception. La contre-offensive d’été qui n’a pas percé. Bakhmout, cette ville dont le nom est devenu synonyme de boucherie. 2024 : l’usure. Les lignes qui bougent à peine. Les mêmes communiqués, les mêmes chiffres, la même routine macabre. La fatigue compassionnelle s’installe en Occident. 2025 : le détournement du regard. D’autres crises, d’autres urgences, d’autres titres. L’Ukraine glisse vers le bas du fil d’actualité.
Et 2026. Février 2026. 1 257 880. Le chiffre est là, massif, indéniable. Mais qui le regarde encore ? Qui s’arrête encore pour le lire ? Qui prend encore le temps de sentir ce qu’il signifie ?
La chronologie de cette guerre est aussi la chronologie de notre engourdissement. Et c’est peut-être l’aspect le plus tragique de tout : pas le conflit lui-même, mais la vitesse à laquelle nous avons appris à vivre avec.
Quatre ans. J’ai couvert des dizaines de conflits dans ma carrière d’analyste. J’ai vu des affrontements commencer dans l’indignation et finir dans l’oubli. Mais celui-ci est différent. Pas par son ampleur — d’autres ont été plus meurtriers. Pas par sa brutalité — d’autres ont été plus sauvages. Par sa durée dans notre champ de vision. Quatre ans que ces hostilités se déroulent sous nos yeux, documentées en temps réel, filmées par des drones, commentées par des millions de voix sur les réseaux sociaux. Nous n’avons jamais eu autant d’informations sur un conflit. Et nous n’avons peut-être jamais été aussi incapables d’en faire quelque chose.
Ce que les chiffres ne disent pas

Six millions de réfugiés, des villes rasées — et le compteur ne bronche pas
Le communiqué de l’État-major ukrainien recense les pertes militaires russes. C’est son rôle. C’est sa fonction. Mais en se concentrant sur les militaires, le compteur laisse dans l’ombre tout le reste. Et le reste est immense.
Pas les six millions de réfugiés ukrainiens dispersés à travers l’Europe. Pas les millions de déplacés internes. Pas les enfants déportés vers la Russie — un crime que la Cour pénale internationale a qualifié de suffisamment grave pour émettre un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine. Pas les villes rasées : Marioupol, Bakhmout, Avdiivka, Vuhledar. Pas les infrastructures énergétiques détruites systématiquement, hiver après hiver. Pas les champs minés qui rendront des régions entières inhabitables pendant des décennies.
Le compteur ne recense pas les écoles bombardées. Les hôpitaux frappés. Les théâtres où des centaines de civils s’étaient réfugiés — avec le mot « ENFANTS » écrit en lettres géantes sur le parking — et qui ont été bombardés quand même.
Le patrimoine, l’environnement, l’avenir
Le compteur ne recense pas le patrimoine culturel détruit. Les musées pillés. Les églises centenaires réduites en gravats. Les archives brûlées. L’histoire d’un peuple que l’envahisseur tente d’effacer — littéralement, physiquement, systématiquement.
Il ne mesure pas la catastrophe environnementale. Les sols contaminés par les munitions. Les rivières polluées. La destruction du barrage de Kakhovka en juin 2023, qui a provoqué une inondation catastrophique et un désastre écologique dont les conséquences se feront sentir pendant des générations.
Il ne quantifie pas les traumatismes transgénérationnels. Les enfants qui ont grandi sous les bombardements et qui porteront ces cicatrices invisibles toute leur vie. Les adolescents qui n’ont connu que les combats. Les bébés nés dans des abris anti-bombes. Une génération entière marquée au fer rouge par un conflit qu’elle n’a pas choisi.
Le compteur ne capture pas tout ça. Il ne saisit même pas l’essentiel.
Quand je regarde le communiqué quotidien — « 970 pertes, 11 684 tanks, 138 881 drones » — je pense toujours à ce qu’il ne dit pas. Il ne dit pas que quelque part dans un village de la région de Kherson, une petite fille de sept ans dessine sa maison. Sauf que sa maison n’existe plus. Elle dessine un souvenir. Elle dessine des murs qui ne sont plus là, une chambre qui a été soufflée par un missile, un jardin où il y a maintenant un cratère. Elle dessine avec des crayons de couleur donnés par une ONG, sur un papier fourni par un centre d’accueil. Et son dessin ne figurera jamais dans aucun compteur. Aucune statistique ne la prendra en compte. Mais elle existe. Elle est réelle. Et elle dessine sa maison disparue avec une obstination tranquille que le compteur ne mesure pas : la ténacité muette d’un enfant qui refuse que les murs ne repoussent pas.
La résilience et son prix — tenir debout dans l'enfer

2,5 pour 1 — la victoire qui a le goût des larmes
L’Ukraine tient. Quatre ans après le début de l’invasion, malgré un adversaire qui dispose de ressources humaines et matérielles incomparablement supérieures, malgré la fatigue, malgré les pertes, malgré l’usure — l’Ukraine tient. Le ratio 2,5:1 en est la preuve froide, statistique, indiscutable.
Mais ce ratio est un réconfort empoisonné. Parce que « tenir » ne signifie pas « gagner ». Tenir signifie : continuer à perdre des hommes, mais moins vite que l’ennemi. Tenir signifie : chaque jour est une victoire, et chaque jour est un deuil. Tenir signifie : on survit, mais à quel prix ?
Le prix, c’est 55 000 tués. C’est entre 500 000 et 600 000 pertes totales. C’est des milliers de dépouilles qu’on ne peut pas récupérer. C’est des familles entières suspendues dans le vide du « disparu ». C’est un pays qui se bat pour son existence avec une détermination qui force l’admiration — et qui laisse, au creux de la poitrine, un serrement dont on ne sait pas s’il est de la fierté ou du chagrin.
Des héros qui ne devraient pas avoir à l’être
Quelque part sur le front de Pokrovsk, un caporal ukrainien de 31 ans. Dans une tranchée depuis des mois. Il connaît le ratio. 2,5 pour 1. On le lui a dit. On le lui répète. C’est censé le motiver — lui rappeler que la défense est efficace, que chaque jour qui passe coûte plus cher à l’adversaire qu’à lui.
Ça ne le réconforte pas.
Parce que le camarade qui est tombé hier — celui avec qui il partageait ses cigarettes, celui qui lui montrait des photos de sa fille sur son téléphone — ce camarade n’est pas un ratio. C’est un homme. C’était un homme. Et le fait que deux Russes et demi soient tombés « en échange » ne ramènera pas cet homme. Ne consolera pas sa fille. Ne remplira pas la place vide dans la tranchée.
La résilience ukrainienne est réelle. Admirable. Historique. Mais elle ne devrait pas être nécessaire. Personne ne devrait avoir à être aussi résilient. Personne ne devrait avoir à transformer la survie quotidienne en acte héroïque. Le fait que ces hommes et ces femmes le fassent — depuis 1 093 jours — dit quelque chose sur la force de l’esprit humain. Et quelque chose de terrible sur le monde qui les a mis dans cette position.
Je n’ai pas de leçon à donner aux Ukrainiens sur la résilience. Ils n’en ont pas besoin. Ce que j’ai, c’est un malaise. Le malaise de celui qui admire de loin, depuis le confort d’un bureau chauffé, des gens qui survivent dans des conditions que je ne peux même pas imaginer. L’admiration est facile. Elle ne coûte rien. Elle ne change rien. Et c’est précisément pour cette raison qu’elle me met mal à l’aise. Parce que quelque part entre mon admiration et leur tranchée, il y a un gouffre que mes mots ne combleront jamais.
L'avenir — le compteur ne connaît pas de fin
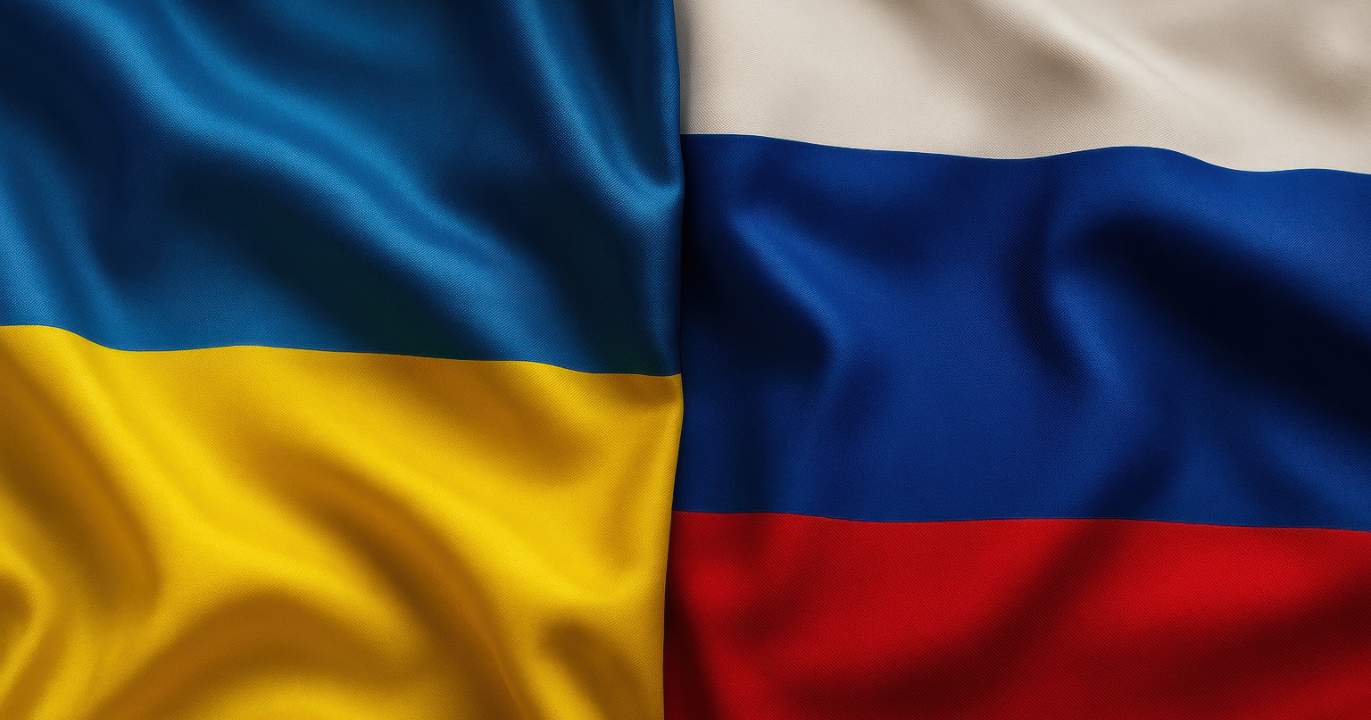
Deux millions avant Noël — la trajectoire que personne ne veut tracer
Au rythme actuel — 970 pertes par jour — le compteur des pertes russes atteindra 1,5 million avant l’été 2026. Il franchira la barre des deux millions avant la fin de l’année. Si rien ne change. Si la machine continue de tourner à la même cadence. Si personne n’appuie sur le bouton stop.
Deux millions. Le chiffre est abstrait aujourd’hui. Il sera concret dans quelques mois. Et quand il le sera, nous ferons exactement ce que nous faisons aujourd’hui : nous lirons le communiqué, nous noterons le nombre, et nous passerons à autre chose.
Parce que la trajectoire n’est pas seulement celle du compteur. C’est aussi celle de notre attention. Et les deux courbes vont dans des directions opposées : le compteur monte. Notre attention descend.
La question sans réponse
Quel est le chiffre qui fera s’arrêter la machine ? Deux millions ? Trois ? Cinq ? Existe-t-il seulement, ce seuil au-delà duquel l’horreur deviendra insoutenable — pas pour les soldats qui la vivent, mais pour les décideurs qui la permettent ?
Les négociations existent. Des émissaires se rencontrent. Des « portefeuilles de projets » sont évoqués. Des « boards of peace » sont créés. Mais pendant que les diplomates parlent, le compteur tourne. Chaque jour de négociation est un jour de 970 pertes supplémentaires. Chaque semaine de pourparlers, c’est près de 7 000 vies de plus dans la colonne des bilans.
La paix viendra. Un jour. Peut-être. Sous une forme ou une autre. Mais à quel chiffre ? À quel total le compteur s’arrêtera-t-il ? Personne ne le sait. Et cette incertitude — cette impossibilité de voir la fin — est peut-être la dimension la plus cruelle de ce conflit. Pas la mort. Pas la destruction. L’absence d’horizon.
Je n’ai pas de prédiction à offrir. Pas de scénario rassurant. Pas de « ça ira mieux demain ». Ce serait mentir. Ce que j’ai, c’est une conviction : tant que quelqu’un regarde, tant que quelqu’un écrit ces chiffres et que quelqu’un les lit, la normalisation n’a pas complètement gagné. L’attention est fragile. Elle est fatiguée. Elle est sollicitée de toutes parts. Mais elle est le dernier rempart contre l’indifférence totale. Vous êtes encore là, à lire ces lignes. C’est peu. C’est dérisoire face à 1 257 880. Mais c’est quelque chose. Et dans cette guerre où tout est compté, mesuré, quantifié — votre attention, elle, ne figure dans aucun compteur. Elle est pourtant la seule chose qui empêche ces chiffres de devenir du bruit.
Le poids de chaque zéro — conclusion

Revenir au chiffre
1 257 880.
Vous avez lu cet article. Vous avez traversé les chiffres, les analyses, les silences, les questions. Vous avez rencontré — peut-être — la mère qui verse du café froid dans l’évier. Le caporal qui ne trouve pas de réconfort dans un ratio. Le conscrit de Krasnodar qui essaie de se souvenir de ce que ça fait d’avoir deux jambes. La petite fille qui dessine une maison qui n’existe plus.
Et maintenant, relisez le chiffre. 1 257 880. Est-ce qu’il pèse différemment ? Est-ce qu’il a gagné un gramme de réalité, une once de chair, un soupçon d’humanité ? Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans votre tête en ce moment. Mais j’espère — avec la fragilité de celui qui sait que l’espoir est un luxe — que ce chiffre ne glissera pas tout à fait comme avant. Qu’il accrochera quelque chose. Qu’il laissera une trace.
Ce qui reste quand les mots s’arrêtent
Demain matin, le communiqué tombera. Un nouveau chiffre. Un peu plus haut. 1 258 850, peut-être. Ou 1 259 000. La machine ne prend pas de pause le week-end. Elle ne connaît pas les jours fériés. Elle ne respecte pas les cessez-le-feu qui n’existent pas.
Et nous — vous, moi, tous ceux qui lisent ces lignes — nous ferons ce que nous faisons chaque jour. Nous lirons. Nous noterons. Nous ressentirons peut-être quelque chose — un pincement, un malaise, une colère brève. Puis nous passerons à autre chose. Parce que la vie continue. Parce que le café refroidit. Parce que les enfants ont besoin qu’on les conduise à l’école. Parce que le monde ne s’arrête pas pour 1 257 880.
Mais peut-être — peut-être — qu’en passant à autre chose, nous emporterons quelque chose avec nous. Un poids. Un inconfort. Une question qui ne trouvera pas de réponse. Et peut-être que cet inconfort, aussi mince soit-il, est la seule chose honnête que nous puissions offrir à ces 1 257 880 vies dont nous ne connaîtrons jamais le nom.
Le compteur tourne. Il tournera demain. Il tournera après-demain. Et nous—
Signé Maxime Marquette
Encadré de transparence du chroniqueur
Positionnement éditorial
Je ne suis pas journaliste, mais chroniqueur et analyste. Mon expertise réside dans l’observation et l’analyse des dynamiques géopolitiques, économiques et stratégiques qui façonnent notre monde. Mon travail consiste à décortiquer les stratégies politiques, à comprendre les mouvements économiques globaux, à contextualiser les décisions des acteurs internationaux et à proposer des perspectives analytiques sur les transformations qui redéfinissent nos sociétés.
Je ne prétends pas à l’objectivité froide du journalisme traditionnel, qui se limite au rapport factuel. Je prétends à la lucidité analytique, à l’interprétation rigoureuse, à la compréhension approfondie des enjeux complexes qui nous concernent tous. Mon rôle est de donner du sens aux faits, de les situer dans leur contexte historique et stratégique, et d’offrir une lecture critique des événements.
Méthodologie et sources
Ce texte respecte la distinction fondamentale entre faits vérifiés et analyses interprétatives. Les informations factuelles présentées proviennent exclusivement de sources primaires et secondaires vérifiables.
Sources primaires : communiqués officiels des gouvernements et institutions internationales, déclarations publiques des dirigeants politiques, rapports d’organisations intergouvernementales, dépêches d’agences de presse internationales reconnues (Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, Bloomberg News, Xinhua News Agency).
Sources secondaires : publications spécialisées, médias d’information reconnus internationalement, analyses d’institutions de recherche établies, rapports d’organisations sectorielles (The Washington Post, The New York Times, Financial Times, The Economist, Foreign Affairs, Le Monde, The Guardian).
Les données statistiques, économiques et géopolitiques citées proviennent d’institutions officielles : Agence internationale de l’énergie (AIE), Organisation mondiale du commerce (OMC), Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale, instituts statistiques nationaux.
Nature de l’analyse
Les analyses, interprétations et perspectives présentées dans les sections analytiques de cet article constituent une synthèse critique et contextuelle basée sur les informations disponibles, les tendances observées et les commentaires d’experts cités dans les sources consultées.
Mon rôle est d’interpréter ces faits, de les contextualiser dans le cadre des dynamiques géopolitiques et économiques contemporaines, et de leur donner un sens cohérent dans le grand récit des transformations qui façonnent notre époque. Ces analyses reflètent une expertise développée à travers l’observation continue des affaires internationales et la compréhension des mécanismes stratégiques qui animent les acteurs globaux.
Toute évolution ultérieure de la situation pourrait naturellement modifier les perspectives présentées ici. Cet article sera mis à jour si de nouvelles informations officielles majeures sont publiées, garantissant ainsi la pertinence et l’actualité de l’analyse proposée.
Sources
Sources primaires
Kyiv Independent — General Staff: Russia has lost 1,257,880 troops in Ukraine since Feb. 24, 2022 — Rapport quotidien de l’État-major des forces armées ukrainiennes, 20 février 2026
United24 Media — Daily Update: Russia Loses 970 Troops, 6 Armored Vehicles in One Day — Mise à jour quotidienne des pertes russes, février 2026
Ground News — Russia Has Lost 1,257,880 Troops in Ukraine Since Feb. 24, 2022 — Agrégation multi-sources du rapport de l’État-major ukrainien
Sources secondaires
CSIS — Russia’s Grinding War in Ukraine — Center for Strategic and International Studies, rapport de janvier 2026 sur les pertes estimées des deux côtés et le ratio de pertes
Yahoo News — Russia has lost 1,257,880 troops in Ukraine since Feb. 24, 2022 — Reprise du rapport de l’État-major ukrainien par les médias internationaux
Kyiv Independent — Déclaration du président Zelensky à France TV, 4 février 2026, sur les 55 000 soldats ukrainiens tués au combat et les disparus