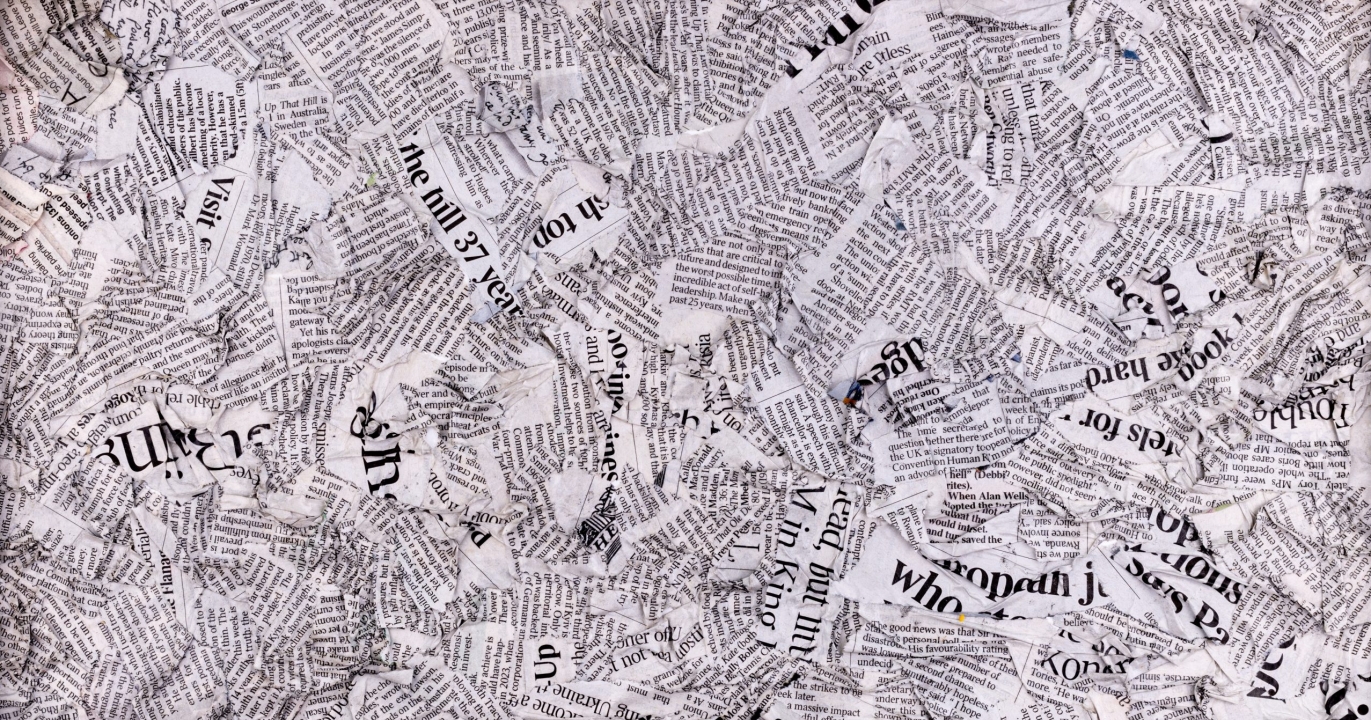
Combien de fois avons-nous entendu, lors d’un reportage ou d’une enquête journalistique, la fameuse phrase : « Le ministère ou la société gouvernementale n’a pas voulu répondre à nos questions » ? Que ce soit la SAAQ, un ministère provincial ou fédéral, ou encore une société d’État, le refus de répondre, ou pire, l’absence totale de retour d’appel, est devenu un refrain familier. Pourtant, dans une démocratie, nos gouvernements, élus par et pour la société, ne devraient-ils pas être tenus de rendre des comptes et de répondre à nos interrogations ? Peut-on tolérer ce mutisme institutionnel sans remettre en question la légitimité de ceux qui nous gouvernent ?
Le droit de savoir : un pilier de la démocratie
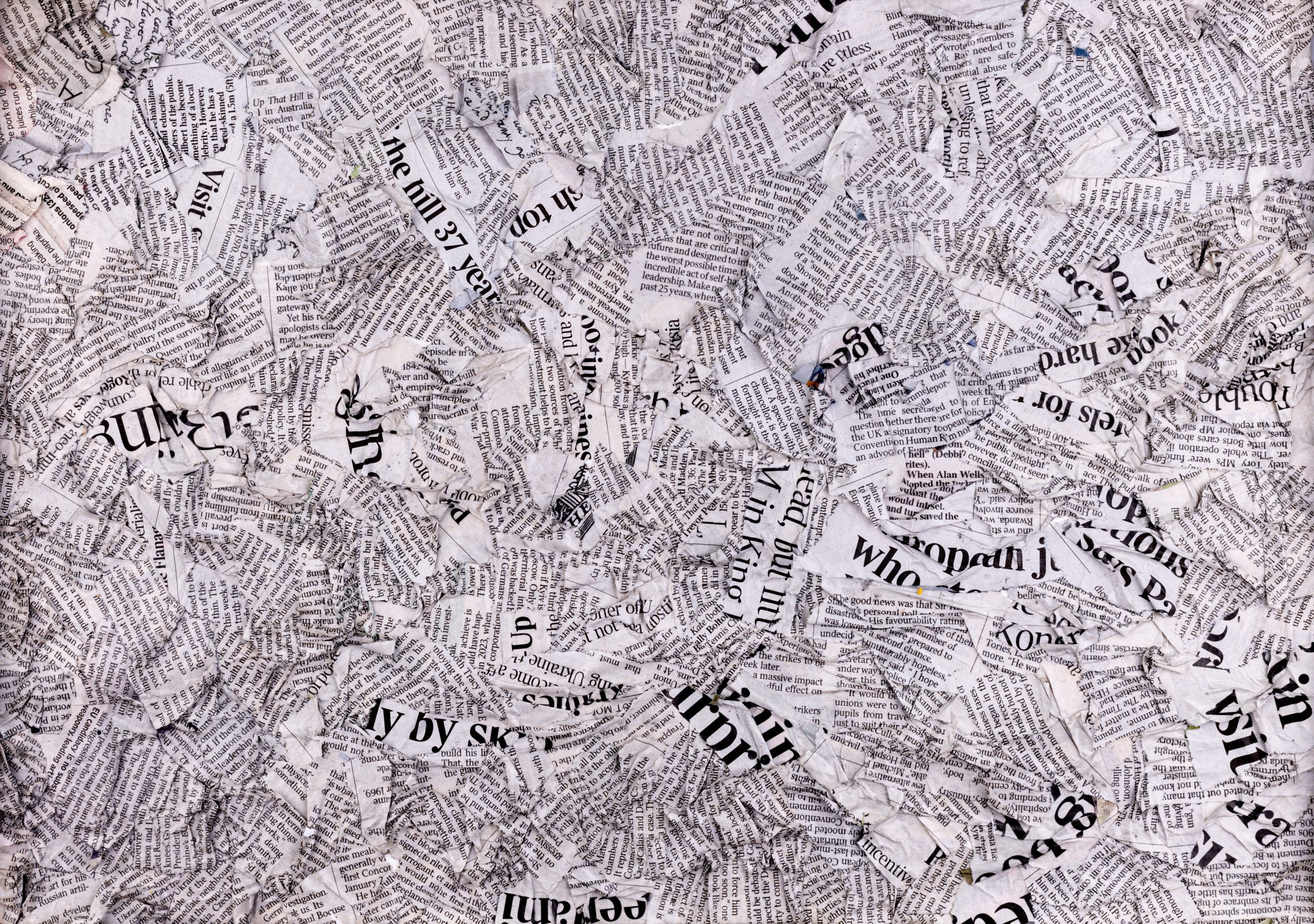
Transparence et responsabilité : des principes fondamentaux
La transparence et la responsabilité sont les pierres angulaires d’une société démocratique. Nos institutions publiques, financées par nos impôts, existent pour servir le public et non l’inverse. La Loi sur l’accès à l’information au Canada vise précisément à garantir ce droit fondamental de savoir : elle impose aux institutions de l’État une obligation de transparence, sauf dans des cas très précis et limités. L’objectif est clair : favoriser une société ouverte et démocratique et permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.
Des exceptions… mais jusqu’où ?
Évidemment, il existe des exceptions. Un ministre peut refuser de répondre à une question si cela va à l’encontre de l’intérêt public, si la question concerne une affaire devant les tribunaux, ou si répondre exigerait un travail disproportionné par rapport à l’utilité de la réponse. Mais ces exceptions sont censées être précises et limitées. Or, dans la réalité, elles servent trop souvent de prétexte à un refus systématique de communiquer avec le public. Le silence devient alors la norme, et non l’exception.
Quand la culture du silence s’installe
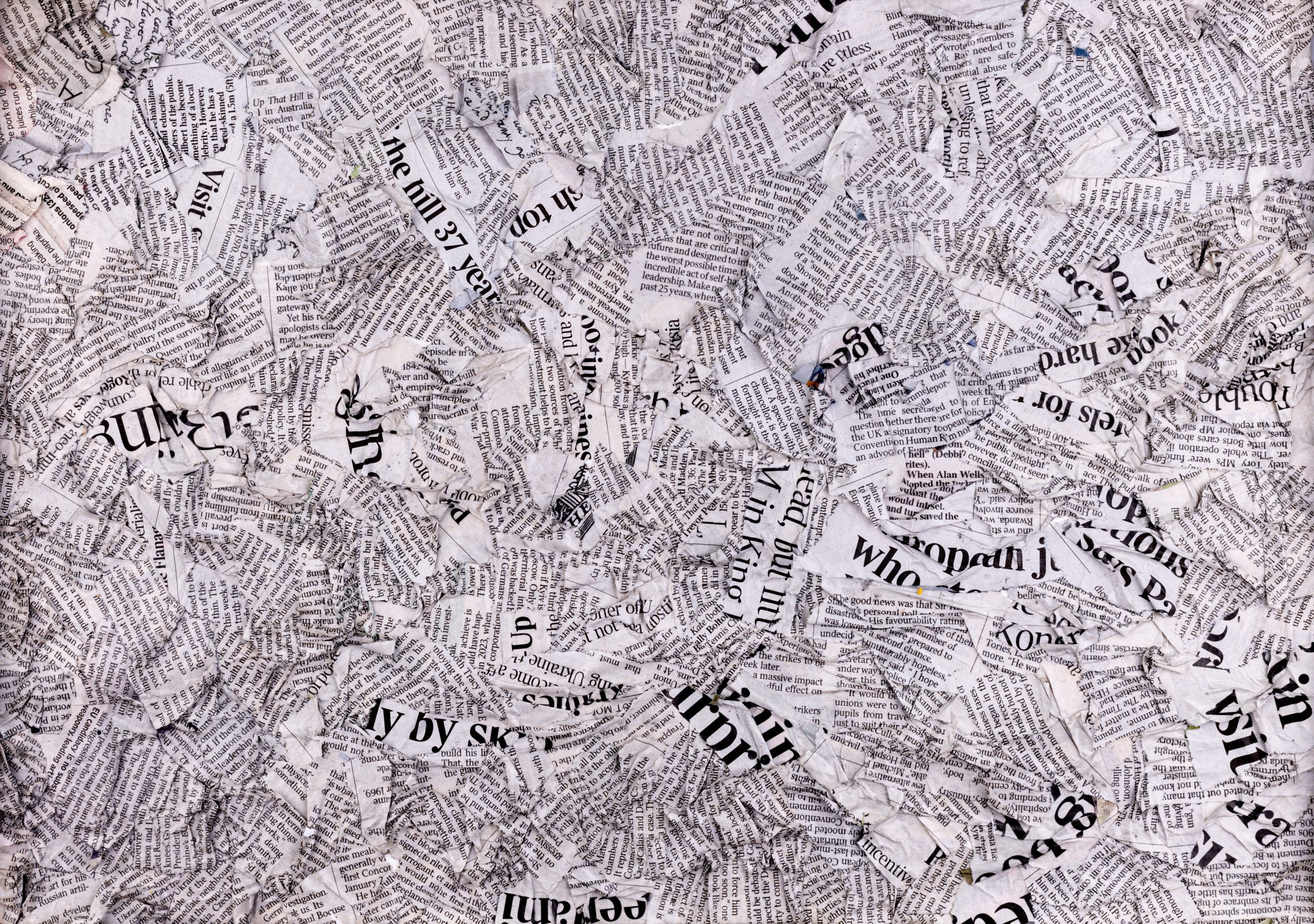
Des citoyens laissés dans le flou
Pour le citoyen ordinaire, ce silence institutionnel est frustrant, voire révoltant. Que ce soit pour comprendre une décision de la SAAQ, obtenir des explications sur la gestion d’un dossier ou simplement recevoir une information claire sur ses droits, la réponse se fait souvent attendre… ou ne vient jamais. Ce manque de communication alimente la méfiance et le cynisme envers nos institutions.
Les médias : témoins et victimes du mutisme gouvernemental
Les journalistes, qui jouent un rôle essentiel de chien de garde de la démocratie, se heurtent eux aussi à ce mur du silence. Combien d’enquêtes avortées, de dossiers incomplets, faute de réponse officielle ? Le refus de répondre devient une stratégie de gestion de crise, un moyen d’éviter les questions qui dérangent. Mais à quel prix ? Celui de la confiance du public, de la crédibilité des institutions, et, ultimement, de la santé démocratique de notre société.
Les obligations légales des gouvernements
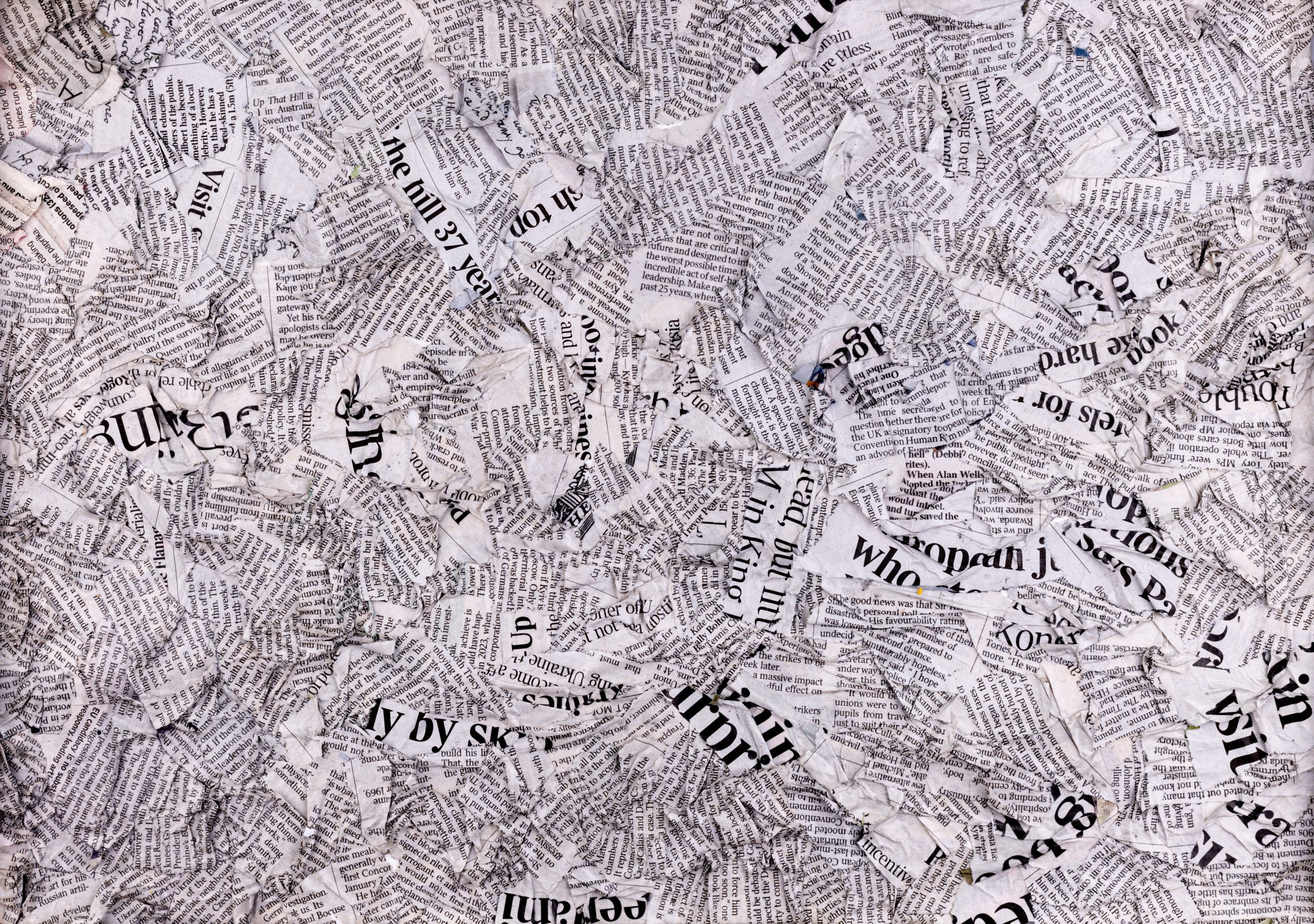
Des lois claires, des pratiques floues
Sur le plan légal, les choses sont pourtant limpides. Les ministres et les organismes publics ont l’obligation de rendre des comptes au Parlement et, par extension, à la population. La responsabilité ministérielle implique que chaque ministre doit être prêt à expliquer et justifier ses décisions, ses actions et celles de son ministère. Les lois sur l’accès à l’information imposent la publication proactive de certains renseignements et garantissent le droit du public à la communication des documents gouvernementaux.
Des déclarations de service… mais où est le service ?
De nombreux ministères publient des déclarations de service aux citoyens, promettant diligence, accessibilité et clarté dans la communication. Mais dans les faits, ces engagements restent souvent lettre morte. Les citoyens se retrouvent face à des labyrinthes administratifs, des réponses automatisées ou, pire, à un silence radio.
Pourquoi ce refus de répondre ?
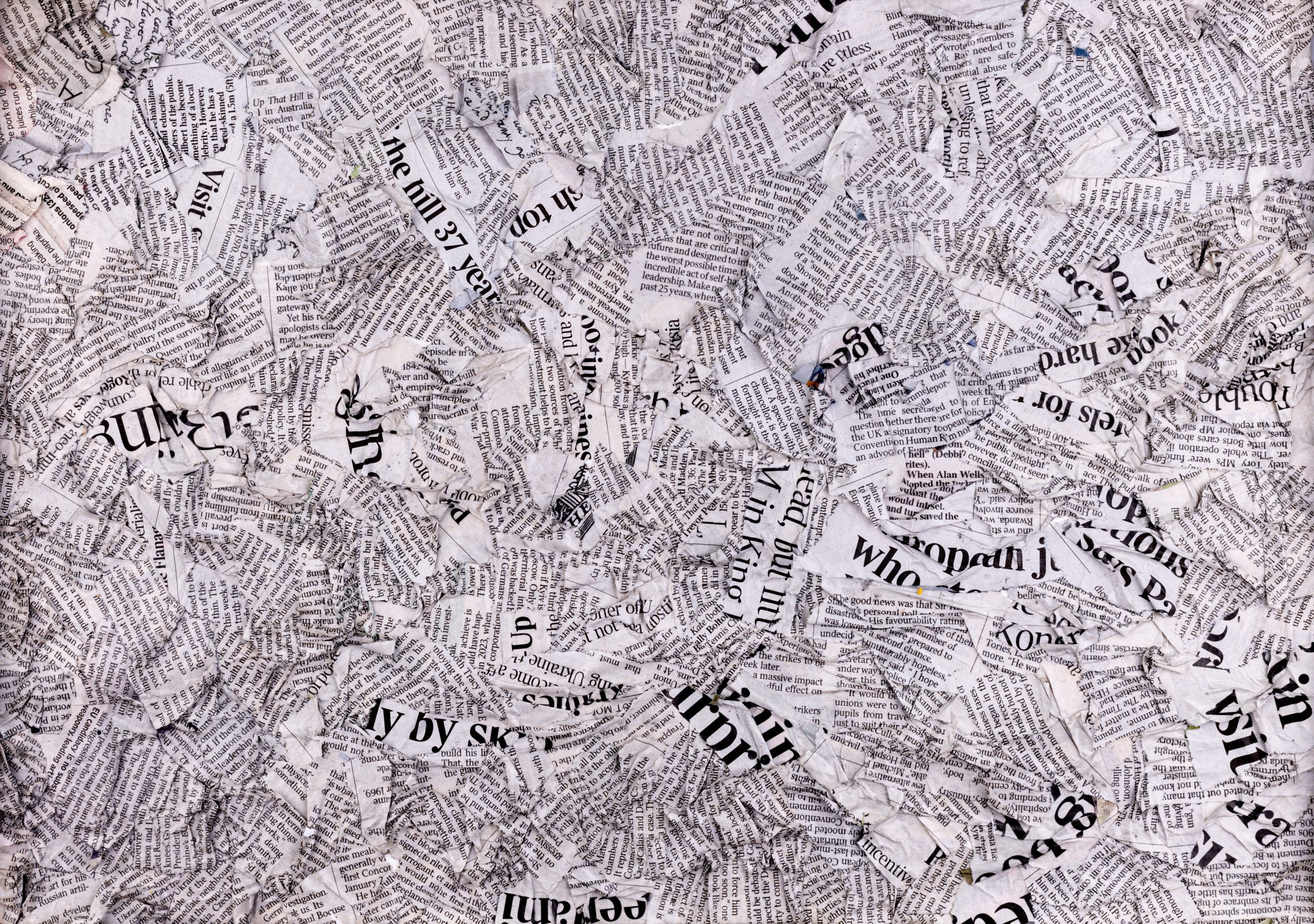
La peur de l’erreur et la gestion de l’image
Derrière ce mutisme, il y a souvent la peur de l’erreur, la crainte de dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre l’institution ou son dirigeant. La gestion de l’image prend le pas sur la mission première du service public. Plutôt que d’assumer les erreurs ou d’expliquer les décisions impopulaires, on préfère se taire et espérer que la tempête médiatique passera.
Un manque de culture de la reddition de comptes
Le problème est aussi culturel. La reddition de comptes n’est pas suffisamment ancrée dans les pratiques administratives. Trop souvent, les fonctionnaires et les dirigeants publics oublient qu’ils sont au service de la population. Le réflexe naturel devrait être de répondre, d’expliquer, de justifier. Or, la culture du secret et de la protection institutionnelle domine encore trop souvent.
Que faire pour briser le silence ?
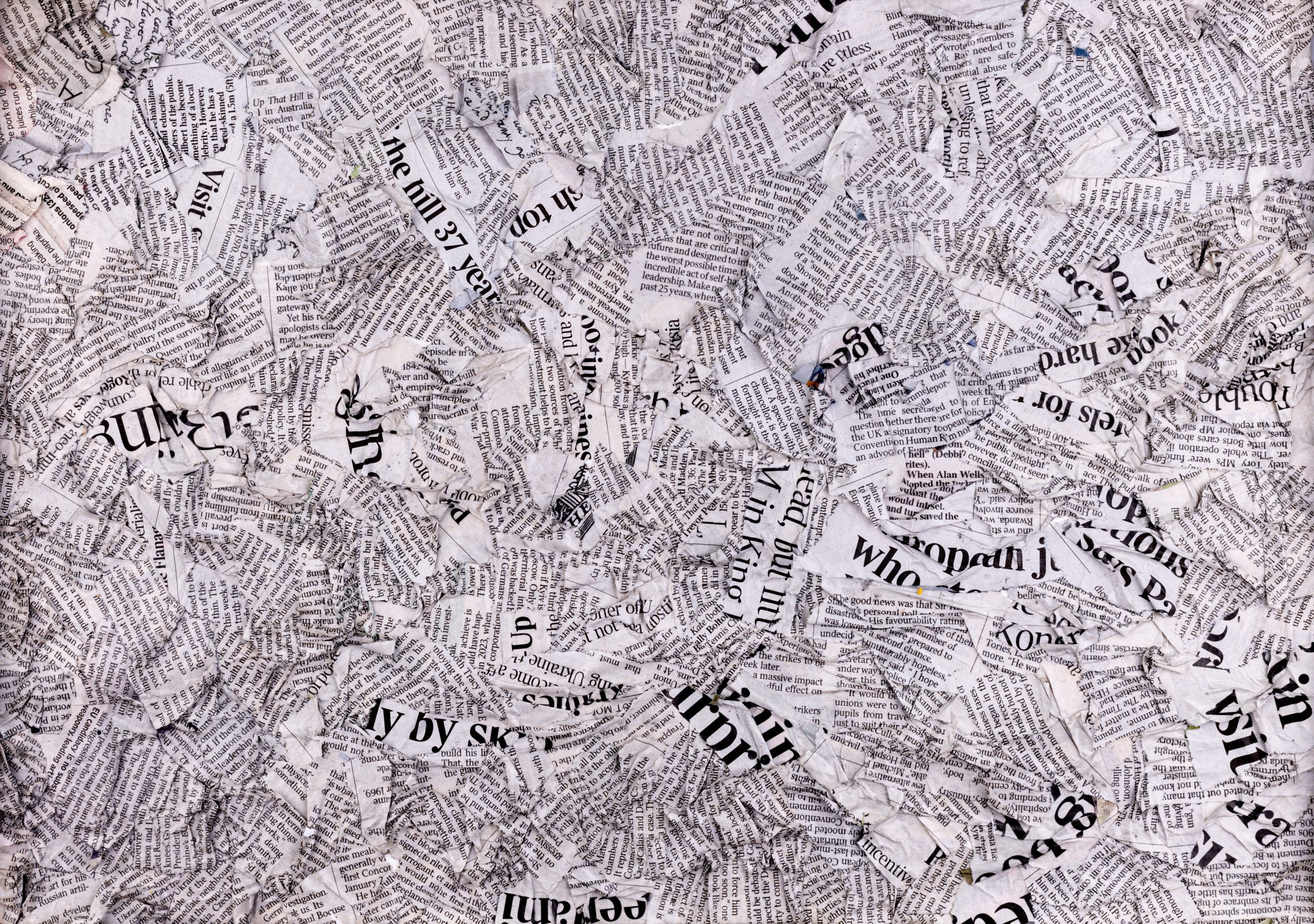
Exiger des comptes, collectivement
Il est temps de rappeler à nos gouvernements qu’ils nous doivent des réponses. Les citoyens, les médias, les groupes de la société civile doivent exiger plus de transparence et de communication. Les lois existent, mais elles doivent être appliquées avec rigueur et dans l’esprit d’ouverture qui les a inspirées.
Moderniser la communication gouvernementale
À l’ère des réseaux sociaux et de l’information instantanée, il est inadmissible que nos institutions publiques fonctionnent encore selon des réflexes d’un autre siècle. Il faut moderniser les pratiques, former les employés à la communication, et instaurer une véritable culture de la transparence et du service.
Conclusion : Le droit de savoir, un devoir pour nos élus
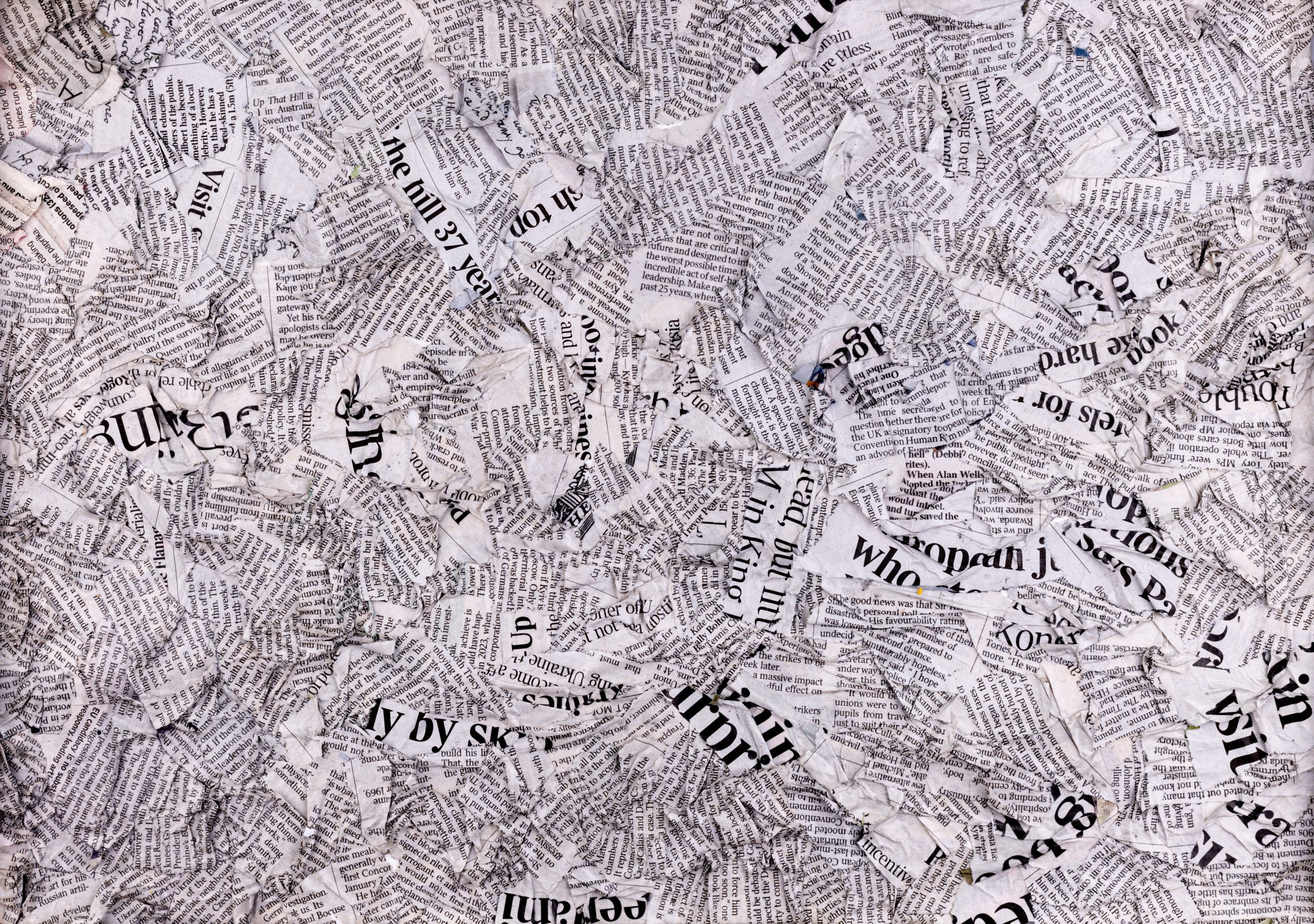
Nos gouvernements n’ont pas seulement le devoir moral, mais l’obligation légale de répondre à nos questions. Le silence n’est pas une option dans une société démocratique. Refuser de répondre, c’est refuser de rendre des comptes, c’est nier le principe même de la démocratie. Il est temps que le service public redevienne ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un service au public, dans la transparence, le respect et la responsabilité. Exigeons des réponses. Car sans elles, il n’y a pas de démocratie véritable.